L’invasion et la conquête de l’Europe occidentale par les armées alliées font l’objet du Plan Overlord. La stratégie générale, en conjonction avec le débarquement dans le Midi de la France, est ainsi définie : débarquement sur les côtes normandes ; bataille décisive dans l’Ouest de la France et percée par enveloppement des positions allemandes ; poursuite sur un large front avec effort prononcé sur l’aile gauche afin d’atteindre la frontière allemande tout en s’assurant des ports nécessaires ; nettoyage de la rive gauche du Rhin et préparation de l’offensive finale ; attaque par la Ruhr et invasion générale de l’Allemagne. On voit rapidement que, dans ce vaste ensemble, l’opération de Provence et sa poursuite jusqu’en Bavière ne constituent qu’une action de couverture de l’effort principal appliqué dans la grande plaine du Nord.
Dans le cadre d’Overlord, la brigade SAS dont font partie les deux régiments parachutistes d’Angleterre, doit participer par le renseignement et l’action à l’appui des 21e et 12e groupes d’armées lors de la phase critique de la constitution de la tête de pont et de la poursuite à travers la France. Pour Anvil (débarquement de Provence), les diverses unités spéciales intégrées à la nouvelle armée française doivent jouer un rôle forcément non spécifique puisque seul le théâtre d’opérations dispose des moyens aériens adéquats de mise à terre et qu’il est le seul à pouvoir prendre des décisions stratégiques. De même, presque rien n’est envisagé quant à l’utilisation des forces de l’intérieur. L’OSS et le SOE ont bien prévu des équipes de renseignement et de liaison, ainsi que des groupes de guérilla :
- « Jedburgh party », du nom d’un bourg écossais à la frontière anglo-écossaise. Composées d’un officier américain, d’un britannique, d’un officier français et d’un radio, les équipes doivent être parachutées en uniforme et affectées à un secteur pour assurer la liaison entre l’EM allié et la Résistance ;
- « Operational Group » (0G), comprend 4 officiers et 30 parachutistes américains ; chargé de missions particulières (coups de main, renforcement des maquis) et disposant d’une autonomie complète.
Mais, aux yeux du commandement français, toute la magnifique planification anglo-américaine ne fait pas la part assez belle aux Forces nationales dans la Libération de la France.
Début juillet 1944, le chef d’état-major de la Défense nationale propose qu’une opération aéroportée soit exécutée dans le Massif Central par une force entièrement française baptisée « Force C ». Les trois RCP, le Choc et les Commandos doivent entrer dans sa composition. Le but de l’opération est de tenir le Massif Central avec l’appui de la population et une force intérieure de 40 à 80 000 hommes. Mais cette opération est essentiellement tributaire des moyens aériens que le général Eisenhower peut accorder et des troupes que le général Wilson peut divertir d’Anvil. Tandis que, pour le commandement français, l’opération représente l’offensive stratégique Centre, au même titre que l’offensive stratégique nord (Overlord) ou que l’offensive stratégique sud (Anvil), pour les Alliés elle n’est qu’une annexe de l’opération sud et passe donc à la priorité n° 4, après la Normandie, la Provence et l’Italie. Ils proposent donc une action aéroportée dans les Alpes en avant-garde des forces d’Anvil.
L’état-major se résigne à remettre à l’armée B les éléments récupérés sur Anvil. La Force C garde le 1er RCP et s’adjoint le « Groupe de commandos de Staoueli », futur GCF, qu’il reste à entraîner avant de le transporter en Angleterre et de l’engager vers J+30 (14 septembre 1944).
Le 27 juillet, l’hypothèque sur les régiments SAS est levée et, devant l’opposition générale des Alliés, le commandement français se résigne à abandonner l’opération. Les forces aéroportées disponibles sont conservées en réserve générale en vue d’intervenir au profit de la Résistance du Sud de la France, à la demande, et en fonction du déroulement des opérations. L’offensive stratégique Centre est définitivement enterrée.
Retournons à Overlord. Le plan comporte d’autant plus de risques que le débarquement dans le Sud de la France, initialement prévu comme action complémentaire simultanée de l’invasion par le Nord, est reporté après le 15 juillet, faute de moyens de transport aérien et maritime suffisants. Pour le général Eisenhower, commandant suprême responsable de la conduite des opérations en Europe occidentale, il importe donc d’empêcher l’afflux des divisions allemandes vers la fragile tête de pont de Normandie pendant les vingt premiers jours cruciaux du débarquement. Il faut ensuite couvrir son flanc méridional, au moins jusqu’à la jonction avec les forces remontant du couloir rhodanien, forces dont l’avance devra être par ailleurs facilitée et couverte.
L’aviation stratégique alliée s’emploie à neutraliser les nœuds de communication ferroviaires et les ponts névralgiques des vallées de la Seine et de la Loire, sur les arrières lointains de l’ennemi. Mais cette action est insuffisante. D’une part, elle ne peut appliquer son effort au plus près de la zone de débarquement de crainte que les Allemands n’en décèlent prématurément le lieu exact. D’autre part, ces bombardements ne peuvent être effectués sans occasionner des pertes importantes parmi la population civile des pays alliés occupés.
Une fois de plus, comme il y a deux ans en Afrique, il est demandé aux parachutistes compléter, voire de remplacer, l’action de l’aviation. Le SAS et les « Operational Groups », disposant d’une autonomie complète, sont ainsi chargés de missions de renseignement et de sabotage. L’aide de la Résistance n’est alors envisagée que comme un appoint. Si un double plan d’action couvrant l’ensemble du territoire et reposant sur l’action de la Résistance a été établi en liaison avec l’EM du général Koenig, les Alliés n’ont qu’une confiance médiocre en des éléments qu’ils jugent disparates et incontrôlables. Les équipes « Jedburgh » sont néanmoins chargées d’assurer la liaison avec les maquis armés.
Les SAS français sautent sur la Bretagne

Trois semaines avant le Jour J, un état-major réduit du 2e RCP quitte l’Écosse pour une destination inconnue au sud de l’Angleterre. C’est le début de la mise au secret absolu au « Camp F », dirigé par l’Intelligence Corps et sévèrement gardé par des détachements de police militaire. Puis, le 24 mai, le reste du bataillon, à l’exception du « Jeep Squadron », part à son pour le « Transit Camp » de la brigade afin de préparer la mission qui va lui incomber. Celle-ci se répartit en deux phases : une phase initiale de sabotage des voies de communication en vue d’isoler la zone d’action des lieux de débarquement et empêcher ainsi tout mouvement des forces de réserve allemandes ; une phase ultérieure, prolongée de guérilla alliant l’action au renseignement, assurée en liaison avec les groupes de résistance locaux, destinée à entretenir la désorganisation de l’ennemi et finalement à faciliter la pénétration alliée.
Le plan établi par l’EM réduit prévoit un échelonnement du bataillon en quatre éléments :
1/ La nuit du débarquement, deux groupes munis de moyens de transmissions et d’aide à la navigation sont envoyés en précurseurs. But : rechercher et reconnaître deux bases de guérilla baptisées « Samwest » et « Dingson ».
-
-
- Stick 1 : lieutenant Pierre Marienne, Emile Bouétard, Pierre Etrich, F. Jourdan, François Krysik, Pierre Pams, Loïc Raufast, Maurice Sauvé, Jean Content, capitaine Hue Hunter (« André », S.O.E.)
- Stick 2 : lieutenant Henri Déplante, adjudant Auguste Chilo, Jean Paulin, Jacques Bailly, Alexandre Charbonnier, Antoine Treis, Henri Filippi).
-
2/ La deuxième soirée après le débarquement, 18 équipes de sabotage de 3 à 5 hommes, répondant au nom de code de « Cooney », sont chargées des destructions initiales. Ces équipes doivent rejoindre les bases, missions exécutées, entre J+5 et J+10.
3/ De J+1 à J+10, le reste des éléments à pied du bataillon est parachuté par groupes de 10 sur les deux bases. Il y recueillera les équipes de sabotage et entreprendra l’action de guérilla.
4/ Enfin, le Jeep Squadron doit être ultérieurement largué ou posé par planeurs en fonction du déroulement des opérations générales. Il éclairera et guidera les avant-gardes blindées alliées. Un peloton peut préalablement être adapté à chaque base afin de la renforcer et d’accroître la mobilité tactique des équipes de guérilla.
La zone d’action est enfin divulguée : c’est la Bretagne. Ce pays de bocage, à l’habitat dispersé et au réseau de communications peu complexe, se prête admirablement à la guérilla. Mais la forte densité des troupes allemandes implantées initialement dans la région constitue un obstacle important au plan élaboré par les SAS. L’ennemi dispose de huit divisions. Cinq sont de valeur médiocre et gardent le littoral entre les forteresses portuaires protégées par des batteries côtières de la Kriegsmarine, mais trois divisions, dont deux de parachutistes, peuvent intervenir rapidement avec l’aide de nombreuses forces territoriales de police et d’éléments de la milice.
Le 5 juin, à 23 heures, les deux détachements précurseurs sont équipés près des deux avions qui vont les emmener vers la France. Les détachements comprennent deux équipes embarquant dans un avion différent et devant se regrouper sur la même DZ. Chaque équipe dispose de 3 radios munis d’un poste à grande portée, d’un S-Phone, de deux pigeons et d’une balise radio-électrique Eureka (équipement radar mis au point par les Américains en AFN pour leurs « pathfinders » ; l’avion est muni d’un récepteur type « Rebeka »). Les hommes ont reçu six jours de vivres. Le lieutenant Deschamps, assisté du lieutenant Botella*, est destiné à la base Samwest, les lieutenants Marienne et Deplante à la base Dingson. Non sans émotion, le brigadier Mac Leod, commandant la brigade SAS, leur serre une dernière fois la main en leur annonçant que l’invasion commence avec leur départ.

Deux heures après, le détachement Deschamps saute à proximité de la forêt de Duault dans les Côtes-du-Nord. Tout se passe sans incident sur cette zone où les points de repère, remarquablement choisis sur les photos aériennes, permettent aux parachutistes de se regrouper rapidement et de se réunir dès le 6, au matin, dans la forêt. En revanche, il n’en va pas de même pour le détachement Marienne, dont la zone de saut choisie près du Moulin de Plumelec, dans les landes de Lanvaux, est difficilement repérable. Comble de malheur, le Moulin de Plumelec sert d’observatoire aux Allemands, ce qu’aucun renseignement n’a prévu. Peu après son arrivée au sol, le détachement est encerclé par une unité de l’Ost Legion, alertée par la vigie. Après un accrochage sérieux dans la nuit, les parachutistes réussissent à se dégager non sans avoir perdu un caporal tué (Émile Bouétard), tué par un supplétif ukrainien ou bien georgien, et les trois radios capturés avec les postes et les codes intacts. Servie par la chance dans son malheur, la deuxième équipe est larguée par erreur 12 kilomètres au nord. Le contact est finalement rétabli grâce à l’aide d’un maquis. Le 8 juin, les parachutistes regroupés à quelques kilomètres de Malestroit, rendent compte qu’ils sont prêts à remplir leur mission sur la nouvelle zone, près de Saint-Marcel.
Pendant ce temps, les 18 « Cooney parties » sont largués dans la nuit du 7 au 8 juin à proximité de leurs objectifs sur le réseau ferroviaire, où les bretelles importantes doivent faire l’objet de plusieurs sabotages simultanés. Chaque équipe a, en effet, reçu une mission principale obligatoire, faisant l’objet d’un contrôle par photo aérienne et que la brigade peut renouveler si elle juge le résultat insuffisant. L’ordre est alors passé par message camouflé sur les ondes de la BBC. Dans la nuit du 8 au 9, la plupart des destructions sont exécutées avec plus ou moins de bonheur, car les Allemands sont en éveil et la majeure partie des points sont gardés, parfois avec des chiens policiers.
Citons à titre d’exemple l’odyssée des deux groupes qui se sont attaqués à la voie transversale Redon-Rennes. Le lieutenant Camaret doit faire dérailler un train dans le tunnel au de Messac. En arrivant sur son objectif, il s’aperçoit que celui-ci, bien gardé, ne peut être attaqué de front. Le lieutenant décide de monter sur la colline, qui n’est pas surveillée. Il y laisse le reste des hommes en recueil et s’avance en rampant avec un aide jusqu’au sommet la voûte, en portant un sac bourré de 30 kg d’explosifs. Là, il attend deux heures l’arrivée d’un convoi, à quelques mètres des sentinelles qui vont et viennent sur la voie. Le train arrive. Lâchant son explosif juste devant la machine, Camaret se jette en arrière mais le souffle de l’explosion est si fort qu’il est assommé, et c’est son équipier qui le ramène. Le train, sous l’effet de la vitesse, pénètre dans le tunnel tout en déraillant et en obstrue complètement l’entrée. Simultanément, le tunnel nord fait l’objet de l’attaque d’un autre groupe. Après avoir vainement attendu l’arrivée d’un convoi, l’équipe se divise en deux. Tandis qu’un élément pose plosifs à l’intérieur du tunnel, le chef de groupe et un homme vont à la gare de Messac. Ils mettent en marche une machine, car l’instruction SAS a aussi porté sur la conduite des locomotives, et la lancent dans le tunnel. Elle explose à l’intérieur. La principale transversale du réseau breton dorénavant est coupée.

Dès le 8 juin, les chefs des bases Samwest et Dingson ont rendu compte de leurs contacts avec les mouvements de résistance et de l’espérance qu’ils ont de réunir les nombreux maquisards pour les renforcer. Dingson annonce le chiffre de 2 000 à 2 500, Samwest de 500, mais très peu sont armés. Dès lors, le commandant de la Brigade SAS lance la troisième phase de l’opération. Dans la nuit du 9 au 10 et les nuits suivantes, le reste du régiment est parachuté : une compagnie sur Samwest avec le capitaine Leblond, qui prend le commandement de l’ensemble ; 2 compagnies, la compagnie de commandement et un peloton de Jeep sur Dingson. Bourgoin, le commandant manchot, y saute le 9 avec un parachute spécialement conçu pour lui et dont la voile tricolore lui a été offerte par le brigadier Mac Leod.
Malheureusement, l’enthousiasme de la population et des FFI, les parachutages massifs trop fréquents (68 avions du 9 au 17 juin, notamment le 13 juin, où 25 appareils larguent 700 containers), les indiscrétions et les imprudences qui ne peuvent manquer de se produire dans une telle ambiance de kermesse attirent l’attention des Allemands. Ceux-ci n’arrivent pourtant pas à apprécier les forces qui leur sont opposées. Dans le même temps, le général Mac Leod ordonne par message : « Éviter à tout prix bataille rangée — Continuer guérilla à outrance et armement FFI. » La dispersion décidée ne pourra être exécutée.
Le 11 juin, un premier incident se produit à Samwest. Un officier allemand se présente en voiture pour se ravitailler dans une ferme, qui sert d’avant-poste. Au lieu d’éviter le combat, les sentinelles abattent l’officier et un soldat. Le second réussit à s’échapper et donne l’alerte à Maël-Carhaix où réside une garnison d’environ 400 hommes. À l’aube du 12, trois camions chargés d’Allemands arrivent à la ferme et entreprennent de la brûler. Le capitaine Leblond se trouve alors pris dans un cruel dilemme : ou bien laisser brûler la ferme pour ne pas dévoiler la base qui est probablement ignorée des Allemands ; ou bien attaquer le détachement pour garder la confiance des maquisards et de la population, au risque de rendre plus difficile l’accomplissement de sa mission. C’est finalement la seconde solution qui est choisie. À 9 heures, une contre-attaque des parachutistes repousse le détachement allemand en lui infligeant de lourdes pertes. Les trois camions sont détruits, tandis qu’un seul parachutiste est tué, et deux autres blessés. Mais, dès cet instant, la base est condamnée. Le capitaine Leblond décide de maintenir dans la région un petit détachement pour continuer la mission sur la voie ferrée Paris-Brest. Il avertit tous les « Cooney parties » et le commandant du bataillon que Samwest n’existe plus, et il replie le gros de la base par petits éléments sur Dingson.
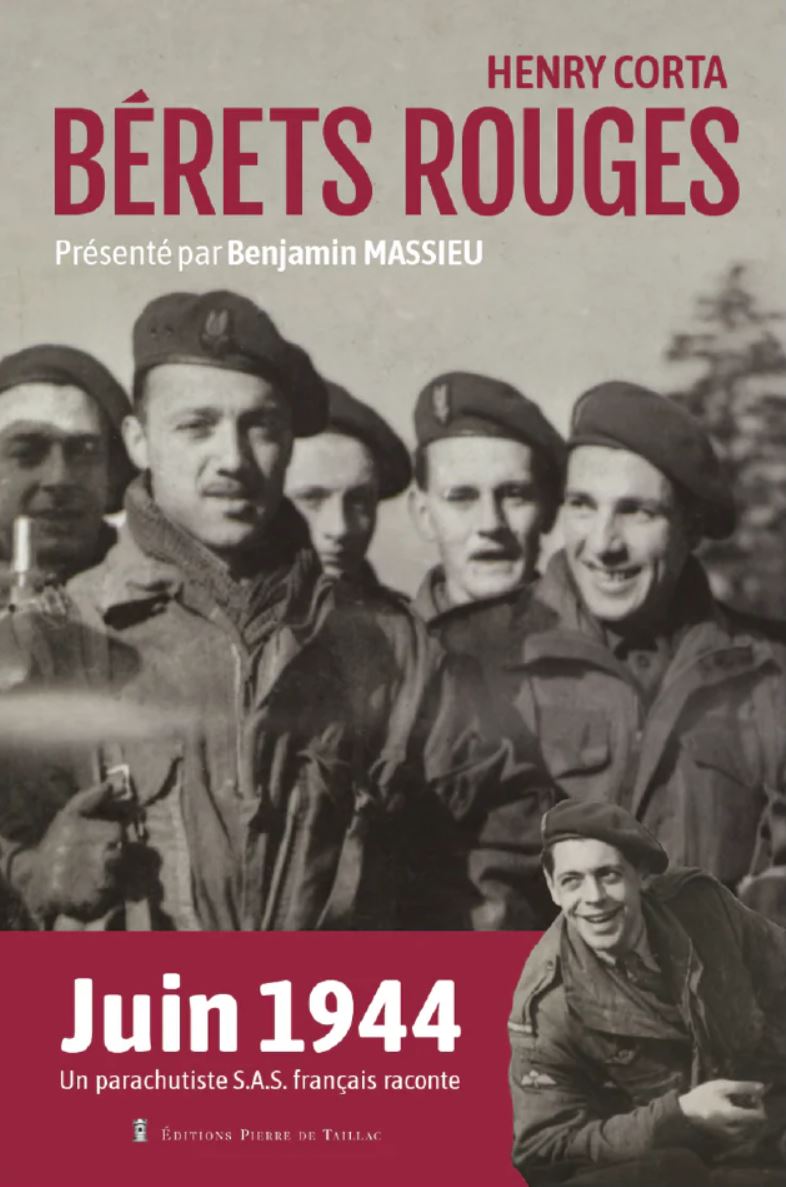
Le commandant Bourgoin, prévenu à temps, envoie un élément pour recueillir les éléments de Samwest et renforcer la nouvelle base à créer près de Pontivy. Il tient compte de l’expérience et la dispersion des éléments est faite sur une grande échelle. La nouvelle base, aux ordres du lieutenant Deplante, doit prendre le nom conventionnel de « Grock ». Quant à Dingson, elle devient à partir du 11 la seule base du bataillon, ce qui représente un grave inconvénient car les parachutages effectués toutes les nuits sont de plus en plus importants.
En outre, dans la nuit du 17 au 18 juin, au moment même où les derniers éléments rescapés de Samwest rejoignent, 27 avions de la RAF, en colonne serrée, larguent plus de 600 containers de matériel que les hommes doivent ramasser avant l’aube. Est également largué le peloton de jeeps du lieutenant de La Grandière mais, le container des mitrailleuses Vickers s’étant écrasé au sol, seule une jeep pourra être armée. Il y a là une faute de commandement, qui causera la perte de la base, car les centaines de parachutes de couleur ne peuvent matériellement pas être ramassés avant le lever du jour, malgré les efforts des parachutistes et des deux bataillons FFI qui se sont constitués avec un encadrement de gendarmes. Dès l’aube, une patrouille de Feldgendarmerie s’engage, avec deux voitures et 12 hommes à bord, sur le chemin de la zone de largage au moment même où les trois quarts du personnel sont encore occupés à ramasser les containers. La réaction des avant-postes est immédiate et les deux voitures sont détruites. Mais un Feldgendarme s’échappe et donne l’alerte. À 08 h 00, le combat s’engage avec les premiers éléments allemands, deux compagnies venues de Malestroit. L’ennemi ne paraît pas réaliser l’importance de la base, défendue par près de 200 parachutistes et 2 000 FFI bien armés. Attaquant d’abord la face est, les Allemands réussissent à s’infiltrer jusqu’à 300 mètres du poste de commandement. Rejetés avec de lourdes pertes par une violente contre-attaque de deux sections parachutistes et du peloton de jeeps, ils s’infiltrent alors sur la face sud où ils sont finalement contenus jusqu’au crépuscule. Le commandant Bourgoin obtient même, dans l’après-midi, l’appui de chasseurs-bombardiers Thunderbolt qui neutralisent les observatoires et paralysent les mouvements ennemis.
Vers 18 h 00, l’attaque reprend brutalement entre la face ouest et la face sud avec l’engagement de troupes fraîches allemandes, venues de Coëtquidan. Des éléments du bataillon FFI qui tient la face nord arrivent en renfort une heure plus tard. Les assaillants sont contenus à 200 mètres. Le commandant Bourgoin décide alors l’abandon de la base à partir de 22 h 00, au cours d’une réunion qu’il tient avec les commandants d’unités parachutistes et FFI. À chaque compagnie parachutiste est attribuée une zone de rassemblement qu’elle doit gagner par petits groupes. Quant aux unités FFI, il est décidé qu’elles retourneront dans leurs villages, tout en se tenant prêtes à se rassembler sur convocation de leurs chefs. Le combat a été meurtrier pour les deux camps : les SAS déplorent une trentaine de tués, dont trois officiers ; les FFI ont de leur côté une centaine d’hommes hors de combat, tandis que les Allemands perdent 300 des leurs, dont le lieutenant-colonel parachutiste ayant dirigé l’attaque.
Dans les environs de Kerusten où elle s’est établie, la base Grock, elle aussi, n’a qu’une existence éphémère. Dès le 21 juin, la Wehrmacht commence l’encerclement. Sans attendre, le lieutenant Deplante donne l’ordre de dispersion aux 800 FFI qui l’ont rejoint tandis qu’il répartit les parachutistes dans les divers maquis. Lui-même essaye de reconstituer avec un petit noyau une nouvelle base qui doit se disperser à nouveau dès que les parachutages la signalent à l’attention de l’ennemi. Une dernière tentative est vouée à l’échec et, au début juillet, il n’existe plus qu’une possibilité : la dispersion absolue.
 Les Allemands organisent alors une chasse impitoyable aux « terroristes » : le 261e escadron de cavalerie (ukrainien) et le 708e Ost Bataillon (géorgien) sont lancés dans la campagne guidés par la Milice, pillant, massacrant les isolés, terrorisant la population. Le 25 juin, le commandant Bourgoin, resté aux environs de Saint-Marcel, échappe de peu à la capture : les services de police allemands s’obstinent à arrêter tous les manchots de Bretagne… Le 12 juillet, c’est le lieutenant Marienne qui est capturé par surprise avec les quelques hommes qu’il a rassemblés. Ils sont abattus sur place par des agents français à la solde du SD allemand. Plus tard, ces derniers brûlent une ferme près de Tredion après y avoir enfermé des parachutistes blessés. Quatre jours après, ils assassinent les lieutenants Skinner et Fleuriot. Heureusement, le 3 août met fin à leur sinistre activité, car l’armée Patton atteint les faubourgs de Rennes après avoir percé le front allemand à Avranches deux jours plus tôt. Ce même jour, la fameuse phrase : « Le chapeau de Napoléon est-il toujours à Perros-Guirec » retentit sur les ondes de la BBC. C’est elle qui donne le signal de l’insurrection pour les 10 000 FFI armés par les SAS. Le 4 août, la dernière phase de l’opération est déclenchée : le reste du « Jeep Squadron », un peloton par parachute, les deux autres en planeurs, est mis à terre au sud d’Auray. Il s’engage immédiatement avec quelques parachutistes pour éclairer la progression de la 4e DB américaine, tandis que le régiment amorce l’investissement de Lorient et Saint-Malo.
Les Allemands organisent alors une chasse impitoyable aux « terroristes » : le 261e escadron de cavalerie (ukrainien) et le 708e Ost Bataillon (géorgien) sont lancés dans la campagne guidés par la Milice, pillant, massacrant les isolés, terrorisant la population. Le 25 juin, le commandant Bourgoin, resté aux environs de Saint-Marcel, échappe de peu à la capture : les services de police allemands s’obstinent à arrêter tous les manchots de Bretagne… Le 12 juillet, c’est le lieutenant Marienne qui est capturé par surprise avec les quelques hommes qu’il a rassemblés. Ils sont abattus sur place par des agents français à la solde du SD allemand. Plus tard, ces derniers brûlent une ferme près de Tredion après y avoir enfermé des parachutistes blessés. Quatre jours après, ils assassinent les lieutenants Skinner et Fleuriot. Heureusement, le 3 août met fin à leur sinistre activité, car l’armée Patton atteint les faubourgs de Rennes après avoir percé le front allemand à Avranches deux jours plus tôt. Ce même jour, la fameuse phrase : « Le chapeau de Napoléon est-il toujours à Perros-Guirec » retentit sur les ondes de la BBC. C’est elle qui donne le signal de l’insurrection pour les 10 000 FFI armés par les SAS. Le 4 août, la dernière phase de l’opération est déclenchée : le reste du « Jeep Squadron », un peloton par parachute, les deux autres en planeurs, est mis à terre au sud d’Auray. Il s’engage immédiatement avec quelques parachutistes pour éclairer la progression de la 4e DB américaine, tandis que le régiment amorce l’investissement de Lorient et Saint-Malo.
Le 2e RCP se rassemble à Vannes pour trois semaines d’un repos bien mérité. Seuls 180 SAS sont sur les rangs : le régiment a perdu en deux mois d’opérations 23 officiers (sur 45) et 175 hommes tués ou disparus, soit près du tiers de son effectif. Le 2 août 1944, le général Gaulle cite le 2e RCP à l’ordre de la Nation et lui attribue la Croix de la Libération.

Une « guerre d’indiens »
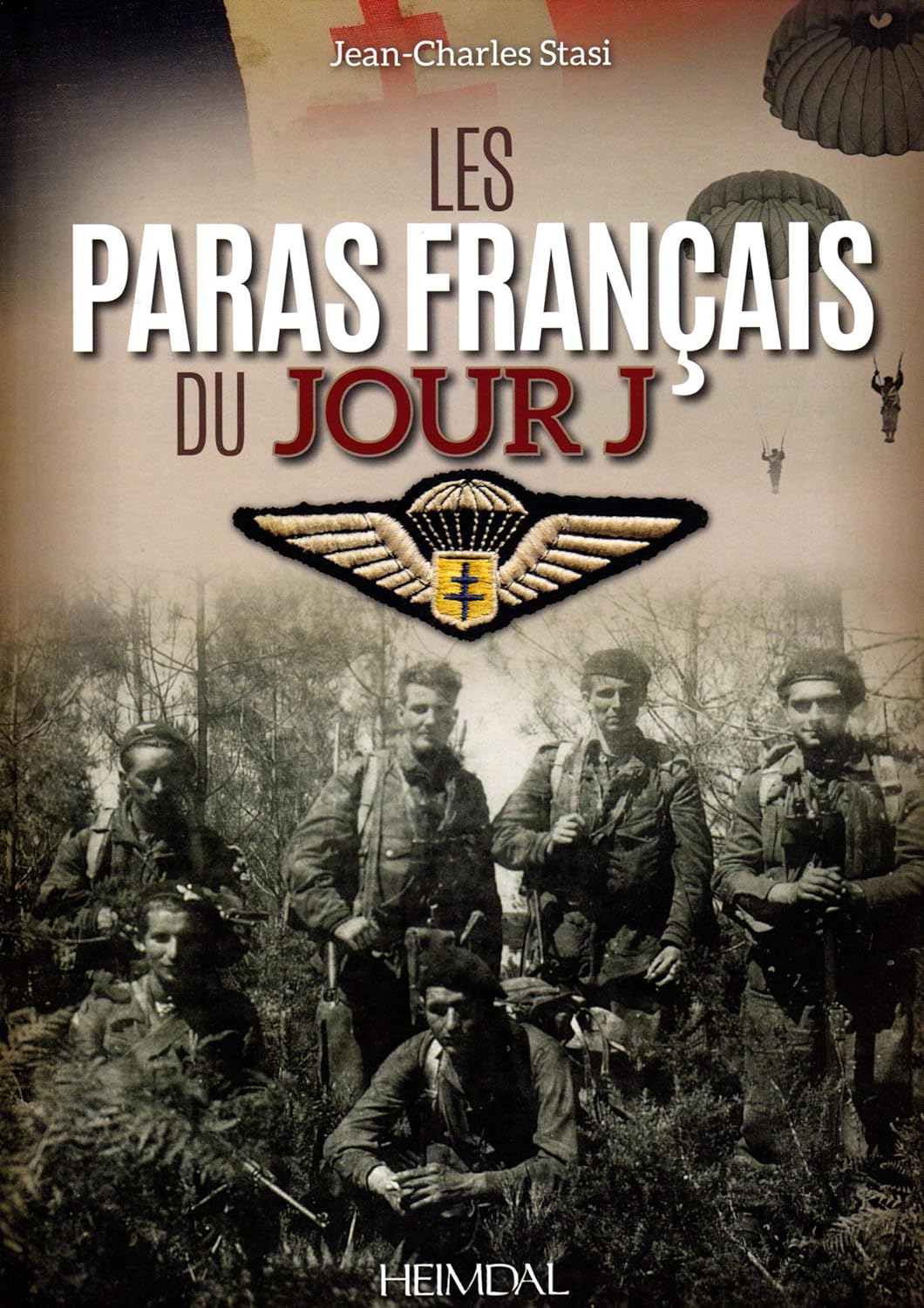 Tandis que le 2e RCP est engagé globalement pour participer à l’isolement de la péninsule bretonne et faciliter la progression des blindés alliés en direction des ports armoricains, le 3e RCP ronge son frein en Angleterre. Enfin, dans la première quinzaine de juillet, le commandant Conan est convoqué par le brigadier Mac Leod. La brigade SAS a été chargée de couvrir le flanc sud de la 3e Armée US qui va déboucher de Normandie et envelopper les forces allemandes au nord de la Loire. Le commandant du 3e RCP reçoit donc la mission suivante : agissant sur la direction de Nantes-Lyon, interdire, en liaison avec les maquis du Centre, toute action des forces de la Wehrmacht, évaluées à 100 000 hommes, refluant du bassin aquitain.
Tandis que le 2e RCP est engagé globalement pour participer à l’isolement de la péninsule bretonne et faciliter la progression des blindés alliés en direction des ports armoricains, le 3e RCP ronge son frein en Angleterre. Enfin, dans la première quinzaine de juillet, le commandant Conan est convoqué par le brigadier Mac Leod. La brigade SAS a été chargée de couvrir le flanc sud de la 3e Armée US qui va déboucher de Normandie et envelopper les forces allemandes au nord de la Loire. Le commandant du 3e RCP reçoit donc la mission suivante : agissant sur la direction de Nantes-Lyon, interdire, en liaison avec les maquis du Centre, toute action des forces de la Wehrmacht, évaluées à 100 000 hommes, refluant du bassin aquitain.
À partir du 16 juillet et jusqu’au 7 octobre 1944, les sticks du régiment, regroupés en onze missions, vont être essaimés de la Bretagne à la Franche-Comté, menant une « guerre d’indiens » dans le plus pur style SAS, harcelant les colonnes allemandes en retraite, signalant les objectifs intéressants à la RAF et à l’USAAF, épaulant ou encadrant les FFI, opérant la jonction avec les forces américaines et françaises débarquées en Provence.
Le 3e Squadron avec la moitié du squadron de commandement et le squadron de renfort, aux ordres du capitaine Simon, opère à partir du 16 juillet dans le Poitou et le Limousin, puis se regroupe autour de Châteauroux avant de rejoindre les poches de l’Atlantique. Le 2e Squadron du capitaine Sicaud intervient le 5 août dans le nord du Finistère pour conserver intacts les ouvrages d’art que les Allemands menacent de détruire devant les blindés américains. Récupéré en Angleterre, il est à nouveau parachuté dans le Jura à proximité duquel opèrent depuis le 12 août le 1er Squadron et l’autre moitié du Squadron de commandement aux ordres du commandant Conan. De son côté, le Squadron de Jeep débarque en Normandie, puis éclate en 5 pelotons qui travaillent indépendamment, soit en liaison avec les divers groupes SAS, soit avec les unités de reconnaissance de la 3e Armée US. Il s’ensuit un fantastique cross country à travers les lignes, au milieu des colonnes de Panzers et des convois allemands qui refluent vers l’est et le nord.
Ainsi, dans l’Yonne, à un passage à niveau, la Jeep de l’aspirant Aubert-Stribi fonce à tombeau ouvert, suivie par l’équipage des frères Djian. Au moment même où la première Jeep va tomber dans une embuscade, Lucien Djian, qui voit la scène d’un seul coup d’œil, vire en pleine vitesse, enjambe le talus de la voie ferrée qu’il franchit et prend l’ennemi de flanc, à bout portant. Aubert-Stribi passe sans mal tandis que ses deux mitrailleuses fauchent le FM et ses servants. Sans même s’arrêter, les deux Jeep disparaissent, laissant une vingtaine de cadavres sur la voie. Le 1er septembre, il rejoint le PC du régiment.
Le 4 septembre, le peloton, qui a reçu l’ordre d’agir sur la nationale 6, approche vers 04 h00 du matin de Sennecey-le-Grand. Un convoi allemand de près de 3 000 hommes en route vers la trouée de Belfort y stationne. Le capitaine Combaud de Roquebrune décide d’attaquer ; les quatre Jeep foncent à 80 km/h dans la Grand-Rue. La panique s’empare des Allemands, surpris par la violence du feu, l’audace et la rapidité de l’attaque. Malheureusement, à la sortie du village, les jeeps se trouvent face à face avec un autre convoi ennemi qui arrive. Les premiers camions, incendiés, barrent la route. Il ne reste qu’une seule issue : repasser par Sennecey. Alors, sous le feu, les Jeep font demi-tour sur place, mais leur élan est brisé par les cadavres qui jonchent la Grand-Rue. Sauf la première qui atteindra la sortie du village, les trois autres s’immobilisent une à une, bloquant le passage. Les équipages se dégagent et mènent un combat désespéré au corps à corps, dont ils peuvent sortir vivants. Seuls, l’adjudant Tramoni, Beaude et Bailleux, blessés tous trois, se traînent à travers champs et s’échappent de cet enfer dont la dernière vision sera pour eux Aubert-Stribi se défendant au colt et la Jeep en flammes du chef de peloton continuant à cracher le feu de toutes ses armes. Si les pertes allemandes n’ont pu être dénombrées exactement, il a cependant fallu réquisitionner plus de 30 médecins civils pour soigner leurs blessés.
 Le 6 septembre, les 25 SAS des capitaines Rouan et Poro, aidés des 125 FFI, s’emparent de Montceau-les-Mines, puis s’installent en bouchon sur la route et la voie ferrée. À midi, un train se présente et déraille sur la coupure préparée. Le combat s’engage contre 300 Allemands. De son côté, le capitaine Rouan voit débarquer une autre unité d’un convoi auto. La situation n’est pas brillante, lorsque le sergent-chef Le Carré et un maquisard, avec un sang-froid qui frise la témérité, sauvent la situation. Sautant sur le remblai, ils s’avancent et demandent d’autorité le commandant d’unité à qui ils déclarent sans ambages : « Vous êtes encerclés par une division aéroportée, rendez-vous ! » Après quelques hésitations, l’Allemand s’exécute. Au moment où quelques maquisards récupèrent les armes et rassemblent les prisonniers, survient un train blindé. Quelques coups de feu sont échangés. Le Carré intervient. Renouvelant son geste, il ouvre les portières, fait descendre les Allemands et leur ordonne de jeter les armes à terre. Sur ces entrefaites, les hommes du convoi-auto arrivent. Ils regardent le spectacle et, à leur tour, jettent les armes et se rendent. En quelques instants, au prix de deux tués, les parachutistes se retrouvent à la tête de 500 prisonniers, deux trains, deux chars, plusieurs canons et 500 armes diverses, tandis que l’ennemi laisse sur le terrain 20 tués et 32 blessés.
Le 6 septembre, les 25 SAS des capitaines Rouan et Poro, aidés des 125 FFI, s’emparent de Montceau-les-Mines, puis s’installent en bouchon sur la route et la voie ferrée. À midi, un train se présente et déraille sur la coupure préparée. Le combat s’engage contre 300 Allemands. De son côté, le capitaine Rouan voit débarquer une autre unité d’un convoi auto. La situation n’est pas brillante, lorsque le sergent-chef Le Carré et un maquisard, avec un sang-froid qui frise la témérité, sauvent la situation. Sautant sur le remblai, ils s’avancent et demandent d’autorité le commandant d’unité à qui ils déclarent sans ambages : « Vous êtes encerclés par une division aéroportée, rendez-vous ! » Après quelques hésitations, l’Allemand s’exécute. Au moment où quelques maquisards récupèrent les armes et rassemblent les prisonniers, survient un train blindé. Quelques coups de feu sont échangés. Le Carré intervient. Renouvelant son geste, il ouvre les portières, fait descendre les Allemands et leur ordonne de jeter les armes à terre. Sur ces entrefaites, les hommes du convoi-auto arrivent. Ils regardent le spectacle et, à leur tour, jettent les armes et se rendent. En quelques instants, au prix de deux tués, les parachutistes se retrouvent à la tête de 500 prisonniers, deux trains, deux chars, plusieurs canons et 500 armes diverses, tandis que l’ennemi laisse sur le terrain 20 tués et 32 blessés.
Le bilan général du 3e RCP est suffisamment éloquent : 5 476 Allemands hors de combat, 1 390 prisonniers, 11 trains et 382 véhicules détruits pour la perte de seulement 41 parachutistes tués ou disparus.
Le Régiment frère, dont la gloire acquise en Bretagne a quelque peu fait oublier le magnifique travail effectué par le 3e RCP, est alors en train de regrouper ses éléments éparpillés sur toute la Bretagne et de se réorganiser. Renforcé par les FFI qui ont combattu dans ses rangs et monté sur Jeep type SAS, le 2e RCP va bientôt prêter main-forte au 3e RCP dans sa mission de flanc-garde.
Le 26 août, 65 Jeep arrivent à Vannes, apportant les bérets amarante que le roi d’Angleterre, en un geste de reconnaissance profonde, accorde aux SAS français. Aussitôt équipées, les Jeep du 2e RCP démarrent vers la Loire et la région de Briare à partir de laquelle les quatre squadrons vont opérer en direction de Nevers, Châteauroux et Bourges. D’un bilan aussi prestigieux que celui de son homologue, nous ne retirerons que quelques chiffres indiscutables et qui sont certainement bien au-dessous de la réalité : 326 Allemands hors de combat, 2 520 prisonniers et 320 véhicules divers pour 2 tués, 12 blessés et une Jeep détruite chez les SAS. Cela semble-t-il, n’a pas besoin de commentaires !
L’épisode le plus extraordinaire se situe le 11 septembre. Ce jour-là, le sous-lieutenant Le Bobinnec, commandant un peloton du 2e Squadron, enlève par surprise un avant-poste sur la route de St-Pierre-le-Moutier. Les prisonniers assis avec un drapeau blanc sur le capot des Jeep, il pénètre alors dans le village encombré par un convoi du détachement d’avant-garde de la colonne Elster. Après discussion avec le commandant du convoi, il le persuade qu’il est à l’avant-garde d’une division blindée américaine et que toute résistance est inutile. Impressionné par l’assurance du sous-lieutenant et déprimé par les attaques incessantes dont la colonne est l’objet, le commandant du détachement finit par céder. La capitulation englobe 2 500 Allemands, 300 véhicules, 8 canons et tout l’armement individuel correspondant. Les 2e et 3e Squadrons, arrivés en renfort, envoient des prisonniers munis d’une demande de reddition en bonne et due forme au commandant du gros des forces de la Wehrmacht. Ce dernier refuse de se rendre aux parachutistes ou aux FFI, mais demande à être mis en contact avec le commandant des forces américaines. Le contact réalisé par les SAS, les prisonniers se dirigent vers Orléans sous la garde des parachutistes.
Avec cet exploit se termine, le 14 septembre, la campagne de la Loire. Les Squadrons se regroupent à Briare. Depuis le 12 septembre, à hauteur de Dijon, la jonction entre les armées alliées de l’ouest et du sud est réalisée.

Pierre BOURGOIN
 Né en Algérie en 1907, il est instituteur en Afrique-Occidentale française (AOF) à partir de 1925. Il est passionné par la chasse au fauve.
Né en Algérie en 1907, il est instituteur en Afrique-Occidentale française (AOF) à partir de 1925. Il est passionné par la chasse au fauve.
Il effectue son service militaire en 1928 au 3e régiment de tirailleurs algériens, où il est nommé sous-lieutenant de réserve en 1929.
Promu lieutenant de réserve en 1939 avec effet rétroactif au , Pierre Bourgoin rejoint dès les Forces françaises libres (FFL) et prend part, en août de la même année, au ralliement à la France libre de l’Oubangui-Chari, pays où il exerçait comme instituteur.
Incorporé en au Bataillon de marche n° 2, au sein duquel il commande le groupe franc, il participe à la campagne de Syrie en juin 1941 et y est blessé au pied droit par un éclat d’obus en juillet. Il est condamné à mort par contumace pour faits de résistance en 1941. Capitaine en , il est affecté au groupe de bombardement Lorraine et effectue dans cette unité la campagne de Libye en tant que commandant de l’échelon à terre (Groupement nord-africain).
En , il est blessé par balle une seconde fois, à la face postérieure du genou. En , il est encore blessé lors d’un accident d’avion et souffre de fractures multiples des côtes.
Après avoir effectué un stage de commando parachutiste, il est affecté aux services secrets britanniques de l’Intelligence Service Landing Departement. Il y est chargé du renseignement lors de missions spéciales. Il effectue également à la tête d’un commando des coups de main en Tunisie.
En , il reçoit, ainsi que le capitaine Augustin Jordan, la mission de désorganiser les arrières lointains de l’ennemi, et il réussit à atteindre la frontière tunisienne avant que la 8e armée ne soit arrivée à Tripoli.
En , un groupe attaque continuellement les convois entre Tripoli et Sousse, tandis que l’autre détruit des ouvrages d’art à Kairouan, à Mateur et fait sauter un train sur un pont dans la région de Gabès. Jordan est fait prisonnier.
Le , avec son groupe, il traverse les territoires occupés par deux divisions ennemies, situe l’emplacement exact d’un grand nombre de pièces d’artillerie adverses, détruit un pont d’une importance primordiale pour l’ennemi et ramène son groupe au complet.
Alors qu’il se rend en Algérie le , au retour d’une reconnaissance des infrastructures allemandes en Tunisie, son véhicule est attaqué par un avion allemand et son conducteur en perd le contrôle. Bourgoin porte 37 traces de blessures et est amputé du bras droit ; quant à son bras gauche, il porte une fracture du radius et du cubitus et une fracture complète du poignet, ainsi que des blessures multiples par éclats d’obus à la cuisse gauche. Il réussit à échapper aux recherches allemandes, se cache en s’enterrant dans le sable et est recueilli au bout de six heures par une patrouille anglaise. Il est soigné à l’hôpital de Philippeville, puis en convalescence à l’hôpital d’Alger et part en Angleterre dès sa guérison, le 1er, après sept mois d’hospitalisation.
Désormais surnommé « le Manchot », il est promu commandant. En , il prend, à la suite de Pierre Fourcaud, le commandement du 4e régiment du Special Air Service, le 4e Bataillon d’Infanterie de l’Air, une unité française de 500 hommes qui deviendra en 1944 le 2e régiment de chasseurs parachutistes. Il entraîne son régiment en Angleterre, puis en Écosse en vue du débarquement en Europe. En , il rencontre le maréchal britannique Bernard Montgomery qui passe en revue les deux régiments SAS français : le 3e, commandé par le capitaine Chateau-Jobert et le 4e.
À partir de la nuit du 5 au , son régiment est envoyé en Bretagne lors des opérations de la bataille de Normandie afin d’y fixer les troupes allemandes présentes : ce sont les opérations SAS en Bretagne. Lui-même est parachuté, malgré son handicap, avec un parachute bleu-blanc-rouge, cadeau des Anglais, dans la nuit du 10 au , sur Dingson dans le Morbihan, à côté de Saint-Marcel, avec son état-major et une compagnie. Il y rejoint ses hommes qui encadrent déjà les résistants.
Afin de bloquer sur place les 85 000 soldats allemands qui se trouvent dans la région, il rassemble 3 000 maquisards et 200 SAS dans le maquis de Saint-Marcel (Morbihan). La base Samwest située à Duault (Côtes-du-Nord) est dispersée le par une attaque allemande. C’est ensuite au tour de Dingson d’être attaquée : c’est le combat de Saint-Marcel le . Le rassemblement est dispersé après la bataille, et les hommes de Bourgoin se disséminent dans toute la région. Les 18 Cooney-parties (58 hommes) étaient entrées en action le . Après le , le reste du régiment est rejoint peu à peu en renfort par des parachutages ponctuels de « sticks ». L’action de Bourgoin paralyse les Allemands qui recherchent désespérément tout manchot suspect. Il échappe de peu à la capture près de l’écluse de Guillac le . Il devient l’homme le plus recherché dans toute la Bretagne, jusqu’à la libération de la région en août. Rommel met une seconde fois sa tête à prix, après l’avoir déjà fait lors de la campagne d’Afrique ; il sait qu’il a affaire au même personnage.
Les Américains atteignent la Bretagne le et la jonction se fait avec les SAS qui se regroupent et reforment le 4e SAS. Fin , Bourgoin reçoit la mission de couvrir avec son régiment le flanc droit de l’armée alliée sur la rive droite de la Loire : c’est l’opération Spencer. En septembre, ses troupes attaquent une colonne allemande de 18 000 hommes qui remontait du sud-ouest. À Saint-Pierre-le-Moûtier, ses « sticks » capturent 3 000 Allemands le et s’emparent d’un matériel considérable.
Le , le lieutenant-colonel Bourgoin, coiffé pour la première fois du béret rouge, ouvre le défilé militaire en descendant les Champs-Élysées à Paris à la tête du 2e régiment de chasseurs parachutistes, dont le drapeau vient de recevoir la Légion d’honneur des mains du général Charles de Gaulle devant l’Arc de Triomphe. Le régiment défile devant le Premier ministre britannique Winston Churchill et le général de Gaulle. C’est là que la guerre s’arrête pour Bourgoin, l’ancien 4e SAS poursuivant les opérations, notamment en Hollande avec l’opération Amherst.
En , Bourgoin est nommé inspecteur des Parachutistes ; son régiment est remis entre les mains de son adjoint Pierre Puech-Samson. Bourgoin est démobilisé en . Il revient à Saint-Marcel en 1947, en présence du général de Gaulle, et en 1951 lors de l’inauguration du monument du maquis.
En 1949, il est nommé inspecteur général des chasses pour la France et l’Outre-Mer, et est promu colonel de réserve en 1950.
André Botella
RÉCIT DU LIEUTENANT SAS ANDRÉ BOTELLA
Le lieutenant André Botella (1913-1991), ayant rejoint les Forces Françaises Libres en Angleterre, se porte volontaire pour servir comme parachutiste dans le Special Air Service. Après avoir reçu une formation intensive au camp de Fairford, il se tient prêt à partir. Le but : former de petites équipes avec des missions de harcèlement ; constituer deux bases, l’une dans les Côtes-du-Nord, à Duault, l’autre dans le Morbihan, à Saint-Marcel, pour centraliser l’organisation de la Résistance. L’officier chargé de diriger la base de Duault, le capitaine Leblond, a beau protester, la mission reste inchangée. Il s’agit de précéder les Alliés qui doivent arriver en Bretagne peu après le débarquement, le 6 juin… À 00 h 45, l’équipe du lieutenant Marienne est parachutée au-dessus de Plumelec dans la Morbihan…
Le commandement nous libère de nos angoisses.
Par la trappe je regarde défiler la campagne bretonne. Ce village, c’est Locarn, et aussitôt après le carrefour tant de fois repéré sur la photo aérienne.
— Go !
Il est 01 h 15.
Je maîtrise mal mon élan et mon casque heurte violemment la paroi avant de la trappe. Le cœur serré et le front endolori, j’attends le choc à l’ouverture. Ouf ! ça y est ! Après le vacarme des quatre moteurs du bombardier, c’est le calme d’une nuit claire.
Devant moi, j’aperçois nettement les coupoles des parachutes de mes hommes se découper sur le ciel lumineux.
Je ne suis pas seul à les voir: de toutes les fermes avoisinantes un concert de hurlements monte vers nous.
Des dizaines, des millions de chiens aboient vers ces globes étranges qui descendent mollement sur eux. Ces sacrées bestioles vont nous faire repérer. J’ai l’impression que toute la Wehrmacht me tient dans son collimateur. Je largue mon « legbag » (sac de jambe) qui me précède à grand fracas dans d’épais buissons qui me lardent d’épines. Décidément, la lande bretonne n’est guère accueillante pour ses libérateurs. Il est impossible que tout ce vacarme n’ait pas été entendu.
Le cœur battant, j’arme précipitamment ma mitraillette. Mais tout est calme, sauf, dans une ferme toute proche, des chiens qui se démènent et hurlent comme des forcenés. Il est temps de dégager les lieux. Je camoufle mon parachute sous les broussailles, extirpe quelques épines de mes fesses et m’oriente. Si les aviateurs n’ont pas fait d’erreur, la forêt de Duault est à 2 ou 3 km au nord-est. Le point de ralliement de mon stick est un ponceau (petit pont) à l’ouest des gorges du Corong. Je pars, tous les sens en éveil. Dans un chemin creux, vers Lopuen, d’après ma carte, je suis chargé par deux molosses particulièrement agressifs. J’essaie de les amadouer en alternant douceur, persuasion et sévérité. Je sacrifie quelques biscuits de mes rations. Rien n’y fait. Ils refusent de manger le pain amer de l’étranger et restent toujours aussi hargneux. J’ai du mal à protéger mes mollets. Voilà un danger bien réel sur lequel nous n’avions pas été renseignés à Fairford. Les Allemands, d’accord. Et les chiens, alors ? Je poursuis mon chemin avec de fréquentes volte-face pour repousser les deux pétainistes. J’arrive à un ruisseau dont je suis le cours. Le ponceau doit être là. J’entends un froissement de broussailles. Faites, mon Dieu, que ce ne soit pas encore des chiens. Je siffle les premières notes d’une vieille ballade écossaise qui est notre signal de ralliement. Pas de réponse, sinon que les deux clébards arrivent au grand trot, cette fois très amicaux. Ils apprécient donc les airs écossais. Un bag-pipe m’aurait été plus utile qu’une mitraillette. Je siffle à nouveau. Cette fois, une réponse en bon français :
– Arrive, eh, con ! on est du stick Botella.
Ce sont Schermesser et Urvoy qui ont oublié notre signal de ralliement, tant de fois répété à l’entraînement cependant. Il m’en reste encore six à récupérer, plus le stick Deschamps dont j’ai perçu le largage vers 1 h 30. Nous traversons le ponceau et nous engageons dans le sentier qui monte vers la forêt. Je suis en tête, Schermesser et Urvoy me suivent et, en serre file, trottinent les deux chiens qui, après des préliminaires réticents, paraissent s’être ralliés à la Résistance. [ … ] En chemin, nous récupérons le reste de mon stick et le stick Deschamps. Il ne manque le sergent-chef Litzler qui, blessé à l’atterrissage, nous rejoindra en fin de matinée.
Vers 8 h 00, nos guetteurs nous amènent un jeune garçon blond, imberbe, vêtu d’une capote feldgrau de la Werhmacht qui lui descend jusqu’aux chevilles. « Je suis Georges Ollitrault, du maquis de Callac », nous dit-il, « j’ai appris le débarquement à 7 h et je viens me mettre à vos ordres. » Nous apprîmes et constatâmes plus tard que ce Jojo à visage d’ange était une véritable terreur à la gâchette facile et un redoutable tueur d’Allemands. Il est suivi par un grand gaillard blond qui ne parle pas le français, ce qui s’explique car il est Allemand. C’est Georges Niemann. Son père a été fusillé par la Gestapo et il a rejoint le maquis en 1943. C’est un combattant d’élite qui appartenait à la 5e Division parachutiste allemande, la fameuse division « Kreta ». Mon radio, Julien Devize, haut fonctionnaire des Finances dans le civil et excellent calculateur, en déduit que la Résistance française comprend 50 % d’Allemands. Ce calcul se révèle inexact car, un peu plus tard, nous sommes rejoints par Charles Moreau dit « Charlot », commandant le maquis de Callac. Il est accompagné par un groupe hétéroclite et pittoresque mais qui paraît décidé à en découdre. Charlot nous affirme que nous pourrions rapidement rassembler l’effectif d’un bataillon. Deschamps et moi n’en revenons pas. Il y a donc bien une Résistance en Bretagne. Le commandement opérationnel l’ignorait-il – ou feignait-il de l’ignorer ? Nous envoyons un message au Tactical Command et faisons l’inventaire des effectifs et des besoins. L’armement de plusieurs centaines de résistants ne pose pas de problème. Nous sommes assurés de recevoir par parachutage tout le nécessaire. Reste l’encadrement et l’instruction. Comment surmonter ces difficultés avec nos faibles moyens? Une levée en masse face à un adversaire redoutable aboutirait à des massacres en masse. Nous décidons donc de ne pas précipiter les choses.
D’autres résistants nous rejoignent, Dathanat et Le Cun de Guingamp, Le Hégarat dit « Marceau » de Saint-Brieuc et beaucoup d’autres, dans un enthousiasme indescriptible. Nous demandons d’urgence des renforts.
À partir du 8 juin, mes deux sticks restés en Angleterre sont parachutés, puis la 2e compagnie du 4e bataillon S.A.S. commandée par le capitaine Leblond. Le reste du bataillon saute dans le Morbihan. Le 10 juin, le caporal Fernand Meunier est tué à l’est de Locarn. C’est le premier parachutiste tombé dans les Côtes-du-Nord.
Le 12 juin, une patrouille allemande surprend quatre parachutistes de la compagnie Leblond descendus à la ferme de Kerhamon malgré les ordres. Après un bref combat, les parachutistes sont tués. Les Allemands se replient mais reviennent avec d’importants renforts. Les attaquer serait compromettre le secret de la mission et le capitaine Leblond s’y oppose à juste raison tout d’abord. Je lui fais observer que, venus en libérateurs, nous ne pouvons, sans compromettre notre prestige, laisser massacrer les fermiers de Kerhamon. Leblond cède finalement, mais à condition que nous n’engagions que de faibles effectifs afin de ne pas dévoiler l’importance de la base.
Je descends donc le sentier qui conduit à Kerhamon avec un seul stick commandé par mon adjoint, le sergent-chef Litzler.Un groupe de résistants nous suit, Charlot et Jojo en tête.
La ferme n’est plus qu’un brasier.
Subitement, nous repérons les Allemands qui gravissent en petites colonnes dans un ordre parfait la prairie bordant la forêt.
Nous mettons aussitôt deux « bren gun » (fusils mitrailleurs anglais) en batterie et déclenchons un feu d’enfer. Les Allemands, qui ne nous avaient pas repérés, sont surpris et refluent. Ils se reprennent vite et, retranchés dans le chemin creux bordant la ferme, ouvrent le feu à leur tour. Ce ne sont pas des débutants. Litzler s’écroule, la poitrine traversée. Une balle me fracasse la cuisse. J’ai l’impression qu’elle a été arrachée et je souffre horriblement. La fusillade continue à faire rage. Je me colle au sol mais reste très exposé et les balles hachent l’herbe autour de moi. J’attends le coup qui va m’achever. Ainsi, c’est comme cela que tout va finir? Dès le premier combat ?
De notre côté, le feu a presque cessé. Les paras et les résistants se sont mis à l’abri derrière la lisière. Tous, sauf Charlot. J’entends sa voix amie au-dessus de moi : « Vous êtes blessé, mon lieutenant ? Je vais vous tirer de là. » Et, debout au milieu d’une pluie de balles, il me tire derrière un talus. Comment n’a-t-il pas été criblé ? La fusillade se calme de notre côté mais reprend violemment plus au nord. C’est le stick du sous-lieutenant Lasserre et de Robert qui prend les Allemands à revers.
Charlot arrive avec une civière et on me remonte dans la forêt. Je croise le lieutenant Marin, un rescapé des combats de Libye et de Cyrénaïque qui sera tué en juillet dans le Morbihan avec le lieutenant Marienne. Je ne vaux guère mieux. Charlot me tend ma mitraillette qu’il a ramassée sur les lieux du combat. « Garde-la, mon vieux Charlot, tu en auras plus besoin que moi ».
Je suis maintenant au PC de Samwest. J’entends râler Litzler à quelques pas de moi. J’entends aussi une fusillade lointaine, vers Saint-Servais, me semble-t-il. Ce sont des résistants qui harcèlent la compagnie allemande en retraite.
À la tombée de la nuit, Leblond vient me voir : « La base est maintenant repérée. Conformément aux ordres, nous devons maintenant rallier Dingson. Tu dois comprendre qu’il est impossible de t’emmener. La mission passe avant tout. » J’aurais dû alors répondre par ces paroles historiques qui font si bien dans les livres. Certains auteurs les ont mises dans ma bouche, mais je ne me souviens pas les avoir prononcées. Je ne suis que douleur et je me fous du débarquement, de la mission et de la Résistance. Tant pis pour la légende héroïque.
Plus tard, le lieutenant Sassoun, notre médecin, se penche sur moi :
— Litzler a une hémorragie interne. Il est fichu. Alors je lui ai fait une double morphine pour l’aider. Toi aussi, je vais te faire une double morphine.
Les paras que je commandais viennent aussi me voir.
Mon radio Julien Devize reste un long moment près de moi. Je les vois à peine. Cela ne m’intéresse plus. C’est un autre monde.
La nuit est tombée. Le râle de Litzler s’est éteint. De temps en temps, un froissement de broussailles me tire de ma léthargie. Les Allemands qui viennent m’achever ? Non. C’est l’aspirant Metz, oublié en lisière de forêt avec son « bren gun », puis des paras que l’ordre de repli n’a pas touché. J’ai trouvé une position un peu plus confortable et je n’ai presque plus mal mais j’ai très froid. Je sombre peu à peu dans le coma.
Un bruit de pas et de voix me fait quelque peu reprendre conscience. Cette fois c’est la fin. Mais non. Les voix parlent français. Je vois surgir des broussailles Robert et les inévitables Charlot et Jojo. Ils se penchent sur Litzler puis viennent vers moi.
— Bon. Celui-là a l’air vivant. C’est le lieutenant. On va l’évacuer.
Je ne suis pas enthousiaste. Ces abrutis vont me secouer et réveiller ma douleur. Sans écouter mes protestations, ils m’embarquent dans un camion et me conduisent dans une masure isolée en plein maquis de Kerchariou. J’y retrouve deux autres paras blessés, le lieutenant Lasserre et le caporal Faucheux, en aussi piteux état que moi. Faucheux a reçu une balle dans le ventre. La balle qui a traversé la poitrine de Lasserre a champignonné et il a dans le dos un trou de la dimension d’une assiette qui grouille déjà d’asticots. Georges Le Cun et un maquisard (Mimile, je crois) restent avec nous. Pendant ce temps, Robert, avec les éternels Charlot et Jojo et le maquis de Callac, mettent en lieu sûr, avec des camions réquisitionnés on ne sait comment, les tonnes d’armes, de munitions et d’explosifs abandonnés dans la forêt de Duault. Les Allemands, qui paraissent avoir été bien secoués, ne réagissent pas.
George Le Cun, qui a pris en charge les blessés, nous amène le docteur Lebreton de Bourbriac, puis un chirurgien, le docteur Rivoallan de Guingamp. Celui-ci taille à vif dans l’énorme plaie de Lasserre qui, subitement réveillé, pousse des hurlements qui me glacent. Pourvu que ce salaud ne s’occupe pas de moi. C’est qu’il vient vers moi ! Impassible, il palpe ma cuisse, énorme, violacée et maintenant indolore. Il va ensuite vers Faucheux. C’est encore plus rapide. Il s’éloigne en conférant avec Lebreton qui hoche gravement la tête. Apparemment, ils ne sont pas très optimistes. Le jour suivant, le docteur Lebreton revient avec une grande jeune fille brune. C’est sa belle-sœur, Edith Moquet. Edith et Mme Lemoigne de Bourbriac seront nos infirmières pendant deux mois.
Une jolie petite jeune fille brune, Yvette, nous apporte les nouvelles de l’extérieur. Les Allemands savent que des blessés du combat de Duault sont cachés par la population et les recherches activement avec des chiens policiers. Mais les curés des paroisses voisines ont recommandé en chaire le silence le plus absolu et cette consigne sera scrupuleusement suivie.
Vers le 15 juin, Robert se pointe à Kerchariou et, la morphine aidant, je suis suffisamment lucide pour faire avec lui le point de la situation. Elle n’est guère brillante. Robert, rejoint quelques jours plus tard par Thonnérieux, reste le seul parachutiste dans les Côtes-du-Nord, sans aucun moyen de liaison avec le reste du bataillon, ce qui est un élément plutôt favorable, ni avec la Grande-Bretagne, ce qui est très grave. Nos premiers contacts avec la Résistance nous ont quelque peu déroutés. Il nous semble que celle-ci est surtout animée par le Parti communiste qui possède une organisation bien structurée. Il a créé quelques groupes FTP, essentiellement à base de réfractaires au STO. Ceux-ci ont peu ou pas d’encadrement et aucun armement autre que celui enlevé aux Allemands. Ils survivent péniblement au moyen de réquisitions, parfois de rapines, ce qui n’est pas très bien vu de la population.
J’apprendrai par la suite qu’il existe d’autres organisations cohérentes et d’allégeance non communiste, mais pour l’heure, je ne parle que de ce que j’ai vu et seulement de ce que j’ai vu.
Malgré cette situation confuse, Robert reste optimiste :
— La base Samwest est détruite mais la mission reste puisque la Résistance existe. Je ne comprends rien à leurs histoires de FTP ou pas FTP, mais il y a un potentiel considérable à exploiter. Donc, si vous êtes d’accord, je reste.
Je ne puis qu’être d’accord…
En 1954, André Botella participera plus tard à la bataille de Diên Biên Phu comme commandant du 5e BVPN.







