Présentation du dossier 32 « Face aux ruptures, être prêt. »
Les lignes qui suivent visent à replacer l’article que vous allez lire dans le cadre général du prochain dossier du Cercle Maréchal Foch, « Face aux ruptures, être prêt ».
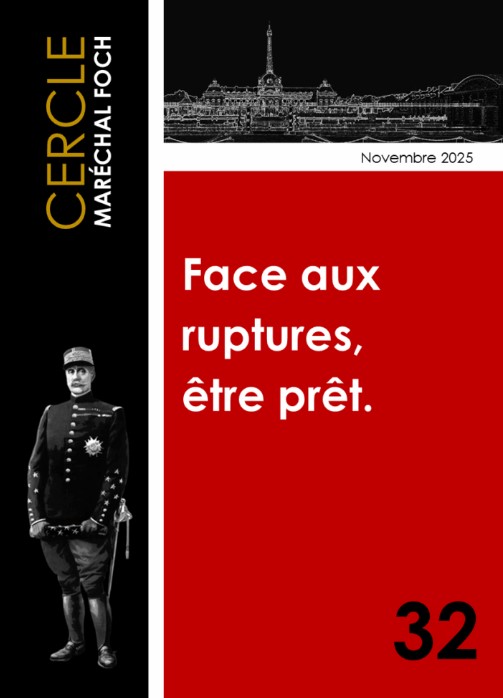 En effet, début 2025, le Cercle Maréchal Foch diffusait via THEATRUM BELLI son dossier de réflexion n° 31 « Le temps des ruptures ». S’appuyant sur le vote récent de la loi de programmation militaire 2024-30, le dossier prenait acte des nouvelles formes de conflictualité, du retour de la force désinhibée comme composante des relations interétatiques, du choc culturel que le retour de la guerre en Europe orientale constituait pour les populations « apaisées » de l’Union européenne, vivant dans un espace sans frontières, sans ennemi, sans idéologie collective…). On y évoquait les enjeux nationaux et internationaux, les défis technologiques et capacitaires, les questionnements éthiques et moraux qui découlaient de ce « changement d’époque ».
En effet, début 2025, le Cercle Maréchal Foch diffusait via THEATRUM BELLI son dossier de réflexion n° 31 « Le temps des ruptures ». S’appuyant sur le vote récent de la loi de programmation militaire 2024-30, le dossier prenait acte des nouvelles formes de conflictualité, du retour de la force désinhibée comme composante des relations interétatiques, du choc culturel que le retour de la guerre en Europe orientale constituait pour les populations « apaisées » de l’Union européenne, vivant dans un espace sans frontières, sans ennemi, sans idéologie collective…). On y évoquait les enjeux nationaux et internationaux, les défis technologiques et capacitaires, les questionnements éthiques et moraux qui découlaient de ce « changement d’époque ».
Un nouveau dossier, n° 32, est en cours de rédaction, intitulé « Face aux ruptures, être prêt ». Sans empiéter sur le rôle des organismes officiels et s’inspirant de la version 2025 de la revue nationale stratégique, il vise à dégager des principes généraux ou des orientations plus techniques qui pourraient soutenir les réflexions de tous ceux que le sujet de la défense nationale, dans le cadre européen, intéresse et, aujourd’hui, préoccupe. Ce dossier se refuse à un pessimisme qui encombre souvent les analyses de la situation actuelle et, en contrepoint de ce pessimisme du chemin à parcourir, entend mettre en avant un optimisme d’action et du but atteignable. Il entend cependant rester lucide et réaliste en s’appuyant sur l’expérience du passé, lointain comme plus récent…
Les allusions à « l’entre-deux guerres » étant nombreuses aujourd’hui, la première partie du dossier regroupera quelques éclairages sur les années 1935-1940. Il ne s’agit pas réécrire « L’étrange défaite » sans le talent de Marc Bloch, mais de choisir dans les prémices de la catastrophe de 1940 quelques instants où, avec le recul, il paraît incompréhensible qu’un voyant rouge ne se soit pas allumé sur le tableau de bord national, ou plutôt, s’étant allumé, pourquoi il fut si difficile de se préparer à l’épreuve qui s’annonçait.
Plus près de nous, la deuxième partie fait appel directement à nos rédacteurs, tous acteurs de la fin de guerre froide et de « la guerre mondiale de la France » pour reprendre le titre d’un livre récent de Michel Goya. À partir de la fin des années 1970, et surtout de 1990, les armées françaises (et l’on s’intéressera plus particulièrement à l’armée de Terre) ont été placées dans des situations opérationnelles imprévues, lointaines et exigeantes, dans un contexte de réduction de leurs moyens. De l’avis général, si les buts politiques furent loin d’être toujours atteints, les buts militaires le furent, avec plus ou moins de publicité, au prix d’efforts, y compris humains, souvent occultés. Cette partie récapitulera certains de ces efforts et permettra, nous l’espérons, de croire au « succès des armes de la France » pour les défis qui s’ouvrent désormais à nos armées.
La troisième partie se lancera dans l’exercice de la prévision dont on sait la difficulté, surtout, pour reprendre la boutade célèbre, lorsqu’elle traite de l’avenir. Il s’agira en fait d’un exercice de conviction de la part de rédacteurs qui, forts de leur expérience passée mais également de leur enracinement dans les réalités du moment, mettront sur la table « de la nourriture pour l’esprit », sans obligation de consommer !
Innovation majeure par rapport aux dossiers précédents, nous avons choisi de ne pas attendre d’avoir réuni l’ensemble des contributions de ce dossier n° 32 pour les mettre à la disposition de nos lecteurs. Elles seront publiées par THEATRUM BELLI au fur et à mesure de leur disponibilité, avant d’être réunies sous une forme complète. Vous trouverez donc ce rappel du but général et de l’articulation du dossier en tête de chaque publication, accompagné de l’indication de la partie à laquelle elle se rattache.
Si les conditions des engagements de l’armée française ont radicalement évolué depuis la bascule stratégique vers l’Est de l’Europe et la possibilité d’un affrontement majeur symétrique, des enseignements encore utiles peuvent être tirés de l’opération Barkhane, au Sahel.
Bref rappel
L’opération antiterroriste Barkhane au Sahel fut l’opération majeure des armées françaises de 2014 à 2022. Opération majeure par le volume des moyens engagés (4 à 5 000 hommes, 19 hélicoptères, 8 avions de chasse, 6 drones,…), par son caractère national, élargie à une participation européenne vers la fin, par sa dimension régionale sur cinq pays du Sahel, par son caractère politique, avec le rôle central reconnu à la France, la création du G5 Sahel1 à son instigation, mais aussi parce qu’elle a fortement orienté la préparation opérationnelle de l’armée de terre, de l’armée de l’air et des services interarmées. Opération d’exception par ses défis immenses, géographiques (zone d’action équivalente au territoire de l’Union Européenne), logistiques (élongations de milliers de kilomètres), matériels (un milieu fortement abrasif), humains bien sûr (climat usant, rythme soutenu, actions de combat fréquentes, harcèlement permanent par l’adversaire).

Quels enseignements en tirer ?
La stratégie.
L’état final recherché (EFR) militaire était clair : mettre les groupes armés terroristes à la portée des armées africaines engagées dans cette lutte. Cet EFR était raisonnable et atteignable à condition de faire preuve de patience stratégique. Il avait été clarifié pour ne retenir qu’un objectif de nature militaire, et non plus viser la stabilité politique des États sahéliens ou la mise en œuvre des accords de paix. Ces derniers relèvent des buts de guerre ou, puisque nous n’étions pas en guerre, des buts politiques de l’opération. L’opération devait créer les conditions militaires favorables pour atteindre ces buts politiques, qui étaient eux-mêmes assez bien définis : assurer la stabilité des États du Sahel, et tout particulièrement du Mali, faciliter le retour à la paix par la mise en œuvre des accords d’Alger, contribuer à la sécurité globale de notre pays et de l’Europe en interdisant la création d’un sanctuaire terroriste en Afrique, pour cela appuyer la lutte antiterroriste armée et développer le partenariat avec les pays africains.
La Force2 Barkhane a pourchassé, contraint et en partie détruit les groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne, mais elle a toujours su qu’il fallait en priorité traiter les racines du mal. Cela a été insuffisamment fait. Le volet politique n’a jamais concrètement démarré (statut du Nord du Mali, présence de l’État au Centre, forces armées maliennes reconstituées ayant intégré les combattants du Nord) et le volet développement n’a pas produit les effets escomptés.
Ainsi les populations n’ont pas vu le bénéfice de la présence prolongée de Barkhane, dont elles avaient en outre tendance à surestimer les capacités militaires. Celles de la zone de contact étaient plus mesurées, celles des villes « à l’arrière » et notamment Bamako beaucoup plus critiques, en particulier les jeunes.
Alors quelles leçons en tirer ? Comment déployer une stratégie d’ensemble efficace ?
Sur le plan politique, identifier et mettre en œuvre les moyens d’une pression efficace sur le gouvernement du pays à l’origine de la crise, sur les groupes armés qui peuvent être ralliés au processus de paix, et sur l’ensemble des partenaires internationaux. Les accords de paix sont par nature imparfaits, fruit d’un compromis, chaque partie devant cependant s’engager à les respecter.
Au plan de l’aide au développement, coordonner les initiatives avec l’action de la Force dont les activités CIMIC3, certes d’abord destinées à son acceptation locale, peuvent s’articuler avec des projets plus vastes. La Force apporte connaissance du terrain, des besoins locaux et protection.
Au plan opératif, intégrer les effets sur toute la gamme des actions militaires et civiles. Ce pourrait être la mission d’un commandement opératif à caractère interministériel, pour la zone d’opération. Dans le domaine militaire, transférer aux armées partenaires les missions de lutte armée antiterroriste, en combattant avec elles puis en se retirant progressivement, en maintenant un temps des appuis et des soutiens de supériorité opérationnelle, en accompagnant leurs projets réalistes, et en attirant le soutien politique et financier de nombreux bailleurs (UE, ONU, aide bilatérale).
Au Sahel, notre défaite stratégique provient, conjoncturellement, de coups d’État que nous n’avons pas vu venir ni su gérer, et qui ont rendu impossible la poursuite de l’opération. Une manœuvre d’influence principalement russe a attisé un sentiment anti-français que nous avons sans doute minimisé mais cela n’a pas été déterminant. Sans doute, nous militaires, avons-nous été trop confiants, n’avons-nous pas su évoluer à temps et développer une communication convaincante, sur place et vers notre opinion publique. Mais la cause profonde est un échec du volet politique de la résolution de la crise.
Contrairement à la situation géostratégique actuelle en Europe dans laquelle nous ne pouvons pas ne pas affronter nos compétiteurs et adversaires, au Sahel nous avons pu partir sans grand dommage, si ce n’est pour les populations locales. La patience stratégique, l’intégration des effets en interministériel, l’appréciation du moment où l’effort militaire devient contre-productif par rapport aux buts de guerre, semblent bien être les conditions d’un succès pérenne.

Capacité d’entraînement.
Barkhane était une Force d’entraînement, elle agissait et faisait agir. Force de réassurance pour les armées partenaires du G5, pression sur les terroristes, Force de confiance également pour les missions internationales militaires déployées au Mali, MINUSMA4 et EUTM5, Barkhane a agi en facilitateur, coordinateur, intégrateur. Elle a été capable d’attirer les Européens. Cela a un coût (en moyens, en volume de forces), crée des obligations, peut parfois limiter la liberté d’action, impose de prendre des risques et de s’engager jusqu’au combat. Cette même ambition anime l’armée de Terre aujourd’hui, symbolisée par la capacité de Corps d’Armée.
Plus qu’une opération militaire, Barkhane offrait à la France un levier d’influence exceptionnel, régional bien sûr mais bien au-delà, notamment par le rôle politico-militaire du Commandant de la force (COMANFOR) du fait de ses relations avec les ambassadeurs des cinq pays de la zone, les autorités politiques de ces pays ou encore les organisations internationales. Barkhane était la seule organisation régionale dans la bande sahélo-saharienne capable de fédérer les initiatives militaires nationales et celles de nos alliés, au premier rang desquels les Européens. Ce rôle singulier d’entraînement d’abord militaire mais plus largement politico-militaire lui était reconnu et a permis une manœuvre d’influence auprès des partenaires nationaux ou internationaux, qui, très nombreux, souhaitaient rencontrer Barkhane lorsqu’ils venaient au Sahel .
Aujourd’hui, les armées françaises sont encore capables d’entraîner comme le manifeste le leadership pris avec les Britanniques sur la préparation des mesures militaires post cessez-le-feu en Ukraine, grâce à leur crédibilité et à la volonté politique de nos dirigeants.
La communication stratégique à l’épreuve de la durée.
Sur place, notre cible de communication était les populations locales, afin de donner confiance en Barkhane, mais surtout en leurs armées nationales, et briser l’attrait des groupes armés terroristes. En France, l’objectif était de convaincre de la nécessité, de l’utilité et du succès de l’opération. Les résultats ont été mitigés et le soutien de l’opinion française s’est affaibli. Toute opération lointaine qui dure est condamnée à voir le soutien s’éroder.
Hélas, depuis le départ de Barkhane, la preuve par l’absence valide l’efficacité de l’opération : la progression des groupes armés terroristes est constante, la faiblesse des armées des trois pays du centre de la zone est confirmée et aucune solution politique ne se dessine.

Verticalité du commandement opérationnel et commandement dans l’immensité.
Notre organisation nationale de défense a permis, au Sahel, un alignement politico-militaire, du chef des armées jusqu’au chef de section. En contact avec le président de la République, rarement, le COMANFOR avait pour objectif de vérifier que son action était en ligne avec la volonté politique, avec le CEMA au moment des bascules de la mission et surtout au quotidien avec le CPCO6. Cette verticalité est notre trésor, tout doit être fait pour la préserver.
En bande sahélo-saharienne, il s’agissait de commander dans l’immensité, les contacts physiques n’étaient pas fréquents ; il fallait donc pour le COMANFOR se déplacer sans cesse pour transmettre l’esprit de la mission (la lettre était donnée par l’état-major) et connaître ses unités, leurs forces et leurs limites, entretenant un contact direct de chef à chef. Dans les engagements potentiels des forces terrestres où la dispersion sera la règle, le chef doit avant tout donner au subordonné son intention et entretenir une relation personnelle avec lui.
Le soutien au service de l’opérationnel.
Davantage encore qu’interarmées, Barkhane était une opération intégrée, toutes les fonctions opérationnelles, y compris de soutien, étaient guidées par le succès de la mission. Condition de l’efficacité opérationnelle, et d’abord de la protection de nos forces, cet alignement contribuait directement au moral élevé de la Force, « les choses sont claires » et « nous sommes tous des combattants ». L’organisation matricielle du temps de paix n’a évidemment pas sa place en opérations. D’ailleurs à Barkhane, les plus exposés étaient les logisticiens.
Les évolutions récentes des relations entre forces et soutiens vont dans le bon sens, tant il est impérieux de rapprocher le fonctionnement temps de paix, temps de guerre pour être « prêt à » en permanence.

L’adaptation permanente.
Les défis pour Barkhane n’ont pu être relevés que parce que nos unités, appuyées sur un fort capital opérationnel, fruit d’années d’engagement en OPEX, ont adopté un esprit d’adaptation permanente. La Force était contrainte d’inventer en permanence, l’ennemi s’adaptant très vite et la Force agissant successivement dans des zones différentes. Le Sahel a été considéré et utilisé comme un laboratoire pour nos forces, pour inventer sans cesse de nouveaux modes d’action, nécessairement intégrés. Barkhane fut une guerre « des colonels et des capitaines », ils en étaient capables et demandeurs. Cet état d’esprit doit être inculqué dès la préparation opérationnelle, ce qui demeure un vrai défi
Cet impératif d’innovation est décuplé pour les armées aujourd’hui du fait de la disparition du « confort opératif » dans lequel agissait Barkhane. L’organique ne doit jamais freiner l’innovation, ce ne sont pas les structures du temps de paix qui commandent celles de l’engagement. L’innovation naît de la contrainte, de l’insatisfaction, voire de l’échec en opération. Dans une période où les opérations se font plus rares, il s’agit de conserver cet allant via la préparation opérationnelle, les échanges avec des combattants des guerres actuelles ou encore un commandement qui valorise l’initiative.
La qualité des combattants.
Ni saints, ni héros, les hommes et les femmes de Barkhane se sont révélés à la hauteur. Les mandats étaient très rudes, et poussaient souvent les forces à leur limite, notamment au plan moral. Le rôle premier des chefs est d’entretenir et de veiller sur cette force morale.
Un point de vigilance à l’époque était la jeunesse tant des cadres, certes expérimentés opérationnellement, que de la troupe, confrontés au retour du combat dans des conditions très rudes. Cela nécessite du temps de formation, une grande solidité physique, une maturité et une armature morale et psychologique qui n’est jamais acquise pour toujours.

Partenariat militaire opérationnel7.
Cette expression a fait florès à partir de Barkhane, ce mode d’action correspondant très exactement à l’EFR militaire. Ce partenariat demande de la patience, une structuration de la Force différente selon ses différents stades : former, entraîner, accompagner ou encore combattre avec. Il est facilité par l’apport de capacités militaires structurantes (renseignement, appui aérien, logistique, etc..) et doit être maîtrisé en termes de protection de la Force. Il nécessite de faire preuve d’ouverture d’esprit, voire d’humilité, confiance et engagement réciproques, d’abord au niveau politique. Enfin, c’est un domaine qui se prête fort bien à la coopération multinationale, voire à la sous-traitance, en fonction des niveaux et domaines de partenariat.
Au bilan, Barkhane, succès militaire, tactique, voire opératif, échec stratégique : c’est la leçon majeure à laquelle les armées, familières d’un RETEX8 sans concession, doivent réfléchir. Pour peser, encore davantage aujourd’hui, la force est indispensable. Il faut être en mesure d’en faire la démonstration. Elle doit être en strict alignement avec les buts de guerre fixés par le politique, et autant que faire se peut, soutenue par l’opinion.
Pour certains, la fin de l’opération Barkhane sonnerait la fin des OPEX ; en la matière, l’histoire nous invite à la prudence.
Général de Corps d’armée (2S) Xavier de Woillemont, ancien commandant de l’opération Barkhane

NOTES :
- Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad
- Le terme « Force », avec une majuscule, désigne dans ce texte la Force Barkhane. L’auteur utilise indifféremment les termes « Force » et « Barkhane » pour désigner les moyens militaires engagés dans « L’opération Barkhane ».
- CIMIC, Civil Military Cooperation (le terme français est ACM, actions civilo-militaires)
- Mission multidimentionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. La MINUSMA perdit 311 casques bleus (dont deux français) entre 2013 et 2023.
- European Union Training Mission / Mali.
- Centre de planification et de conduite des opérations, à Paris.
- Le partenariat militaire opérationnel (PMO) peut s’inscrire dans un cadre bilatéral, multilatéral ou multi-bilatéral. Il consiste à effectuer avec les forces partenaires tout ou partie des actions suivantes : conseiller, former, entraîner, équiper, accompagner militairement et combattre au sein d’opérations conjointes.
- RETEX, retour d’expérience.







Intéressant, mais c’est aussi une nouvelle demonstration que faire la guerre à la place des principaux intéressés ne mène à rien. En point godwin 2eme guerre mondiale, l’armée française qui avait guerroyé constamment les années précédentes n’en a pas tiré pour autant un benefice évident lorsque les operations en Europe se sont déclenchées (sans remonter à l’expedition du Mexique et la guerre de 70). Au final , oui une expérience grandeur nature qui a permis d’aguerrir une generation, de roder des procédures . Mais compte tenu du cadre très (trop) spécifique, le retex n’est pas forcement adapté s’il fallait affronter une armée type Russe par exemple.