Le courage du guerrier
Les guerriers germains n’ont jamais entendu parler de la défaite de l’ours devant le rhinocéros chantée par le poète Martial. Pendant plusieurs siècles encore, comme ils le font depuis des temps immémoriaux, ils continuent de vouer à l’ours une admiration extrême. Pour eux, plus que tout autre être vivant, cet animal presque invincible incarne la vigueur et la puissance. C’est pourquoi ils cherchent à se comparer à lui, à l’affronter, à le vaincre, à s’investir de ses forces, à en faire tout à la fois leur emblème et leur ancêtre. Chez les Germains, l’ours est bien plus que le roi de la forêt ou du bestiaire : c’est l’animal totémique par excellence.
Pour les jeunes gens, par exemple, combattre et tuer un ours représente le passage obligé pour accéder au monde des guerriers adultes. Plus qu’une cérémonie liée à la chasse, c’est un rituel initiatique qui se termine par un corps à corps entre l’homme et la bête. Le premier ne dispose que de son poignard pour venir à bout de l’animal qui cherche à l’écraser contre son poitrail au moyen de ses pattes antérieures, dont il se sert comme d’un étau. Le jeune guerrier doit éviter d’être étouffé, assommé ou lacéré, mais c’est néanmoins en se laissant enserrer au plus près du fauve qu’il parviendra à enfoncer son arme dans le ventre de son adversaire. L’ours contribue ainsi à sa propre mort en serrant contre lui le jeune guerrier précédé de son poignard. Mais bien souvent ce dernier meurt suffoqué avant même d’avoir pu faire pénétrer la pointe de son arme sous la peau de l’énorme bête.
Tacite ne parle pas de ce rituel dans son célèbre essai consacré aux peuples de Germanie, achevé à la fin du Ier siècle de notre ère. Mais trois siècles plus tard, dans ses Histoires, compilées à l’horizon des années 370-380, l’historien et sénateur romain Ammien Marcellin rapporte comment chez les Goths les jeunes gens doivent pareillement affronter et vaincre un ours (et un sanglier) avant d’intégrer la communauté des hommes adultes. Plus tard, différentes sagas et quelques textes narratifs rédigés en Islande ou en Scandinavie font allusion à des rituels semblables. Dans ses Gesta Danorum, par exemple, qui retracent l’histoire du peuple danois des origines à la fin du XIIe siècle, le grand érudit Saxo Grammaticus (vers 1150 – vers 1215 / 1220) raconte comment un tout jeune homme nommé Skioldius, au cours d’une chasse à l’ours, dut ainsi affronter à mains nues, sans arme aucune, un ours gigantesque ; malgré ce handicap, il parvint à immobiliser l’animal, à le lier avec sa seule ceinture puis à le conduire vers les autres chasseurs qui le mirent à mort. Cette prouesse fit de lui un guerrier adulte et respecté, et le souvenir de cet événement glorieux l’aida plus tard à monter sur le trône pour devenir le quatrième roi du Danemark.
Réel ou légendaire, l’exploit du jeune Skioldius se situe avant l’an mille, lorsque la Scandinavie était encore païenne. Toutefois, longtemps encore après la christianisation vaincre un ours en combat singulier demeura chez les jeunes nobles d’Allemagne du Nord et de Norvège une marque de courage et un signe de qualités guerrières hors du commun. Une victoire sur le fauve promettait souvent au vainqueur un destin de chef ou de roi. Nombre de chroniques et textes littéraires nous ont transmis l’exemple de tel ou tel héros qui, après avoir vaincu un ours, a pris en main l’avenir de son peuple et de son lignage et l’a conduit vers la gloire. Mais tous ne sont pas des personnages de fiction : quelques grandes figures bien réelles de l’époque féodale passent ainsi pour avoir vaincu un ours dans leur jeunesse et, par ce fait d’armes, avoir été remarquées de leurs aînés ou de leurs pairs. De tels récits, hérités des sociétés germano-scandinaves de l’Antiquité et du haut Moyen Âge, ne se rencontrent pas seulement en Allemagne, au Danemark ou en Islande ; ils circulent aussi en Écosse, en Angleterre, en France et même en Terre sainte, montrant de ce fait combien la culture médiévale chrétienne, fille de la Bible et du monde gréco-romain, est également longtemps restée imprégnée des traditions « barbares ». Un exemple souvent cité est celui de Baudouin Bras-de-Fer, premier « comte » de Flandre (mort vers 878) : tout jeune encore, vers le milieu du IXe siècle, il fut victorieux d’un ours qui terrifiait la région de Bruges, exploit qui le fit remarquer du roi Charles le Chauve, dont il devint à la fois le gendre et le vassal. Cependant, l’exemple médiéval le plus célèbre n’est pas celui de Baudouin Bras-de-Fer mais celui, plus récent, de Godefroi de Bouillon.
L’épisode se situe pendant la première croisade, au printemps 1099, quelques semaines avant la prise de Jérusalem par les croisés. Godefroi, duc de Basse-Lorraine puis de Bouillon, n’est encore qu’un chef de la croisade parmi d’autres. Il est venu en Terre sainte avec ses deux frères, Eustache et Baudouin de Boulogne, à la tête d’un important contingent de croisés originaires de Flandre, du Hainaut, du Brabant et des régions mosanes. Depuis deux ans, dans la lutte des Francs contre les musulmans, il s’est signalé par de nombreux exploits, notamment lors de la prise de Nicée en juin 1097. Mais, plus que ses succès contre les ennemis de la foi chrétienne, c’est sa victoire contre un ours qui fit définitivement de lui le chef unique de la croisade, puis l’avoué du Saint-Sépulcre de Jérusalem et enfin, après sa mort, un véritable personnage de légende, presque un saint. Le chroniqueur Albert d’Aix, chanoine d’Aix-la-Chapelle, est le premier à nous avoir laissé un récit détaillé du combat entre le duc et le fauve. Godefroi chevauchait solitaire dans un bois lorsqu’il vit un ours d’une taille démesurée, aux dents et aux griffes acérées d’une longueur exceptionnelle, qui était en train d’agresser un pèlerin. Il porta aussitôt secours au malheureux et affronta l’énorme bête. L’ours s’attaqua d’abord au cheval, qui fut rapidement tué et déchiqueté ; puis il se jeta sur le cavalier tombé à terre et armé de sa seule épée. Un violent corps à corps s’engagea qui dura un temps considérable : tour à tour le fauve et le duc prirent l’avantage. Finalement, Godefroi réussit à blesser mortellement l’ours à la tête et au cou ; mais il sentait ses forces décliner et allait périr étouffé par le monstre agonisant, qui le serrait dans ses pattes antérieures, lorsqu’un de ses compagnons nommé Huschin, attiré par l’épouvantable fracas, arriva et délivra le duc des membres meurtriers de la bête. Les deux hommes achevèrent l’ours, « le plus grand, le plus féroce et le plus redoutable » qu’on eut jamais vu.
Le récit d’Albert d’Aix, rédigé vers 1120-1130 puis repris par plusieurs chroniqueurs des XIIe et XIIIe siècles, notamment par Guillaume de Tyr, n’est évidemment qu’une suite de clichés visant à mettre en valeur le courage et la prouesse de Godefroi. Qu’il ne soit pas complètement parvenu à vaincre seul l’énorme animal ajoute une touche de vérité et d’humanité à l’histoire et rend encore plus crédible l’exploit du héros, mais cela ne modifie guère la longue accumulation de poncifs que constitue la minutieuse description du combat, destinée à souligner les qualités hors du commun du vainqueur. Quelques semaines plus tard, en effet, au lendemain de la prise de Jérusalem, le 15 juillet 1099, Godefroi est élu par les principaux chefs de la croisade roi du nouvel État franc de Terre sainte. Mais il s’estime indigne d’un tel titre et prend celui de simple « avoué du Saint-Sépulcre ». Il meurt peu après, au printemps 1100. Dès lors, historiens et chroniqueurs multiplient ses faits d’armes, avant et pendant la croisade, et mettent en valeur sa vaillance, sa générosité et son extrême piété afin d’en faire l’image du parfait chevalier chrétien. Ce qui lui vaut, au XIVe siècle, de prendre place dans la série exemplaire des « Neuf Preux » et de devenir, aux côtés de Charlemagne et du roi Arthur, l’un des trois preux chrétiens. Étonnante postérité pour un prince qui n’était qu’un cadet dans son lignage mais que la légende a mis sur un pied d’égalité avec le grand empereur d’Occident et avec le prestigieux souverain des littératures médiévales.
La réalité historique est évidemment quelque peu différente des traditions légendaires et littéraires. Le vrai Godefroi de Bouillon était peut-être un homme d’une piété sincère et d’une force physique remarquable, mais c’était aussi et surtout un chef hésitant, un guerrier brutal et un médiocre politique. En outre, le combat victorieux contre l’ours, sur lequel insistent ses premiers biographes et la plupart des historiens de la croisade, n’a sans doute jamais eu lieu. Mais l’épisode était nécessaire pour distinguer le duc de Bouillon des autres chefs francs afin d’en faire le premier « roi » de Jérusalem. Son exploit, en effet, ne s’inscrit pas seulement dans la tradition germanique du combat singulier entre le chef et l’ours ; il fait aussi écho au célèbre passage biblique qui raconte comment le jeune David, encore berger, a victorieusement défendu ses brebis contre un ours et un lion redoutables qui cherchaient à décimer son troupeau (1 Samuel 17, 34). Victorieux du fauve, Godefroi apparaissait comme un nouveau David. On peut du reste observer que dans certaines chroniques tardives, compilées aux XIVe et XVe siècles, à une époque où la victoire sur un ours n’était plus guère un fait d’armes remarquable pour un roi ou un chevalier chrétien, le récit de l’épisode n’opposait plus Godefroi à un ours mais à un lion.
 Les « Berserkir »
Les « Berserkir »
L’exploit de Godefroi de Bouillon, même s’il n’est pas le plus ancien, constitue une sorte de modèle que l’on retrouve pendant plusieurs décennies dans les chroniques, Les chansons de geste et les romans de chevalerie. La liste est longue des héros littéraires ou légendaires qui, tout au long du mie siècle, ont affronté et vaincu un ours ou un monstre ursin, à commencer par les plus grands : Roland, Tristan, Lancelot, Yvain, le roi Arthur lui-même. Mais ce rituel obligé est désormais christianisé et il n’a presque rien conservé de la transe sauvage qui, dans les traditions germaniques païennes, habitait les guerriers affrontant le fauve. Plusieurs sagas ou poèmes épiques, certains textes narratifs et mythologiques et quelques témoignages iconographiques nous ont transmis le souvenir des différentes pratiques par lesquelles ces guerriers, avant ou après le combat, cherchaient à s’investir des forces de La bête. Elles ne pouvaient en effet que terrifier les évêques et les clercs qui, dès la christianisation des régions concernées, ont tout fait pour y mettre fin.
La plus sauvage de ces pratiques consistait à boire le sang de l’animal et à manger sa chair, sorte de repas rituel, d’essence fortement totémique (au sens que les anthropologues donnent à ce terme), qui contribuait symboliquement à transformer le guerrier en ours, à le doter des forces du fauve et, par là même, à le rendre invincible. Une version ancienne du Landnàmabok, ou « Livre de la colonisation de l’Islande », raconte par exemple comment un certain Odd s’attaqua à un ours colossal qui avait tué son père et son frère, l’abattit, le dépeça, mangea toute sa chair et, ce faisant, se transforma lui-même en une sorte d’être indomptable, mi-homme mi-animal ; par esprit de vengeance, il chercha jusqu’à sa mort à tuer le plus grand nombre d’ours. Plus tard, à la fin du XIIe siècle, Saxo Grammaticus, compilant des extraits de différentes sagas, explique comment « certains anciens guerriers danois » avaient coutume de boire le sang des ours qu’ils avaient vaincus pour devenir aussi redoutables que les fauves ; il précise même qu’un bain dans le sang de l’animal pouvait accompagner ou remplacer la boisson sanglante. Dans la Chanson des Nibelungen, rédigée dans sa forme définitive dans les années 1200, Siegfried ne procède guère autrement lorsqu’il se baigne dans le sang du dragon qu’il vient de tuer, et recouvre ainsi son corps d’une sorte d’enveloppe le rendant invulnérable ; malheureusement, pendant le bain, une feuille de tilleul tombe entre ses épaules, et c’est là que le traître Hagen parvient à le tuer d’un coup d’épée.
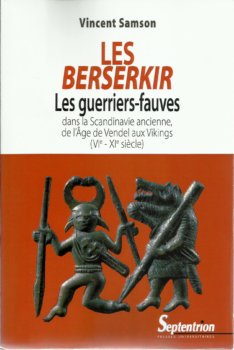 Dès l’époque carolingienne, les prélats de Germanie interdirent la consommation de viande d’ours, qui relevait par trop des usages païens. Mais la répétition de ces interdits, qui après l’an mille s’étendirent au monde scandinave, prouve qu’ils n’étaient guère respectés. Vers la fin du mie siècle encore, la grande abbesse Hildegarde de Bingen, dont les préoccupations étaient à la fois mystiques, morales et médicales, notait combien il était dangereux de consommer la chair de l’ours : « c’est une viande impure qui échauffe les sens, conduit au péché et peut entraîner la mort ». On peut cependant imaginer que, progressivement, l’absorption rituelle de sang d’ours finit par ne plus avoir cours en terre chrétienne et qu’à l’époque féodale, en Allemagne comme au Danemark, le fait de manger la viande de l’animal n’était plus qu’une simple coutume, débarrassée de toute dimension totémique, sauvage ou sanguinaire. À la table des seigneurs, à la fin du Moyen Âge, manger de l’ours restait en plusieurs régions, pas seulement septentrionales, une habitude aristocratique. Dans plusieurs vallées du Tyrol et du Piémont, par exemple, les communautés villageoises devaient fournir chaque année à leur seigneur un certain nombre de pattes d’ours (le meilleur morceau), que celui-ci, dans une sorte de repas symbolique, mangeait publiquement. Il s’agit là du dernier reliquat de pratiques ancestrales plus ou moins vidées de leur sens, mais aussi d’un témoignage important sur la lutte qui, à cette date encore, en pays de montagne, continuait d’être menée contre l’ours et d’associer pour ce faire seigneurs et paysans.
Dès l’époque carolingienne, les prélats de Germanie interdirent la consommation de viande d’ours, qui relevait par trop des usages païens. Mais la répétition de ces interdits, qui après l’an mille s’étendirent au monde scandinave, prouve qu’ils n’étaient guère respectés. Vers la fin du mie siècle encore, la grande abbesse Hildegarde de Bingen, dont les préoccupations étaient à la fois mystiques, morales et médicales, notait combien il était dangereux de consommer la chair de l’ours : « c’est une viande impure qui échauffe les sens, conduit au péché et peut entraîner la mort ». On peut cependant imaginer que, progressivement, l’absorption rituelle de sang d’ours finit par ne plus avoir cours en terre chrétienne et qu’à l’époque féodale, en Allemagne comme au Danemark, le fait de manger la viande de l’animal n’était plus qu’une simple coutume, débarrassée de toute dimension totémique, sauvage ou sanguinaire. À la table des seigneurs, à la fin du Moyen Âge, manger de l’ours restait en plusieurs régions, pas seulement septentrionales, une habitude aristocratique. Dans plusieurs vallées du Tyrol et du Piémont, par exemple, les communautés villageoises devaient fournir chaque année à leur seigneur un certain nombre de pattes d’ours (le meilleur morceau), que celui-ci, dans une sorte de repas symbolique, mangeait publiquement. Il s’agit là du dernier reliquat de pratiques ancestrales plus ou moins vidées de leur sens, mais aussi d’un témoignage important sur la lutte qui, à cette date encore, en pays de montagne, continuait d’être menée contre l’ours et d’associer pour ce faire seigneurs et paysans.
Revenons cependant en arrière, chez les anciens Scandinaves, dont le rituel ursin le plus célèbre, et sans doute le plus fréquent, n’est pas la consommation de la chair ou du sang de l’animal mais le déguisement au moyen de sa peau. Les sagas et les récits de la mythologie nordique mettent en effet en scène des guerriers qui partent au combat revêtus de la peau du fauve qu’ils ont tué. C’est ce vêtement pileux qui les investit des pouvoirs de la bête, les protège de l’adversité et leur donne une vigueur incomparable. Parmi ces guerriers, les plus redoutables sont les fameux Berserkir, soldats d’Odin, principale divinité du panthéon nordique, dieu cruel, fourbe, cynique, secret mais omniscient. Le grand écrivain islandais Snorri Sturluson, dans son Ynglinga Saga, rédigée vers 1220-1230 et constituant la première partie de son immense Heimskringla Saga, est sans doute l’auteur qui a le mieux décrit ces Berserkir : « Ils partent nus au combat, sans armure ni cuirasse, simplement revêtus d’une chemise d’ours, enragés comme des fauves, mordant leur bouclier, tuant tout sur leur passage, massacrant bêtes et hommes ; ni le fer ni le feu ne peuvent rien contre eux, ils sont invincibles. »
 Snorri Sturluson n’est pas le seul à peindre la fureur combative de ces jeunes guerriers odiniques. Leur existence est mentionnée dès le axe siècle et, jusqu’au XIIIe, plusieurs textes insistent sur leur nature semi-bestiale et sur la transe sauvage qui les habite. Quelques documents figurés les représentent. On peut ainsi reconnaître trois Berserkir parmi les célèbres pièces d’échecs en ivoire de morse, taillées en Norvège vers le milieu du XIIe siècle, trouvées dans le sable des dunes de l’île de Lewis, au large de la côte occidentale écossaise, et aujourd’hui conservées au British Museum : il s’agit de trois pions-soldats, vêtus d’une longue tunique pileuse et représentés dans un tel état de rage qu’ils mordent leur écu. Comme tous les Berserkir, ce sont des garous ; non pas des loups-garous, comme on en rencontrera plus tard quelques-uns dans la littérature courtoise, mais des « ours-garous », propres au monde nordique et germanique. Plusieurs auteurs précisent que les Berserkir partent au combat en imitant la marche et les grognements de l’ours ; d’autres, qu’ils mangent de la chair humaine ; d’autres encore, qu’ils se sont métamorphosés en ours au cours d’une cérémonie magico-religieuse : cris, chants, danses, potions, drogues les ont placés dans un état d’excitation frénétique, proche de la possession. Ils se sentent transformés en fauves, perdent toute notion sociale, atteignent un degré extrême de sauvagerie et d’agressivité et ne connaissent plus ni la peur ni la pitié. Comme l’ours, ils sont ou se sentent invulnérables. Parfois, dans cet état de transe, ils s’imaginent avoir pour ancêtre un ours dont ils invoquent la mémoire et à qui ils demandent courage et protection. Pour décrire ce même état, quelques auteurs qualifient les jeunes guerriers odiniques non pas de « chemises d’ours » (Berserkir) mais de « pelisses de loup » (Ulfhednir), car c’est revêtus de la peau de cet animal qu’ils entrent en transe et partent au combat. Toutefois, cela est plus rare, le loup étant dans les cultures païennes de l’Europe du Nord un animal particulièrement négatif, à la fois lâche, immonde et impitoyable.
Snorri Sturluson n’est pas le seul à peindre la fureur combative de ces jeunes guerriers odiniques. Leur existence est mentionnée dès le axe siècle et, jusqu’au XIIIe, plusieurs textes insistent sur leur nature semi-bestiale et sur la transe sauvage qui les habite. Quelques documents figurés les représentent. On peut ainsi reconnaître trois Berserkir parmi les célèbres pièces d’échecs en ivoire de morse, taillées en Norvège vers le milieu du XIIe siècle, trouvées dans le sable des dunes de l’île de Lewis, au large de la côte occidentale écossaise, et aujourd’hui conservées au British Museum : il s’agit de trois pions-soldats, vêtus d’une longue tunique pileuse et représentés dans un tel état de rage qu’ils mordent leur écu. Comme tous les Berserkir, ce sont des garous ; non pas des loups-garous, comme on en rencontrera plus tard quelques-uns dans la littérature courtoise, mais des « ours-garous », propres au monde nordique et germanique. Plusieurs auteurs précisent que les Berserkir partent au combat en imitant la marche et les grognements de l’ours ; d’autres, qu’ils mangent de la chair humaine ; d’autres encore, qu’ils se sont métamorphosés en ours au cours d’une cérémonie magico-religieuse : cris, chants, danses, potions, drogues les ont placés dans un état d’excitation frénétique, proche de la possession. Ils se sentent transformés en fauves, perdent toute notion sociale, atteignent un degré extrême de sauvagerie et d’agressivité et ne connaissent plus ni la peur ni la pitié. Comme l’ours, ils sont ou se sentent invulnérables. Parfois, dans cet état de transe, ils s’imaginent avoir pour ancêtre un ours dont ils invoquent la mémoire et à qui ils demandent courage et protection. Pour décrire ce même état, quelques auteurs qualifient les jeunes guerriers odiniques non pas de « chemises d’ours » (Berserkir) mais de « pelisses de loup » (Ulfhednir), car c’est revêtus de la peau de cet animal qu’ils entrent en transe et partent au combat. Toutefois, cela est plus rare, le loup étant dans les cultures païennes de l’Europe du Nord un animal particulièrement négatif, à la fois lâche, immonde et impitoyable.
De tels rituels guerriers doivent être rapprochés des pratiques chamaniques qui, pour des périodes plus récentes, sont bien attestées chez plusieurs peuples chasseurs des régions septentrionales de l’Asie et de l’Amérique. Ces peuples croient aux esprits animaux, notamment à l’ours, à la fois ancêtre et totem. Afin d’entrer en contact avec ces esprits et d’en obtenir protection et faveurs, les chamans se livrent à différents rituels incluant l’extase et la transe : ils revêtent notamment la peau de l’animal concerné, se comportent et crient comme lui, entament des danses frénétiques, entrent dans un état voisin de la possession, quittent leur nature humaine et finissent par atteindre le monde des esprits. Au cours de ce voyage dans l’au-delà, ils se libèrent presque totalement des contingences physiques, exactement comme le faisaient les Berserkir.
Les pouvoirs du nom
Il existe chez les anciens Germains et Scandinaves d’autres usages, plus paisibles et mieux documentés, qui mettent en valeur les liens unissant l’ours et le guerrier. Ainsi ce lui qui consiste à porter sur soi des canines ou des griffes d’ours, talismans dont se servaient déjà les hommes du Paléolithique. Ou bien – et surtout – l’habitude d’utiliser au combat des enseignes, des armes et des armures ornées d’une image d’ours, dont la fonction n’est évidemment pas décorative mais tutélaire, à la fois emblématique et prophylactique. Certes, l’ours n’est pas le seul animal sollicité pour ce faire. D’autres figures animales disent l’identité du groupe ou du clan, parfois celle du guerrier ; elles évoquent l’animal-totem, suscitent sa protection, captent ses forces, effraient l’adversaire. Le bestiaire en est restreint : corbeau, aigle, cerf, sanglier, ours ; plus rarement : loup, cheval, taureau, faucon, lion, panthère, dragon et griffon. La présence de ces quatre derniers animaux ainsi que la stylisation extrême des motifs ou des scènes montrent combien cette insignologie guerrière de l’Europe du Nord a de bonne heure été influencée par l’art des steppes, venu d’Asie centrale et de Sibérie jusqu’en Occident sans passer par le moule réducteur des arts romain ou byzantin.
L’ours occupe dans ce bestiaire la place centrale. Il se rencontre aussi bien sur les enseignes, les casques et les épées que sur les boucles de ceinture et les plaques métalliques renforçant la cuirasse ou l’armure. Il est en revanche plus rare sur les fibules et absent des broches et des bijoux. Son rôle est nettement militaire. Au reste, l’archéologie n’a jamais mis au jour un bijou de femme ou un accessoire du costume féminin orné d’un ours. Pour les époques antérieures à la christianisation, l’essentiel de notre information vient de l’abondant matériel funéraire retrouvé dans les tombes. Le décor des différents objets montre des ours entiers ou à mi-corps : tantôt ils sont représentés seuls, tantôt ils accompagnent ou encadrent un guerrier, comme sur la célèbre plaque de Torslunda, trouvée dans l’île de Öland, au coeur de la mer Baltique, et datant probablement de la fin du vie siècle de notre ère. Les deux ours sont bien reconnaissables. Au reste, ce sont toujours les mêmes attributs qui permettent d’identifier l’animal : pilosité bien marquée, queue courte, oreilles petites et arrondies, attitude agressive, pattes énormes. L’ours est l’image du guerrier. Mieux : il est le guerrier lui-même, qui a décoré ses armes et son armure de l’image du fauve afin de s’emparer de son nom, de son apparence, de son courage et de sa vigueur. Dans les sagas, où les récits de rêve sont fréquents, il n’est pas rare qu’un chef ou un héros voie en songe un ours qui l’avertit des dangers le menaçant ; ou bien que cet ours soit l’image d’un ancêtre disparu et protecteur ; ou encore que ce soit le héros lui-même qui prenne dans le rêve l’aspect d’un ours pour affronter ses ennemis, en général figurés par un loup. Témoignages narratifs et pratiques insignologiques se rejoignent ici pour souligner l’osmose parfaite entre l’ours et le guerrier.
L’anthroponymie n’est pas en reste qui, peut-être plus encore que l’archéologie, l’iconographie ou la littérature, nous fait sentir la dimension magique de cette osmose. Porter un nom construit sur celui de l’ours, c’est se métamorphoser en cet animal et bénéficier de tous les pouvoirs qui l’habitent. Toutefois, ici encore, il faut préciser que l’ours n’est pas le seul animal sollicité : chez les peuples germano-scandinaves, les noms de personnes empruntés à la faune sont nombreux, peut-être plus que dans toute autre société européenne. Six animaux sont particulièrement concernés : d’abord le corbeau, attribut d’Odin, premier dieu du panthéon nordique ; puis l’ours et le sanglier, modèles de courage et de force indomptables ; enfin, pour des raisons diverses, le cerf, l’aigle et le loup… Toutefois, en Allemagne du Nord et en Scandinavie, c’est probablement l’ours qui est le plus fréquent. Innombrables sont en effet les noms simples ou composés articulés autour des racines Ber, Bern, Bero, Bera, Born, Beorn, Per, Pern, Björn, etc., toutes formes qui renvoient au nom de l’ours – à quelques exceptions près, ce sont tous des noms masculins. Au reste, le dieu de la guerre lui-même, Thor, a reçu de bonne heure pour surnom le nom commun donné à l’ours en vieux norrois : bjiirn (Thorbiërn); dans l’Europe du Nord, le dieu des guerriers, de la foudre et du tonnerre est un dieu pleinement ursin.
Après la christianisation, certains de ces noms païens deviennent des noms de baptême et prennent une forme latine Adalbero, Ansperus, Asbornus, Bernardus, Bernuardus, Bernhelmis, Gerbernus, Osbernus, Perngerus, Reinbernits, Torbiornus ; et ce, malgré l’opposition de nombreux évêques, qui, jusqu’à la fin de l’époque carolingienne en Allemagne, jusqu’au XIIè siècle en Scandinavie, souhaitent que les nouveaux baptisés adoptent un nom d’apôtre ou de grand saint plutôt que de conserver un nom « qui évoque les animaux féroces, la violence, le sang et la guerre ». Peine perdue. La plupart de ces noms se maintiendront et deviendront même parfois ceux de très grands personnages au service de l’Église, comme l’archevêque de Reims Adalbéron (t 988) ou l’évêque d’Hildesheim Bernward (t 1022). Sans parler de l’immense saint Bernard (1091-1153), qui dénonça à plusieurs reprises la présence des bêtes fauves – peintes ou sculptées – dans les églises monastiques alors que lui-même portait un nom signifiant « fort comme un ours ». Un nom guerrier peut-être trop difficile à assumer pour l’austère, savant et vétilleux abbé de Clairvaux ?
Dans les langues germaniques, en effet, le nom de l’ours (en allemand Bär, longtemps écrit Beer) sonne comme un nom plein de force et de violence. Il doit être rapproché de celui du sanglier (Eber), son cousin et rival dans la symbolique animale, mais aussi du mot qui désigne le seigneur ou le chef de guerre, Baro, Bero, qui a donné l’ancien français ber, conservé en français moderne sous la forme du cas régime : baron. Ces différents mots ont sans doute une étymologie commune, à chercher autour d’une racine *ghwer ou *bher, qui en germanique commun signifierait « le fort », « le violent », « celui qui frappe et qui tue ». Mais certains philologues proposent une autre piste, plus simple et tout aussi intéressante: l’ours germanique tiendrait son nom de son pelage sombre, der Bâr signifiant « le brun », « le foncé », « celui qui brille d’une lumière nocturne » ; le mot serait alors à rattacher à la grande famille des termes indo-européens construits sur la racine sanscrite *par ou *bar, qui signifie à la fois « brun » et « brillant ». À cette famille appartient l’adjectif baron (braun), attesté dans plusieurs langues germaniques anciennes et ayant pour sens, lui aussi, à la fois « brun » et « brillant ». Ce mot est de bonne heure passé en latin (brunnus) puis dans les langues romanes (brun, Bruno) pour enrichir la palette lexicale latine – longtemps pauvre, terne et imprécise – des tons situés entre le roux et le noir. L’ours est sombre, certes, mais il est aussi luisant et lustré. Pour les sociétés anciennes, qui distinguent bien plus subtilement que nous le clair du lumineux et le lumineux du brillant, le pelage de l’ours peut être à la fois foncé et rutilant ; en outre, dans les sociétés anciennes, c’est un animal lunaire et de ce fait, souvent, un être de lumière. Une lumière froide et nocturne.
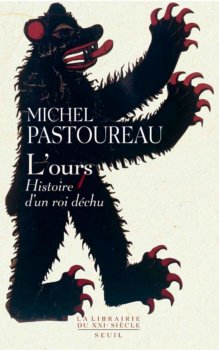 Michel Pastoureau
Michel Pastoureau
In L’ours, histoire d’un roi déchu
Editions du Seuil, 2007









