La guérilla figure au nombre des grandes controverses de la Seconde Guerre mondiale. La vision est cependant totalement différente de celle du bombardement stratégique. En 1945, une conviction est déjà solidement ancrée. Dans le cadre des résistances, les maquis et les partisans auraient joué un rôle déterminant dans la défaite de l’Allemagne. Une conviction qui ne cessera de se renforcer au cours des années suivantes ; la victoire de Mao en Chine, les guerres de décolonisation ne cesseront de démontrer la puissance de la guérilla, l’efficacité de la lutte populaire contre les armées conventionnelles. Mais une remise en cause s’impose.
Tout d’abord, la guérilla, malgré son ampleur au cours du conflit, ne constitue nullement un phénomène nouveau. Depuis l’Antiquité, la petite guerre s’est toujours associée à la grande. Il suffit de rappeler Fabius Cunctator, Vercingétorix, Du Guesclin. On retrouve la guérilla à l’époque moderne pendant les guerres de Trente Ans ou de Succession d’Espagne, et davantage encore pendant l’interminable conflit de la Révolution et de l’Empire. Il suffit d’évoquer la Vendée et la Chouannerie, les guérilleros espagnols, la résistance d’Andreas Hofer au Tyrol et l’action des partisans russes sur les arrières de la Grande Armée en 1812.
La guérilla ponctue la plupart des conflits du XIXe siècle. Français et Russes en font l’expérience lors des conquêtes de l’Algérie et du Caucase. Même phénomène au cours des autres guerres coloniales. Les Américains se heurtent à cette forme de lutte lors de l’expansion vers l’Ouest contre les Indiens. Guérilla encore à l’occasion des révoltes de la Pologne, de l’insurrection hellénique contre la domination ottomane ou de la lutte des pays d’Amérique latine pour l’indépendance.
Pendant la guerre de Sécession, les sudistes mènent des opérations de guérilla sur les arrières de leurs adversaires ; il s’agit surtout de raids de cavalerie comme ceux du général Morgan. Pendant la guerre de 1870-1871, le gouvernement de la Défense nationale encourage le développement d’une résistance populaire. Des groupes de francs-tireurs opérant entre la Seine et la Loire sur les arrières des troupes allemandes, immobilisent ainsi près de 120.000 hommes. Est-il besoin encore de rappeler que la guérilla constitue un des aspects dominants de la guerre des Boers ?
De ces exemples, deux grands types de lutte se dégagent. La petite guerre ou guerre des partisans a retenu l’attention de Sharnhorst et surtout de Clausewitz. Elle s’intègre dans le cadre de la guerre conventionnelle avec des partis relevant d’armées régulières opérant sur les arrières de l’adversaire. Composés d’unités légères, infanterie ou cavalerie, ces partis recueillent des renseignements, interrompent les communications, se livrent à des opérations de harcèlement.
Comme le souligne Clausewitz, ces troupes, ne serait-ce que pour le ravitaillement, doivent entretenir de bons rapports avec les populations, tout en évitant que celles-ci ne trahissent leur présence. Lors de la campagne de Russie, l’auteur de Vom Kriege est impressionné par l’action des groupes de cavaliers de Davydov qui, avec le concours de paysans, attaquent les communications de la Grande Armée, massacrent les trainards et harcèlent les détachements isolés.
À cette lutte de partisans, au sens propre, s’oppose la guerre populaire dont les exemples abondent au cours du XIXe siècle. Cette guerre se trouve à l’origine d’un excellent traité, celui de Le Mière de Corvey, témoin et acteur des guerres de l’Ouest et de la guérilla espagnole sous Napoléon. Compositeur de livrets d’opéra à ses heures, l’homme a su parfaitement analyser les ressorts profonds de cette lutte populaire.
Le succès repose sur l’alternance d’actions offensives et de dispersions. Le résistant doit vivre en étroite symbiose avec la population qui le ravitaille et lui assure des retraites sûres. On trouve bien avant Mao le thème du « poisson dans l’eau » ! Cette guerre suppose encore un élan passionnel, une « forte dose de fanatisme ». Elle est, en effet, par nature, atroce : exécution de prisonniers et d’otages, tortures, représailles, razzias, incendies de village. Cette lutte offre un caractère national, populaire ; elle n’est pas forcément révolutionnaire, bien au contraire. Les Vendéens ou les Espagnols, par exemple, se battent pour le maintien de leurs structures politiques et religieuses.
Le Mière de Corvey souligne aussi les forces et les faiblesses de cette guérilla. Sans que le nom apparaisse encore, l’efficacité de la lutte suppose l’existence d’une base arrière, comme le prouve l’exemple de l’Angleterre alimentant en argent, en armes et en munitions les Vendéens, les Chouans et les Espagnols. En outre, la guérilla ne trouve sa pleine efficacité qu’en liaison avec les opérations menées par des armées régulières. On le constate en Espagne, avec le remarquable rendement de la résistance sur les arrières des troupes françaises engagées contre Wellington. À chaque défaite des « habits rouges », cependant, le découragement s’empare des guérilleros.
La coopération avec la population offre encore des limites. Les francs-tireurs de 1870-1871 en font rapidement l’expérience. À la différence des villes, les campagnes se montrent hostiles à la poursuite de la guerre et aspirent à la paix. La répression est déterminante et apparaît à double tranchant. Elle peut attiser la volonté de lutte ou déboucher sur le découragement. Les exécutions d’otages, les expéditions punitives ou les incendies finissent par entraîner la lassitude des populations et l’isolement des résistants.
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’intérêt pour la guérilla connaît une éclipse. Avec la généralisation des armées de masse, le perfectionnement des matériels l’attention se tourne essentiellement vers la grande guerre. Le premier conflit mondial semble justifier cette orientation. L’Europe n’offre qu’une seule tentative éphémère de guérilla, celle des Serbes en 1916.
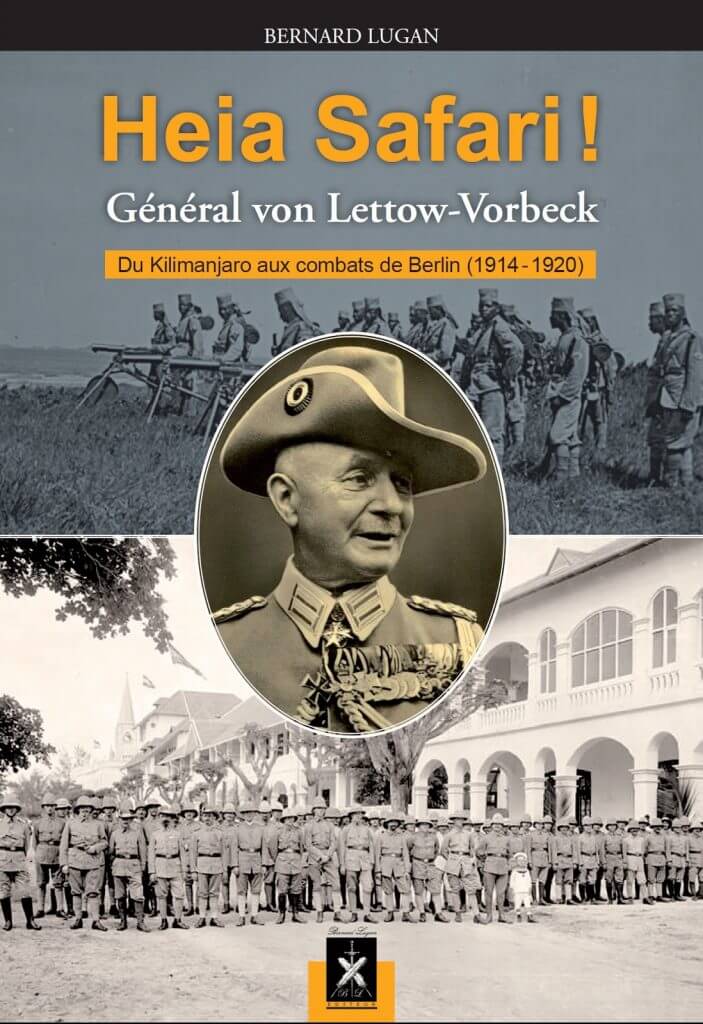 On note deux autres exemples de plus grande ampleur et de longue durée, mais sur des théâtres extérieurs, marginaux : l’épopée de Lawrence et des Arabes contre la domination ottomane au Proche-Orient et la résistance du Sud-Ouest africain allemand, le futur Tanganyika. Pendant toute la durée du conflit, le général Lettow-Vorbeck, à la tête de quelques centaines d’Européens soutenus par quelques milliers d’auxiliaires indigènes, les Askaris, mène une guerre extraordinairement habile contre les Britanniques, sans recevoir le moindre secours de l’extérieur. Il s’agit là d’un exemple classique de guérilla militaire. En dépit d’un effort considérable de ses adversaires, la résistance de Lettow-Vorbeck se poursuit encore le 11 novembre 1918.
On note deux autres exemples de plus grande ampleur et de longue durée, mais sur des théâtres extérieurs, marginaux : l’épopée de Lawrence et des Arabes contre la domination ottomane au Proche-Orient et la résistance du Sud-Ouest africain allemand, le futur Tanganyika. Pendant toute la durée du conflit, le général Lettow-Vorbeck, à la tête de quelques centaines d’Européens soutenus par quelques milliers d’auxiliaires indigènes, les Askaris, mène une guerre extraordinairement habile contre les Britanniques, sans recevoir le moindre secours de l’extérieur. Il s’agit là d’un exemple classique de guérilla militaire. En dépit d’un effort considérable de ses adversaires, la résistance de Lettow-Vorbeck se poursuit encore le 11 novembre 1918.
Au lendemain du conflit, la guérilla connaît une reprise. On la retrouve avec les corps francs allemands en Silésie et dans les pays Baltes et lors de la guerre civile en Russie. Des groupes de partisans opèrent sur les arrières des armées blanches ou des troupes bolcheviques. D’un côté comme de l’autre on assiste à des raids de cosaques. La guérilla est encore pratiquée par Abd el-Krim au Maroc, par les Druzes au Liban. Elle apparaît également en Irlande et en Palestine avec les soulèvements arabes contre la domination britannique et les implantations juives. Tout en conservant les traits classiques, lutte populaire et rurale, la guérilla s’oriente alors vers le terrorisme et suppose l’appui de la population urbaine.
Ce réveil de la guérilla suscite l’intérêt de certains. Directement concernés par les affaires de Palestine et d’Irlande, les Anglais s’inquiètent des possibilités d’une guérilla dans des régions fortement peuplées, bénéficiant de moyens modernes : armes automatiques, explosifs, liaisons radio…
L’intérêt est cependant minime. La guérilla ne figure pas dans les programmes des écoles de guerre. Elle ne suscite aucune étude sérieuse en France. En Allemagne, un seul auteur, Ehrhadt, lui accorde une certaine attention. Les débats de l’époque portent essentiellement sur les possibilités du char et de l’avion, sur la dialectique offensive-défensive.
Les marxistes, ce qui peut surprendre, n’accordent eux aussi qu’une attention mitigée à la guérilla. Pendant la guerre civile, certaines actions se sont montrées efficaces sur les arrières des blancs. Mais, l’Armée rouge a eu surtout affaire à des formations totalement indépendantes des contre-révolutionnaires, notamment dans le sud de la Russie.
En 1919, on voit ainsi opérer « l’armée » de Gregoriev, un ancien officier tsariste, qui joue les seigneurs de la guerre et se taille une véritable principauté à l’ouest du Dniepr. Bien équipées, « combattant à l’allemande », ces troupes obligent les Alliés à évacuer Kherson, Nikolaïev et Odessa. Plus pittoresque encore, l’anarchiste Makhno opère à l’est du fleuve et caresse le rêve de créer une république libertaire dans cette partie de l’Ukraine.
De toute manière, Lénine, Trotsky et Staline ne manifestent que méfiance et scepticisme à l’égard de la guerre populaire dont l’esprit n’a généralement rien de révolutionnaire et qui apparaît surtout inspirée par le conservatisme ou le nationalisme. Pendant la guerre civile, les partisans d’origine rurale luttent contre les Blancs par crainte du rétablissement des grands domaines et contre les bolcheviks par peur d’une collectivisation. En Ukraine, et dans bien des régions « allogènes », la volonté d’autonomie ou d’indépendance constitue des facteurs de soulèvement.
Dans la lutte révolutionnaire, le rôle dominant appartient aux prolétaires, les seuls à posséder un véritable esprit de classe. Les bolcheviks sont convaincus, de toute manière, que la victoire n’a été obtenue sur les Blancs et les « interventionnistes » que par une Armée rouge solidement encadrée et bien équipée.
Au lendemain de la guerre civile, la pensée militaire soviétique est essentiellement axée sur la création d’une armée de masse fortement endoctrinée, bénéficiant de l’élan des soldats français de l’An II, bien dotée en matériel lourd, chars et avions. Le problème de la guérilla semble alors totalement négligé. Au cours de la période, un seul ouvrage d’inspiration marxiste aborde le sujet, celui d’un jeune révolutionnaire vietnamien, Ho Chi Minh.
On retrouve chez les bolcheviks le scepticisme de Marx et d’Engels à l’égard du thème de l’insurrection urbaine préconisée par Blanqui et vouée à l’échec par manque de travail révolutionnaire en profondeur. L’un et l’autre ont encore la conviction que les guérillas populaires comme celles de Vendée ou d’Espagne n’ont eu finalement qu’un rôle marginal et que la décision a été obtenue par les armées régulières. Péché majeur, ces mouvements n’avaient rien de progressiste. À l’époque stalinienne enfin, le pouvoir soviétique éprouve une méfiance maladive à la perspective de constituer à l’avance des dépôts d’armes et de munitions, et d’initier des civils à la guerre subversive.
Renaissance de la guérilla
En dépit d’un scepticisme quasi général, la Seconde Guerre mondiale va se singulariser par une renaissance inattendue de la guérilla, dans le cadre des résistances, sous des formes et des appellations diverses : réseaux, maquis, partisans. Les raisons de cette renaissance apparaissent simples. Le développement de la guérilla tient d’abord à l’ampleur de la domination allemande sur l’Europe. À son apogée, en 1942, cette domination finit par concerner plus de 200 millions de personnes. Elle apparaît alors comparable à celle de l’Empire napoléonien et suscite d’inévitables réactions nationales.
La Seconde Guerre mondiale offre encore un caractère idéologique nettement plus affirmé que le conflit de 1914-1918. Des systèmes politiques différents s’affrontent : nazisme ou fascisme contre démocratie ou socialisme de type soviétique.
Ces résistances bénéficient dès le départ de stimulants ou de soutiens venus de l’extérieur. Au lendemain de la chute de la France, Churchill, dans le cadre d’une stratégie périphérique, compte sur le bombardement stratégique et la guérilla pour venir à bout de l’Allemagne. L’Europe doit être « mise à feu et à sang ». Dès 1940, SOE (Special Operations Executive) est chargé d’établir des contacts, de faire parvenir des agents, du matériel, des directives aux différents mouvements de résistance européenne. L’action clandestine doit aller de pair avec des opérations de commandos dans la tradition de la guerre de partisans. Il s’agit de multiplier les « Vendée ».
Un autre élément joue en faveur de cette guerre parallèle. Avec le développement des armées modernes, le champ d’action de la lutte est beaucoup plus vaste qu’au XVIIIe ou au XIXe siècle. La guérilla s’applique désormais à un réseau complexe de communications et de transmissions, routes, voies ferrées, terrains d’aviation, lignes télégraphiques ou téléphoniques, stations de TSF, etc. Elle peut frapper des dépôts d’essence, des parcs de matériel, indépendamment des opérations classiques contre des détachements isolés. Les objectifs se sont multipliés.
Les moyens d’action ne cessent encore de se diversifier. Les résistants disposent d’armes légères et efficaces fournies par SOE ou saisies sur l’adversaire : mitraillettes type Sten, bazookas, explosifs comme le plastic, très maniable et dont l’explosion peut être commandée à distance au moyen d’un dispositif électrique.
Directives et renseignements sont transmis par radio. Les résistants disposent de codes et de postes miniaturisés pour l’époque, tenant dans une mallette. L’avion léger type Lysander peut encore exécuter des liaisons nocturnes et se poser sur des terrains de fortune. Les résistants bénéficient aussi du parachutage de conteneurs remplis de munitions et d’armes légères. À la veille du débarquement, les Alliés enverront également en France les équipes Jedburgh, composées de deux officiers (un Anglais et un Américain) et d’un opérateur radio, chargées de coordonner l’action de la Résistance en liaison avec les instructions du haut commandement.
Si les buts poursuivis et les moyens utilisés sont partout similaires les résistances de l’Europe occidentale et celles de l’Europe de l’Est apparaissent pourtant différentes. En France, l’apparition de la lutte armée constitue un phénomène tardif, à la mesure du développement relativement lent de la résistance elle-même.
Les premiers réseaux limitent leur action au renseignement. Sabotages et attentats ne commencent vraiment qu’avec l’entrée des communistes dans la lutte clandestine, au lendemain de l’attaque allemande contre l’Union soviétique. Quant aux premiers maquis, ils n’apparaissent qu’à partir de 1943, avec le refus de milliers de jeunes « réfractaires » de répondre aux convocations du STO. Les effectifs n’en restent pas moins faibles : 50.000 à la veille du débarquement, 100 à 120.000 au moment de la Libération. Seule une minorité dispose d’un armement léger.
Tout au long de l’occupation, des conceptions différentes mettent aux prises les grandes tendances de la Résistance. Si, à partir de 1942, l’unification est progressivement réalisée par le général de Gaulle sur le plan politique et militaire dans le cadre du CNR (Comité national de la résistance) et des FFI (Forces françaises de l’intérieur), les communistes entendent pratiquer une stratégie indépendante. Ils mènent des actions « immédiates », attentats, sabotages, quelles que soient l’ampleur et la brutalité des représailles allemandes. Ils comptent sur les exécutions d’otages et de partisans pour provoquer l’indignation de l’opinion et la faire ainsi basculer du côté de la résistance. Ils donnent également leur préférence, sous l’impulsion de Charles Tillon, à l’action armée de petits maquis et surtout de groupes réduits de FTP (Francs-tireurs partisans) capables de se disperser rapidement et de se fondre dans la population.
En revanche, les éléments modérés réprouvent les attentats, peu efficaces sur le plan militaire, à l’origine de réactions brutales de la part de l’occupant. Ils donnent leur préférence au sabotage et surtout au renseignement. Qu’il s’agisse de l’ORA (Organisation de résistance de l’armée) constituée de cadres de l’armée de l’armistice restés pétainistes ou de l’Armée secrète, de tendance républicaine, la lutte armée, à partir de groupes clandestins ou de maquis doit être tenue en réserve. Elle n’interviendra qu’au lendemain du débarquement, au moment de la rupture du front par les Alliés. La résistance devra alors consommer l’effondrement du dispositif militaire de l’adversaire. On retrouve le thème de l’insurrection cher au général de Gaulle.
Ce heurt des conceptions apparaîtra en pleine lumière à la veille de la libération de Paris. Les représentants du général de Gaulle, Chaban-Delmas et Parodi, manifesteront sans succès une vive opposition à l’intention des communistes de déclencher un soulèvement dans la capitale jugé prématuré sur le plan militaire, indépendamment de ses répercussions politiques. Le heurt des conceptions s’applique encore aux maquis. En opposition avec les communistes, les résistants « attentistes » sont favorables à l’organisation de grands maquis militarisés, disciplinés, susceptibles de constituer des bases opérationnelles contre les occupants.
La conception modérée se manifeste également en Norvège, même si SOE obtient, non sans mal, l’exécution du sabotage d’un cargo transportant de l’eau lourde à destination de l’Allemagne. On la retrouve encore sinon aux Pays-Bas où la résistance se trouve en partie sous contrôle allemand, du moins en Belgique où les conditions naturelles ne se prêtent pas à l’implantation de maquis et où la lutte clandestine concerne essentiellement la propagande et le renseignement.
L’Italie pose un problème spécifique. La résistance n’apparaît qu’au lendemain de la capitulation. Elle se manifeste sous forme de maquis implantés dans le nord du pays, dirigés contre l’occupant et plus encore contre la République social-fasciste de Salo. Soumis à de violentes réactions allemandes, ces maquis se disperseront, en grande partie, pendant l’année 1944, pour retrouver une vive activité au moment de l’effondrement allemand et de la progression des armées alliées en direction des Alpes.
Au total, la lutte armée en Europe occidentale apparaît tardive. Elle n’offre au départ qu’une ampleur relativement réduite et ne donne toute sa mesure qu’à la veille du débarquement et au moment de la rupture du front allemand.
Situation totalement différente dans l’Est européen. C’est au lendemain même de l’attaque allemande que le pouvoir soviétique, profondément désorienté et désireux de faire flèche de tout bois, décide, après de vives polémiques, d’organiser une lutte de partisans, dans le cadre de la guerre patriotique. L’appel de Staline, le 3 juillet 1941, est éloquent, à la mesure d’une profonde volte-face idéologique :
« Dans les régions occupées, il faut former des détachements de partisans à pied et à cheval, et des groupes de sabotage pour lutter contre les unités de l’adversaire, pour développer partout la guérilla, pour faire sauter les ponts et les routes, pour couper les communications téléphoniques et télégraphiques, incendier les forêts, les dépôts et les convois. Dans les régions envahies, il faut créer des conditions insupportables pour l’ennemi et ses auxiliaires, les poursuivre et les détruire à chaque pas, faire échouer tout ce qu’il entreprend. »
La guerre de partisans n’a donc rien de spontané. Elle ne répond nullement à un sursaut patriotique de la population. Elle procède de la volonté du pouvoir, dans le cadre d’une énorme improvisation. Le 18 juillet, le comité central du parti jette les grandes lignes de l’organisation. Les détachements de partisans seront constitués par l’Armée rouge, en étroite liaison avec des organes des ministères de l’Intérieur et de la Sécurité d’État (NKVD), l’un et l’autre sous la direction de Beria. L’encadrement sera assuré par des membres du parti et des Komsomols (Jeunesses communistes).
Dans toutes les régions occupées, des groupes de combat de 75 à 100 hommes et des équipes de sabotage de 30 à 50 volontaires devront harceler les colonnes adverses, attaquer les voies ferrées, les aérodromes, les dépôts de munitions et de carburant, ainsi que les détachements isolés. Les partisans livreront des actions ponctuelles suivies de dispersion. Ils agiront suivant les conditions locales, sans obéir à un commandement centralisé. Ils se procureront, sur place, armes, munitions, ravitaillement. Le commandement de l’Armée rouge constituera encore à l’avance des détachements laissés en arrière des lignes, au moment des replis.
Malgré l’effort du parti – 33.000 communistes ukrainiens sont ainsi chargés de la mise sur pied de détachements –, le démarrage est lent. Au 31 décembre 1941, malgré l’ampleur de la pénétration allemande, on ne compte encore que 30.000 partisans davantage préoccupés de leur sûreté que d’opérations offensives. Au cours de l’été suivant, en vertu du redressement patriotique et après les exactions allemandes dans les territoires occupés, les effectifs finissent par atteindre 80 000 hommes. Mais les résultats restent encore faibles et, le 31 août, Staline doit reconnaître publiquement « qu’en dépit d’indiscutables succès, le mouvement des partisans n’a pas encore pris le caractère de masse qu’il devrait avoir ».
Pour pallier cette faiblesse, le pouvoir effectue un énorme effort d’organisation. À partir du 30 mai 1942, le mouvement des partisans dispose d’un état-major général situé à Moscou, sous les ordres de Ponomarenko, le Premier secrétaire du parti communiste de Russie blanche. Cet état-major, en liaison radio avec des postes de commandement établis dans les zones envahies, est chargé de coordonner les opérations. Par liaisons aériennes, les partisans reçoivent des armes, des munitions, des postes de radio, des manuels d’instruction, notamment le fameux ouvrage de Davydov de 1812. Des sanctions sévères pouvant aller jusqu’à la liquidation physique pure et simple sont prises à l’égard des détachements trop « attentistes ». Le recrutement ne s’effectue qu’après un sévère contrôle et une longue période de « vérification » pour éliminer les agents infiltrés par l’ennemi. Progressivement, la mission dévolue aux partisans s’élargit. À la lutte contre l’envahisseur s’ajoute le combat contre les détachements de partisans « bourgeois » nationalistes polonais ou ukrainiens et l’élimination des traîtres au service des Allemands. La reprise en main de la population constitue une tâche majeure.
À partir de 1943, avec 145.000 hommes, le mouvement des partisans prend sa physionomie définitive. Dans les unités, on compte généralement 50% de paysans originaires de la région désireux d’échapper aux réquisitions de main-d’œuvre, 40% de soldats coupés de leurs arrières victimes des grands encerclements du début de la guerre. Le reste, 10%, est composé de membres du parti et de Komsomols chargés de l’encadrement. Les déficiences restent importantes toutefois. Les liaisons aériennes sont aléatoires. Les partisans manquent fréquemment, malgré les prises faites sur l’ennemi, d’armes, de munitions, d’explosifs. Au cours de l’été 1943, sur 1.050 détachements, 600 seulement possèdent des postes de radio. Les faiblesses les plus sérieuses concernent cependant les médicaments, les vivres et les vêtements, à l’origine de réquisitions qui indisposent les populations. On retrouve là l’écueil classique de la guérilla. Quoi qu’il en soit, l’efficacité des partisans ne cessera de se renforcer jusqu’à la libération des territoires occupés en 1943-1944.
Le phénomène des partisans se manifeste également dans les Balkans. Au lendemain même de l’effondrement de la Yougoslavie, le général Mihaïlovitch refuse la capitulation. Avec une poignée d’officiers et de soldats, il gagne les montagnes de la vieille Serbie et entend poursuivre la lutte contre les forces de l’Axe. Avec l’appui de la population, il met sur pied des unités de tchetniks, reprenant le nom historique des résistants serbes à l’occupation ottomane.
Quelques semaines plus tard, au lendemain de l’attaque allemande contre l’URSS, un second mouvement apparaît sous la direction du secrétaire général du parti communiste alors condamné à la clandestinité, Josip Broz, alias Tito. Tout en établissant son quartier général à Jajce, comme Mihaïlovitch, Tito entreprend d’étendre son action en Bosnie, en Dalmatie et en Croatie.
Des mouvements de résistances armées apparaissent également en Albanie, sous la direction des communistes et surtout en Grèce. À la fin de 1942, plusieurs formations de partisans helléniques se sont regroupées dans les régions montagneuses de l’Épire et de la Thessalie. En marge des petites troupes du général Sarafis ou du colonel Psaros, les formations les plus importantes concernent l’ELAS, la branche militaire de l’EAM communiste (Front national de libération) et de l’EDES (Armée nationale démocratique grecque) sous les ordres du général Napoléon Zervas. Cette formation rassemble des républicains et des monarchistes constitutionnels. Mobilisant une quinzaine de milliers d’hommes, ces groupes de partisans mènent des opérations de harcèlement dirigées principalement contre les troupes d’occupation italiennes.
Ces résistances balkaniques connaissent une étape décisive, à l’automne de 1943, au moment de la capitulation de l’Italie, d’autant plus que les Allemands ne peuvent assurer immédiatement la relève de l’allié défaillant. Les partisans réussissent alors à occuper des zones nouvelles et à s’emparer d’un armement important, qui s’ajoute à celui parachuté ou livré par les Britanniques. En 1944, au moment de l’évacuation des Balkans par les Allemands, les mouvements de résistance occupent, aussi bien en Yougoslavie qu’en Grèce et en Albanie, une place déterminante sur le plan militaire et politique.
Un tableau complet doit comporter des cas spécifiques. En Tchécoslovaquie, la résistance proprement dite est tardive et limitée. Comme beaucoup de dirigeants occidentaux, Benès, depuis Londres, préfère mettre l’accent sur le renseignement au détriment des sabotages, à l’origine de brutales représailles. L’assassinat en mai 42 de Heydrich par un groupe d’agents venus d’Angleterre, se traduit par la destruction des villages de Lidice et de Lezaky, ce qui ne fait que renforcer cette tendance. Ces réseaux de renseignements ne tardent pas à acquérir une remarquable efficacité et à fournir aux Alliés des informations capitales sur les activités allemandes non seulement en Tchécoslovaquie mais en Autriche et dans les Balkans.
Comme en France encore, cette orientation soulève les plus vives critiques des communistes qui accusent les leaders « bourgeois » de passivité. Avec l’aide de Moscou, les communistes constituent, à partir de 1942, des petits groupes de partisans armés en Slovaquie, et des comités nationaux chargés de préparer des soulèvements et de contrôler l’ensemble de l’activité clandestine. Ces comités seront à l’origine du soulèvement slovaque de l’automne 1944, qui sera écrasé par les Allemands avant l’arrivée de l’Armée rouge, et de l’insurrection de Prague en mai 1945. En dépit de tentatives de coordination de Benès, au sein notamment d’un Conseil national slovaque établi à Londres, les deux mouvements communiste et démocratique agiront de manière totalement indépendante jusqu’à la fin de la guerre.
La Pologne présente également une situation spécifique. Apparue dès le désastre de 1939, la résistance bénéficie de l’appui de l’ensemble de la population. Au départ, elle concerne tous les occupants du territoire national, avant de s’orienter uniquement contre l’Allemagne après le 22 juin 1941. Au cours des six derniers mois de l’année, l’action concerne essentiellement les lignes de communications de la Wehrmacht. La résistance réussit à faire dérailler une centaine de trains et à faire sauter trois ponts. Mais, devant la violence des réactions allemandes, elle abandonne les sabotages et s’oriente avec un plein succès sur le renseignement.
Dès 1942, une centaine de postes radio dispersés sur tout le territoire émettent en direction du gouvernement polonais de Londres, qui, avec une grande liberté de manœuvre, coordonne l’action clandestine. Cette résistance souffre cependant de l’éloignement de la Grande-Bretagne qui interdit pratiquement toute liaison aérienne.
Mais, le problème le plus grave concerne les relations avec les communistes. Dès l’attaque allemande, le Kremlin fonde à Moscou une Union des patriotes polonais en compétition ouverte avec le gouvernement de Londres. En 1942, des agents communistes sont parachutés en Pologne pour fonder un Parti des travailleurs, à l’origine d’unités de partisans intégrées dans la Garde du peuple.
Pour éviter une divergence militaire et politique au sein de la résistance, le chef d’état-major de l’armée polonaise, le général Sikorski, s’efforce d’intégrer toutes les formations clandestines au sein de l’Armia Krajowa (Armée secrète) placée sous les ordres du général Rowecki. Mais, en mars 1943, au lendemain de la rupture entre Moscou et le gouvernement de Londres liée à l’affaire de Katyn, la résistance communiste, dans le cadre de l’Armée populaire, reprend une totale liberté d’action.
La partie décisive se joue en 1944. Les Polonais savent à ce moment que la libération de leur pays s’effectuera par l’Armée rouge. Le général Bor-Komorowski, qui a succédé à Rowecki arrêté en juin 1943, dresse un plan d’action en trois phases. Au départ, l’Armée secrète limitera son activité au sabotage et surtout au renseignement. Interviendra ensuite la phase Tempête avec les premières opérations de guérilla. Elle sera suivie de l’opération Insurrection à l’heure où la résistance des troupes allemandes en Pologne paraîtra sur le point de s’effondrer. Au moment de la mise au point de ce plan, l’Armée secrète commence à bénéficier d’une aide matérielle de SOE. Les avions basés dans le sud de l’Italie sont en mesure d’atteindre la Pologne.
Après l’exécution de la première phase, Tempête débute en février 1944, avec la mise en action de groupes de partisans en Volhynie, puis dans les régions de Tarnopol et de Bialystok. Mais, dès les premiers contacts avec l’Armée rouge, les formations de l’AK sont désarmées, les chefs arrêtés, fusillés ou déportés. L’URSS ne veut supporter aucune action polonaise dans des territoires considérés comme soviétiques depuis la signature du pacte d’août 1939 ! Quelques mois plus tard, l’Armée rouge, pourtant arrivée sur les rives de la Vistule, laisse les Allemands écraser l’insurrection de Varsovie pratiquement sans intervenir.
Aucun pays européen n’est resté, en définitive, à l’écart de la résistance et de la lutte armée. A priori, le bilan semble impressionnant. La guérilla sous toutes ses formes aurait entraîné la mise hors de combat de plusieurs centaines de milliers de soldats de l’Axe, immobilisé 200 à 250 divisions, provoqué d’innombrables sabotages, détruit 15.000 locomotives, fait sauter autant de ponts. Elle aurait encore provoqué la destruction de plus de 4.000 chars.
Au nombre de 2 millions, les partisans soviétiques auraient fini par paralyser les arrières des troupes allemandes et contribué de manière déterminante au succès des grandes offensives de l’Armée rouge en 1943-1944. Dans les Balkans, les forces de Mihaïlovitch et de Tito auraient retenu plus de 25 divisions allemandes, contribuant de manière capitale au succès de l’offensive soviétique de l’automne 1944 en Roumanie et en Bulgarie. La résistance grecque a sans doute obtenu des résultats du même ordre. La destruction du viaduc de Gorgopotamos sur la ligne de chemin de fer Salonique-Athènes, le 25 octobre 1942, en paralysant le ravitaillement des troupes de l’Axe en Égypte, serait à l’origine de la défaite de Rommel à El Alamein. En France, les sabotages de voies de communications ont probablement retardé de manière décisive l’arrivée des troupes allemandes en Normandie, au moment du débarquement, tandis que les maquis immobilisaient des effectifs importants.
Tableau d’ensemble flatteur qui exige cependant d’importantes retouches. À la veille du débarquement, la quasi-totalité des grandes unités de la Wehrmacht établies en France sont stationnées le long des côtes. Le dispositif allemand à l’intérieur apparaît singulièrement réduit, limité à des formations de second ordre composées de réservistes, d’hommes âgés, privées de matériel lourd. Dans le Limousin, une région pourtant névralgique où la résistance est particulièrement active, le commandement ne dispose sur un territoire d’une superficie équivalente à celle de la Belgique et des Pays-Bas que d’un groupement de 5.000 hommes constitué d’un régiment de sécurité, d’un bataillon de Géorgiens et de quelques centaines de gendarmes.
Sans nier le mérite et le courage des résistants français, force est de constater encore la faiblesse de leurs effectifs : 50.000 hommes plus ou moins bien armés, au printemps de 1944. Les livraisons de matériel par les Alliés n’ont pas dépassé 9 000 tonnes, tout au long de l’occupation, doit 100.000 armes légères, fusils mitraillettes, bazookas, dont un tiers seulement sont réellement tombées entre les mains des intéressés… Notons aussi que les principaux maquis, les Glières, le Mont Mouchet, Saint-Marcet, le Vercors ont été réduits avant ou après Overlord dans des délais rapides et avec peu de moyens.
Au total, 2% seulement des pertes subies par l’armée allemande à l’ouest entre le 6 juin et le 15 septembre 1944 peuvent être attribuées à la Résistance. Selon le mot d’un responsable, il ne s’agit là que de « piqûres d’épingle ».
La Résistance s’est surtout montrée efficace au moment de la rupture du front de Normandie, facilitant la progression des armées alliées, fournissant renseignements et appui d’infanterie aux unités blindées. Eisenhower évaluera cette participation à une douzaine de divisions. Par « l’amalgame » de plusieurs dizaines de milliers d’hommes, la l’armée française bénéficiera d’un apport qui se révélera précieux. Le rôle le plus important des résistances occidentales n’en concerne pas moins les sabotages des voies de communications, efficaces et infiniment moins coûteux pour les populations civiles que les bombardements. Il concerne davantage encore le renseignement. Tout au long de la guerre, les réseaux tchèques, polonais, belges et français ont fait parvenir aux Alliés une masse d’informations d’une importance capitale, concernant le dispositif de la Wehrmacht, la marche de l’économie de guerre du Reich ou la mise au point des armes nouvelles.
À l’Est, sans qu’il s’agisse d’une remise en cause, le mouvement des partisans doit être replacé à sa juste place. Contrairement à certaines allégations, la lutte ne met pas en cause des millions d’hommes. Les effectifs sont infiniment plus modestes. D’après les sources soviétiques elles-mêmes, les partisans ne seront que 200 à 250.000, au cours de l’été 1944, alors que le mouvement est à son apogée.
Sur le plan géographique, l’implantation des partisans offre également de profondes variations. Elle concerne essentiellement les forêts et les zones marécageuses du sud de Leningrad, autour de Pskov et du lac Peïpous, de Russie blanche, dans le quadrilatère Vitebsk, Minsk, Gomel, Briansk, ou encore du Pripet. Pour des raisons physiques ou par suite de l’indifférence ou de l’hostilité des populations, les implantations sont beaucoup plus clairsemées, voire inexistantes dans les pays Baltes, en Crimée ou en Ukraine. Dans cette région, les Allemands ont surtout affaire aux combattants de l’UPA, l’armée insurrectionnelle ukrainienne de tendance nationaliste, dont l’activité concerne essentiellement les zones accidentées et boisées, situées à l’ouest du Dniepr.
Les pertes allemandes revendiquées par les partisans ne peuvent être prises au sérieux. Les Soviétiques eux-mêmes reconnaissent que le bilan présenté par Ponomarenko est hautement fantaisiste. Au cours des deux premières années de la guerre, en Russie blanche uniquement, les partisans auraient tué 300 000 Allemands, provoqué 3.000 déraillements, fait sauter 3.623 ponts, détruits 1.191 chars, 4.097 camions et 825 dépôts divers ! La réalité pour l’ensemble du conflit est beaucoup moins impressionnante : 35.000 tués, dont la moitié d’Allemands. Le reste apparaît constitué de supplétifs levés en Russie même ou d’unités de police ou de volontaires étrangers comme la LVF, considérées comme impropres à la Grande Guerre.
L’activité des partisans a cependant été d’une redoutable efficacité dans un domaine spécifique : l’attaque des communications, qu’il s’agisse d’embuscades le long des routes ou surtout des coupures de voies ferrées. Ces opérations donnent parfois lieu à des mouvements de grande ampleur. Au moment de l’encerclement de Stalingrad et de la rupture de la partie sud du front allemand, les brigades de Kovpak et de Saburov fortes de 2.000 hommes effectuent un raid depuis la région de Briansk jusqu’à la rive occidentale du Dniepr pour attaquer les principales lignes de communications de la Wehrmacht. Bénéficiant d’un soutien aérien, ce raid se solde par une attaque réussie contre le nœud ferroviaire de Sarny.
D’après les propres sources allemandes, celles de la Direction des chemins de fer « Est », ces attaques contre les communications ferroviaires ne cessent de gagner en intensité. On compte ainsi 80 sabotages en janvier 1942, plus de 350 à la fin de l’année et de 1.000 à 1.500 au début de l’été 1943, à la veille de l’offensive de Koursk. Ces sabotages amènent le commandement de la Wehrmacht à lancer de grandes opérations de nettoyage sur les arrières du front.
Les moyens mis en œuvre apparaissent cependant modestes ; pas plus de 40.000 hommes à la veille de l’affaire de Koursk. De toute manière, on reste surpris de la rapidité avec laquelle le commandement de la Wehrmacht réussit à transférer, au moment des crises, de grandes unités du théâtre occidental vers le front oriental.
À la fin de 1943, lors d’une conférence tenue devant les gauleiter, Himmler peut encore prétendre, à juste titre, que la guérilla soviétique n’a pas d’influence notable sur le ravitaillement des troupes engagées à l’Est. Quelques mois plus tard, il n’en est plus de même. Grâce à une action minutieusement préparée (ruptures de rail et sabotage de locomotives), les partisans de Russie blanche réussissent à paralyser complètement pendant 48 heurs les communications sur les arrières du front central, au moment du déclenchement de l’opération Bagration. Il n’en reste pas moins que ces sabotages n’ont fait que faciliter la réussite d’une offensive de toute façon acquise, compte tenu de la surprise, de la disproportion des forces et du rôle déterminant de l’aviation soviétique. Après Bagration et la libération presque complète du territoire de l’URSS, les partisans seront intégrés dans l’Armée rouge, contribuant à compenser ses pertes.
La situation des Balkans justifie également de sérieuses corrections. En Grèce, les partisans, au nombre de 15 à 20.000 en 1943-1944, se contentent le plus souvent de « libérer » des régions d’accès difficile qui n’ont jamais été occupées. Les officiers de liaison alliés sont témoins d’interminables périodes de totale inactivité. La célèbre destruction du viaduc de Gorgopotamos, par exemple, a été exécutée, en réalité, par un commando de parachutistes britanniques. Elle n’a pu avoir aucune répercussion sur la bataille d’El Alamein réglée depuis plusieurs jours. Elle survient à un moment où Rommel est en pleine retraite en direction de la Tunisie.
La situation est la même en Albanie et guère différente en Yougoslavie. Mihaïlovitch limite son activité à la vieille Serbie et ne semble pas avoir disposé de plus de 25.000 hommes. Il n’hésite pas à conclure des trêves avec les Italiens ou les Allemands dans le but de ménager ses forces.
Tito se montre plus actif, ce qui ne l’empêche pas, lui aussi, de négocier des arrangements avec les Allemands en mars 1943, comme le révélera Djilas, en 1964. Les « brigades » et « divisions prolétariennes » opèrent essentiellement dans une zone isolée, réduite, au cœur de la Bosnie. Elles ne tentent que de brèves incursions en Dalmatie ou Croatie où elles ne maintiennent que de faibles implantations. La croissance régulière et spectaculaire des effectifs, 180.000 hommes à la fin de 1943, 350.000 au cours de l’été suivant, ne repose sur aucune base solide.
Il est également hautement fantaisiste de prétendre que les partisans yougoslaves en liaison avec les Grecs ont pu immobiliser 25 divisions de la Wehrmacht dont plusieurs grandes unités blindées.
Ces troupes, en position dans les Balkans à l’automne de 1943, avaient essentiellement pour but de repousser un éventuel débarquement anglo-américain. Tout aussi fantaisiste est le chiffre de 600.000 Allemands tués, alors que les effectifs de la Wehrmacht dans cette région n’ont jamais dépassé 350.000 hommes !
Au cours des grandes opérations antiguérilla du printemps de 1943 et de 1944, les forces de l’Axe n’ont jamais engagé plus de 100.000 hommes relevant de troupes italiennes, de formations d’oustachis d’Ante Pavelitch, de bataillons de police allemande ou d’unités de formation locale comme la division SS Skanderberg composée de Croato-Albanais.
Au cours de ces opérations, les partisans ont subi de véritables désastres comme celui de la Stupeska en mai 1943. Au lendemain de la bataille, le gros des forces de Tito en Bosnie se trouve réduit à 6.000 hommes armés. Un an plus tard, la défaite est encore plus sérieuse. Tito blessé échappe de justesse aux parachutistes allemands. Avec l’aide des Anglais, il doit replier les débris de ses troupes sur la côte dalmate et installer son quartier général dans l’île de Vis.
Pour clore le tout, notons qu’à l’automne 1944, les partisans grecs, albanais et yougoslaves se révéleront incapables, au lendemain de la victorieuse offensive soviétique en Roumanie, d’entraver le repli du groupe d’armées Löhr et son rétablissement dans la région de Sarajevo, point de départ d’une rude guerre de positions qui se prolongera jusqu’en avril 1945.
Pendant tout le conflit, les partisans balkaniques ont occupé essentiellement des zones de montagnes, isolées, d’accès difficile, sans grand intérêt stratégique. Les forces allemandes et italiennes ont pu contrôler les grands centres, utiliser les principaux axes de circulation et exploiter les bassins miniers. Nombre d’opérations d’une ampleur soigneusement exagérée avaient essentiellement pour but d’impressionner les Alliés et de les inciter à multiplier les parachutages d’armes. Mais, dans l’ensemble, aussi bien en Grèce qu’en Yougoslavie, les partisans cherchaient essentiellement à ménager leurs forces dans la perspective de l’inévitable affrontement au lendemain du conflit.
La résistance armée en Europe a revêtu un double caractère. Aspect militaire classique, conforme à la théorie de Clausewitz, pour commencer. Les partisans soviétiques par exemple agissant en liaison avec l’Armée rouge, en offrent le modèle le plus accompli.
Aspect populaire, ensuite, particulièrement net en Grèce, en Albanie et en Yougoslavie, et de manière plus fragmentaire à l’Ouest avec les maquisards et les FTP français.
Quelle qu’en soit l’origine, la technique opérationnelle n’offre guère de différences. La guérilla obéit toujours à des contraintes géographiques. Elle prend naissance et se développe dans des zones d’accès difficile. Les montagnes sauvages et mal frayées des Balkans ou les régions forestières et marécageuses de Russie blanche en constituent de parfaites illustrations.
Cette implantation constitue à la fois un avantage et un inconvénient. Dans ces régions reculées, les partisans sont en mesure d’établir de véritables sanctuaires parfois inviolables. Mais, par leur éloignement et leur isolement, ces bastions constituent de médiocres bases offensives contre les zones névralgiques tenues par les occupants.
Autre handicap, les partisans restent tributaires d’un armement léger, inhérent à un type de guerre fondé sur la mobilité et la dispersion. Malgré un effort réel, les parachutages de matériel effectués par les alliés apparaissent non seulement tardifs mais limités : 100.000 armes portatives en France (fusils, mitraillettes, bazookas) et à peu près autant en Yougoslavie. Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que les partisans purent utiliser occasionnellement du matériel lourd, chars ou canons.
La guérilla de la Seconde Guerre mondiale pose une fois de plus le problème des bases arrières. À cet égard, la résistance polonaise est pénalisée pendant presque toute la guerre de se trouver à la limite du rayon d’action de l’aviation alliée. Des appareils basés en Italie réussiront cependant à effectuer des parachutages pendant l’insurrection de Varsovie, mais en quantité limitée.
Les partisans se sont encore heurtés à un phénomène classique, celui du soutien des populations environnantes. C’est dans les montagnes des Balkans que la symbiose s’est dans l’ensemble le mieux réalisée, avec des communautés restées à l’écart de la vie moderne, animées d’un solide esprit de clan et d’une tradition de résistance à l’oppression héritée de la lutte contre les Turcs.
En Europe occidentale, ce soutien s’est montré souvent plus réticent. Faute d’une aide spontanée, maquisards et francs-tireurs ont dû souvent monter de véritables expéditions pour obtenir l’argent et les vivres dont ils avaient besoin. Pour les campagnes, les maquis ont été fréquemment assimilés aux grandes compagnies. La crainte des représailles explique encore bien des réticences. Le massacre de Kragujevac en Serbie justifie en partie l’attentisme de Mihaïlovitch obligé de conserver le soutien de la population et désireux de lui épargner de terribles souffrances. Au lendemain du drame d’Oradour, les résistants du Limousin se heurteront aux réticences de plus en plus vives de la population et renonceront à une attaque projetée contre Limoges.
Les expéditions punitives, les incendies, les exécutions d’otages constituent un des volets habituels de la lutte antiguérilla. Surpris au départ, les Allemands utilisèrent contre les maquis des techniques traditionnelles, comme des groupes de chasse dotés d’un armement léger, ou des moyens modernes : avions, unités de parachutistes. Hormis l’attaque contre le poste de commandement de Tito en mai 1944, une des opérations aéroportées les plus célèbres et les plus réussies concerne l’attaque du plateau du Vercors menée par des planeurs appartenant à une formation SS basée à Strasbourg.
En définitive, la guerre des partisans s’est rarement révélée décisive par elle-même. Les opérations réussies ont été exceptionnelles, comme la reddition de la colonne Elster dans le Nivernais au moment de la Libération ou la paralysie des transports ferroviaires allemands en Russie blanche. Pour le Reich, la résistance armée a constitué, tout au plus, une gêne, une nuisance, mais jamais une menace fondamentale.
Une fois de plus, cette forme de lutte s’est révélée particulièrement atroce, avec massacre et torture réciproques de prisonniers et souffrances infligées aux populations. Une fois de plus encore, elle a débouché sur un banditisme parallèle capable des pires exactions.
Marginale sur le plan militaire, la résistance armée a joué, en revanche, un rôle déterminant sur le plan politique. En France, elle contribue de manière décisive à la renaissance d’un sentiment de dignité nationale et au discrédit de l’État français. À partir de 1943, son action finit par s’orienter dans une double direction : contre l’occupant naturellement et aussi contre le régime de Vichy amené par les contraintes du maintien de l’ordre, à se compromettre dans l’entreprise de répression menée par l’ennemi. Avec l’entrée en scène de la milice, la lutte menée contre les « terroristes » prend des allures de guerre civile.
Au moment de la Libération, cette résistance, dans le cadre du thème de l’insurrection défini par le général de Gaulle, renforce l’audience du gouvernement provisoire et assure la relève de l’administration de Vichy préparée par les commissaires de la République. La lutte armée permet encore au parti communiste de se réhabiliter, de sortir du ghetto où l’avait plongé la conclusion du pacte germano-soviétique d’août 1939. Au moment de la Libération, il apparaît comme une formation hautement patriotique et progressiste. Revendiquant ses 75.000 fusillés, alors qu’on n’en comptera que 27.000 pour toute la France, il s’affirme comme l’élément majeur de la Résistance. Dans bien des régions comme le Sud-Ouest, le comportement du parti est à l’origine d’une situation trouble.
Le spectre d’une révolution, redouté par certains, s’éloigne cependant. Sur l’injonction des chefs du parti comme Thorez, Duclos ou Tillon, les militants, non sans mal, se résignent à abandonner ou à approuver la perspective d’une révolution sociale et à jouer le jeu de la démocratie libérale. La dissolution des milices patriotiques obtenue par le général de Gaulle constitue le signe tangible et douloureux d’un retour à la légalité et marque la fin d’un espoir. L’affrontement entre résistance communiste et résistance modérée est ainsi évité. On retrouve une situation du même ordre en Belgique ou en Italie. Nul doute que le comportement des communistes dans les pays occidentaux n’obéisse à des directives de Staline, soucieux de ne pas se brouiller prématurément avec les Occidentaux et qui se montre sceptique sur la réussite d’une révolution dans une zone échappant à l’action de l’Armée rouge.
Situation bien différente en Europe orientale où des luttes intestines impitoyables se déchaînent après, ou même avant la fin de la guerre. On le constate en Russie même. Dès la libération, l’Armée rouge et les unités du NKVD se heurtent à l’action de partisans nationalistes dans les pays Baltes, dans les territoires polonais annexés ou en Ukraine occidentale. L’attentat mortel dont est victime le général Vatoutine dès juin 1944 près de Rovno constitue le signe précurseur d’une lutte atroce qui fera des dizaines de milliers de victimes dans les régions occidentales de l’Union soviétique et qui ne se terminera qu’à la fin des années cinquante.
Situation encore plus tragique en Pologne. Au début de 1945, au moment de la victorieuse offensive à l’ouest de la Vistule, la résistance modérée se heurte à un terrible dilemme. Alors que l’Armée populaire communiste n’aligne pas 25.000 hommes, l’AK, l’armée secrète, compte 400.000 militants, dont une faible proportion, il est vrai, dispose d’un armement embryonnaire.
En dépit des sombres expériences de Varsovie et de Volhynie, les Polonais renoncent à engager la lutte contre un nouvel adversaire et se résignent à accueillir l’Armée rouge en libératrice. L’espoir subsiste d’un rétablissement d’une vie démocratique authentique, malgré l’établissement à Varsovie du comité communiste de Lublin devenu gouvernement provisoire. Aussi, le 19 janvier 1945, le général Okulicki, le dernier commandant de l’AK, donne-t-il l’ordre de dissolution de ses troupes.
La formation, le 28 juin, d’un nouveau gouvernement avec des ministres venus de Londres, notamment Mikolajczyk, et qui annonce des élections libres et démocratiques semble justifier l’espoir des dirigeants de l’Armée secrète. Cette formation entraîne la dissolution du Conseil de l’unité nationale resté dans la clandestinité, après un appel en faveur d’un affrontement démocratique entre toutes les tendances politiques.
L’espoir est rapidement déçu. L’Armée rouge ne tarde pas à se conduire en véritable puissance occupante et à imposer un régime de type socialiste. Malgré un engagement solennel de garantie, le général Okulicki, le délégué du gouvernement de Londres Jankowsky et 14 membres de la résistance modérée ont déjà été arrêtés en mars dès leur arrivée à Moscou, avant d’être jugés trois mois plus tard et condamnés pour trahison à de lourdes peines de prison. Point de départ d’une lourde répression contre les anciens cadres de l’AK qui ne va cesser de s’aggraver et se poursuivre jusqu’en 1948.
Découragée, épuisée par cinq années de lutte, la population n’oppose qu’une résistance passive à la mainmise communiste. Certains vont plus loin cependant. L’Association militaire nationale, dissidente de l’AK dès novembre 1944 et qui regroupe des éléments de droite reprend la lutte. Au départ, cette organisation avait décidé de ne pas combattre les Russes, tout en cessant la lutte contre la Wehrmacht. Elle avait caressé l’espoir de gagner l’Occident en négociant avec les Allemands. Espoir déçu là encore. Une seule brigade de 1.000 hommes, celle de Sainte-Croix, avait réussi à atteindre la Bohême, en mai 1945.
Après une courte période d’hésitation, les formations de l’Association militaire qui alignent de 50 à 70.000 hommes, avec le soutien de certaines unités de l’AK reconstituées, entreprennent de mener le combat contre les Soviétiques et leurs alliés communistes.
La Pologne bascule ainsi dans une terrible guerre civile qui se poursuivra jusqu’en 1948 et fera plus de 100.000 victimes. Sceptiques sur l’issue de ce combat, plus de 200.000 Polonais, en majorité anciens résistants, choisissent la fuite vers les pays occidentaux.
Dans les Balkans, la guerre civile débute bien avant mai 1945. Sans grande difficulté, les communistes albanais liquident leurs adversaires au sein même de la résistance et n’ont aucun mal à dominer intégralement le pouvoir en 1944. En Grèce, au contraire, de violents affrontements ne cesseront de mettre aux prises les partisans communistes de l’ELAS et les résistants modérés de l’EDES.
À plusieurs reprises, les Anglais réussissent à imposer des trêves. Ces armistices restent provisoires. L’un et l’autre groupe n’aspirent qu’à la prise du pouvoir au lendemain de la Libération. Le seul point d’accord concerne le refus d’un rétablissement de la monarchie sans consultation populaire. À la faveur de ces luttes, les communistes réussissent à éliminer totalement les petits groupes de résistants de Sarafis et de Psaros.
Lors de l’évacuation de la Grèce par les Allemands, les Anglais débarquent au Pirée et occupent Athènes en octobre 1944. La situation politique ne tarde pas à devenir explosive. De violents affrontements opposent militants de droite et de gauche. Des éléments de l’ELAS entrés dans la capitale tentent de dominer la vie politique avant de se heurter violemment aux troupes britanniques qui, après plusieurs semaines de combat, réussissent à reprendre le contrôle d’Athènes. Lors de la visite de Churchill, à la veille de Noël, un accord est conclu entre les différentes fractions. Mais, il ne s’agit que d’une simple trêve. La Grèce sera bientôt le théâtre d’une atroce guerre civile qui se prolongera jusqu’en 1948.
La Yougoslavie offre le même exemple d’affrontements entre résistants bien avant la fin du conflit. À l’automne de 1941, Mihaïlovitch et Tito paraissent disposés à conclure un accord. Mais, à maintes reprises, partisans et tchetniks s’affrontent avec un rare acharnement. Cette lutte impitoyable se poursuivra jusqu’à l’élimination complète de Mihaïlovitch.
Comment expliquer la défaite du chef des tchekniks qui dispose pourtant au départ de sérieux avantages : son autorité, sa position privilégiée vis-à-vis du gouvernement royal en exil à Londres dont il est le ministre de la Guerre et l’aide exclusive des Britanniques ? Jusqu’en 1943, la presse anglo-américaine identifie la résistance yougoslave à la lutte des tchetniks.
Plusieurs raisons sont, en fait, à l’origine de l’élimination tragique de Mihaïlovitch. L’homme n’a pas l’envergure de Tito, redoutable stratège et tacticien consommé infiniment plus à l’aise sur le plan politique et militaire que son adversaire, d’une intelligence limitée et qui représente le modèle presque caricatural du brave militaire. À la limite, on serait tenté d’établir un parallèle entre de Gaulle et Giraud.
Tito se montre plus actif que son rival. Il profite avec une habileté supérieure de la capitulation italienne pour se procurer des armes et étendre son influence au Monténégro, en Croatie et surtout dans les montagnes de Dalmatie. Avec un sens aigu des relations publiques, il dénonce à maintes reprises la « trahison » de Mihaïlovitch qui n’hésite pas à traiter avec l’adversaire, sans naturellement révéler les négociations qu’il mène avec les Allemands sur des échanges de prisonniers et la conclusion d’une trêve sur les positions acquises.
Dernier avantage. Tout en mettant en place une infrastructure de type collectiviste, Tito s’affirme comme le représentant de tous les Yougoslaves. Il assure la protection des minorités de Serbes de Bosnie et de Croatie soumises aux affreuses persécutions des Oustachis. Il prône la création d’un État indépendant de type fédéral.
Le revirement anglais intervient à l’automne de 1943, à la veille du débarquement en Italie. Le rapport adressé au Caire par la mission Mac Lean-Deakin auprès de Tito semble avoir joué un rôle déterminant, sans exclure l’intervention trouble de certains agents de SOE crypto-communistes. Quoi qu’il en soit, l’état-major du général Alexander est alors convaincu que les partisans représentent une force militaire bien plus efficace que celle des tchetniks.
Les Britanniques interrompent alors pratiquement leur aide à Mihaïlovitch et accordent le maximum de soutien à Tito. Lors de la dernière grande offensive allemande de mai-juin 1944, ils interviennent énergiquement en faveur des partisans en pleine déconfiture et assurent le repli de Tito et de son état-major dans l’île de Vis.
Négociateur habile, Tito séduit Churchill et Alexander. Il se fait reconnaître comme le véritable chef politique de la Yougoslavie. Le retour du roi n’est pas totalement écarté, mais subordonné à un référendum populaire. Cet accord n’empêche nullement Tito d’effectuer un voyage à Moscou sans prévenir les Anglais de son départ.
En Russie, il brise les préventions de Staline. Il obtient le soutien militaire de l’Armée rouge et sa présence « temporaire » sur le sol yougoslave. Les Soviétiques aideront ainsi les partisans à libérer Belgrade. L’alliance entre les deux pays sera confirmée au cours d’un second voyage en avril 1945. En moins d’un an, Tito a obtenu la reconnaissance des trois grands.
Tout au long de cette période capitale, il réussit à établir progressivement sa mainmise sur l’ensemble du pays au prix de terribles massacres. La Yougoslavie est déchirée par d’affreuses guerres civiles, à la mesure de sa mosaïque ethnique et religieuse. Au duel impitoyable qui oppose partisans et tchetniks, s’ajoute la lutte que mènent les deux groupes contre les Croato-Albanais d’Ante Pavelitch et dans un domaine tout à fait différent le combat triangulaire livré au Monténégro entre Blancs, Verts et Rouges.
Luttes accompagnées d’abominables massacres dans la bonne tradition balkanique. En Dalmatie et en Bosnie, plus de 300.000 Serbes sont sauvagement assassinés, le plus souvent à coups de pioche. Les massacres sent accompagnés d’une débauche de tortures, de viols et d’incendies. Partisans et tchetniks recourent aux mêmes méthodes.
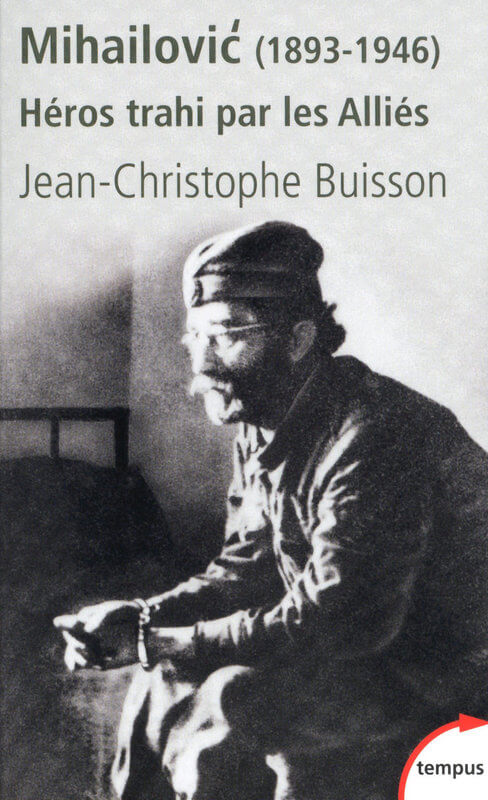 Reconnu sur la scène internationale, Tito voit sa situation s’améliorer brutalement à l’automne de 1944 avec le repli de l’armée Löhr. Rassemblant ses partisans, il établit son autorité sur la Macédoine, le Monténégro, une partie de la Dalmatie et surtout sur la Serbie. Il pourchasse impitoyablement les tchetniks condamnés à se réfugier dans la clandestinité. Traqué, réduit à une petite troupe de fidèles, le malheureux Mihaïlovitch finira par être arrêté au début de 1946 : jugé, condamné à mort comme traître, il sera fusillé.
Reconnu sur la scène internationale, Tito voit sa situation s’améliorer brutalement à l’automne de 1944 avec le repli de l’armée Löhr. Rassemblant ses partisans, il établit son autorité sur la Macédoine, le Monténégro, une partie de la Dalmatie et surtout sur la Serbie. Il pourchasse impitoyablement les tchetniks condamnés à se réfugier dans la clandestinité. Traqué, réduit à une petite troupe de fidèles, le malheureux Mihaïlovitch finira par être arrêté au début de 1946 : jugé, condamné à mort comme traître, il sera fusillé.
Dans ces régions libérées, Tito met en place l’armature d’une démocratie socialiste, avec un parti communiste qui domine largement un « front populaire », une police politique, l’OZNA, d’une redoutable efficacité. Tito entreprend encore la nationalisation de larges secteurs de l’économie. Avec l’aide matérielle des Alliés et des Soviétiques, il procède à une vaste mobilisation et dispose bientôt d’une armée de 500.000 hommes.
L’hiver 1944-1945 est cependant difficile. Les combats contre les Allemands se traduisent par des pertes sévères, plus de 70.000 hommes, la démoralisation du contingent serbe et une mutinerie des recrues albanaises liée au soulèvement du Kossovo impitoyablement réprimé en mars 1945.
Avec l’effondrement du Reich, le triomphe de Tito est complet. Ses troupes occupent tout le nord de la Yougoslavie et procèdent à une nouvelle épuration. Les massacres d’opposants ou d’adversaires politiques éliminent plus de 100.000 personnes. Maître du pays au prix de ce terrible bain de sang, Tito peut s’offrir le luxe de rompre définitivement avec la monarchie, d’accélérer la mise en place d’un régime totalitaire et d’adopter une position nettement anti-occidentale.
Pour l’heure, l’homme choisit l’alliance avec Moscou. En dépit de ses engagements vis-à-vis du général Alexander, il occupe Trieste qu’il n’évacuera qu’à la suite d’un ultimatum en règle des Anglo-Américains. La Yougoslavie fait alors partie intégrante du camp socialiste.
La victoire complète de Tito, indépendamment de ses qualités personnelles et de son absence totale de scrupules, tient d’abord à des considérations stratégiques. La Grande-Bretagne a opté pour Tito au détriment de Mihaïlovitch en raison de son aptitude militaire, dans l’espoir qu’il se montrerait accommodant sur l’avenir politique de la Yougoslavie et qu’il accepterait le maintien de la monarchie, même de façade.
Churchill et Alexander n’ont cependant pas su percer à jour les intentions secrètes de l’homme. Ils ignoraient que Tito était bien décidé à devenir le maître et qu’il était résolu en cas de débarquement allié en Yougoslavie à s’y opposer par les armes, même avec l’aide des Allemands.
Tito a su encore briser les hésitations d’un Staline plus réservé, plus lucide et qui subodorait probablement en 1944 déjà les risques d’une attitude ombrageuse et indépendante qui devait conduire à une rupture dès 1948. Tito a réussi enfin à exploiter le vide politique de la région avec l’effacement provisoire ou définitif de la Grèce, de la Roumanie, de la Hongrie et de l’Autriche, ainsi que les ambiguïtés de la grande alliance. En 1945, il sort victorieux de l’épreuve. Mais le pays est exsangue, couvert de ruines. On compte plus de 1,7 million de victimes dont près des deux tiers ont été massacrés par des Yougoslaves eux-mêmes.
Ainsi donc, les luttes armées marquent de leur empreinte toute l’Europe de l’après-guerre. Dans les pays de l’Ouest, les résistances vont inspirer une grande partie de la vie politique et assurer la relève d’une part notable des anciennes élites. À l’Est, la situation est plus confuse. En Albanie et en Yougoslavie, sans la présence de l’Armée rouge, les partisans, après avoir éliminé leurs adversaires, réussissent à mettre en place des régimes de démocratie populaire pour le moment étroitement liés à Moscou.
En Grèce, la situation est encore indécise. Contrairement à ce qui vient de se passer en Yougoslavie, Staline semble respecter l’accord de Moscou de septembre 1944 qui place le pays dans l’orbite britannique. En réalité, par le soutien massif accordé à I’ELAS, par l’intermédiaire de la Bulgarie et de la Yougoslavie, il espère bien faire triompher à terme le socialisme. Le calcul sera déjoué par l’intervention britannique puis américaine et par le « schisme » de Tito en 1948.
La Pologne offre, en revanche, un cas pratiquement inverse et singulièrement tragique. Par la présence de l’Armée rouge appuyant un parti communiste étroitement minoritaire, Staline va réussir à intégrer le pays dans l’orbite socialiste, au mépris des sentiments profonds de l’ensemble de la population et en éliminant une résistance qui avait mené pendant cinq ans une lutte acharnée contre les Allemands. Pour la seconde fois depuis 1939, la Pologne a le triste privilège d’être la « terre de souffrance » de l’Europe.
On ne peut quitter l’Europe sans évoquer les résistances qui n’ont pas eu lieu. En atteignant les frontières du Reich, à la mi-septembre 1944, les Anglo-Américains devaient éprouver une énorme appréhension. D’impressionnantes pancartes en anglais dominent les postes frontières abandonnés : « Allemagne – Vous entrez en territoire ennemi – Soyez sur vos gardes ! » Par la radio, la propagande de Goebbels ne cesse d’insister sur l’existence d’une force clandestine, le Werewolf, rompue à toutes les formes de la lutte subversive.
Cette menace est à l’origine de mises en garde adressées aux soldats américains par le biais du commandement ou des journaux de l’armée, Yanks et Stars and Stripes. La guérilla peut être plus dangereuse que le combat à visage découvert. Le Werewolf peut mettre en œuvre plus de 500.000 membres de la Gestapo ou même des soldats ayant abandonné la tenue militaire pour le vêtement civil.
S’explique ainsi le comportement dur, parfois brutal des soldats américains au cours des premières semaines d’occupation en Rhénanie. La population est invitée à livrer armes et munitions. Les visites domiciliaires se multiplient. Le couvre-feu est instauré. Tout rassemblement de plus de cinq personnes est interdit. Les rues des grandes villes comme Cologne sont éclairées pendant la nuit par des projecteurs. Les déplacements routiers ne s’effectuent qu’en convois protégés par des véhicules blindés. Toute fraternisation est naturellement interdite.
En réalité, à l’étonnement de l’occupant, aucune manifestation hostile ne se produit. Pas le moindre maquis, pas le moindre attentat, pas le moindre sabotage. Aucune rupture de ligne téléphonique n’intervient le long des routes ou des chemins de campagne. Le Werewolf apparaît comme un énorme bluff. Aucune résistance n’a été préparée à l’avance. L’ampleur du désastre, l’absence totale d’encouragement extérieur, la fatigue provoquée par cinq années de guerre s’opposent, en fin de compte, à toute réaction individuelle ou collective.
On a trop souvent tendance à identifier la lutte contre l’occupant à l’Europe et à négliger les luttes clandestines nées de la guerre du Pacifique. On retrouve pourtant en Extrême-Orient les deux formes de combat classique, la petite guerre, celle des partisans, à base de troupes régulières et la guérilla populaire, plus ou moins spontanée.
La première formule a été pratiquée de manière presque schématique par les Chindits (dragons) en Birmanie à l’initiative du major général britannique Orde C. Wingate, un personnage étrange, qui avait acquis l’expérience de la guerre subversive en Palestine pendant l’entre-deux-guerres et en Éthiopie, lors de la reconquête sur les Italiens en 1940-1941. À la tête de 3.000 hommes, Britanniques, Gurkhas, et Birmans suivis de 1.000 animaux de bât, Wingate franchit en février 1943 la rivière Chidwin et pénètre en haute Birmanie.
En contact radio avec la base arrière de l’Assam, recevant par parachutages vivres et munitions, il réussit à faire opérer pendant trois mois ses Chindits divisés en petits groupes sur les arrières des armées japonaises. Il mène ainsi des attaques de harcèlement et effectue des sabotages le long de la voie ferrée Mandalay-Myitkyina. La retraite se révèle cependant extrêmement pénible et coûteuse, en raison des réactions nipponnes et des difficultés de la jungle et du climat. 2.000 hommes seulement réussissent à regagner l’Inde ou le sud de la Chine. Nombre de malades et de blessés ont dû être abandonnés sur place. La plupart des survivants sont épuisés, rongés par la dysenterie et la malaria, et la santé de certains est définitivement ébranlée.
Sur le plan tactique, l’affaire peut être considérée comme un échec coûteux, comme le souligne alors le général Slim : « Le raid n’a apporté que de bien maigres résultats, compte tenu des pertes et des dépenses engagées. Les dommages infligés aux communications nipponnes ont été réparés en quelques jours, les pertes japonaises négligeables et le raid n’a eu aucun effet sur le dispositif de l’adversaire. Si des leçons ont pu être tirées du soutien aérien et du combat dans la jungle, elles ne l’ont été obtenues qu’à un prix prohibitif. »
En revanche, l’effet psychologique est considérable. L’épopée des Chindits contribue à relever le moral des forces alliées de l’Inde ou du sud de la Chine, terriblement affecté par la conquête éclair de la Birmanie par les Japonais en 1942 et l’échec de l’offensive de l’Arakan. La presse veut voir dans Wingate le « Clive de la Birmanie » et Churchill ne dissimule pas son enthousiasme à l’égard « d’un homme de génie et d’audace ». Il l’invite à participer à la conférence de Québec d’août 1943, où Wingate avec la bénédiction du Premier ministre expose un plan de pénétration grandiose sur les arrières des forces nipponnes en Birmanie.
Ce second raid des Chindits ne démarre qu’au début de 1944 avec la saison sèche, en liaison avec l’armée sino-américaine de Stilwell qui s’efforce de dégager la route de Birmanie. Cinq brigades divisées en deux colonnes participent à l’affaire. Grâce au soutien aérien américain, les Chindits sont déposés par planeurs puis par avions sur les arrières japonais. Deux bases de harcèlement sont d’abord installées à « Broadway » et « Chowringhee », tandis que le gros de forces installe une troisième base appelée « White City », à Mawlu sur la voie ferrée de Mandalay.
En fait, la situation des Chindits devient rapidement difficile. Wingate disparaît dans un accident d’avion dès le 25 mars. Son successeur Lentaigne n’a pas son prestige et entretient des relations difficiles avec Stilwell. Les réactions japonaises sont de plus en plus violentes et la retraite s’effectue dans des conditions extrêmement pénibles au prix de lourdes pertes. Les brigades engagées en Birmanie se retrouvent en Inde décimées, affaiblies, privées de toute capacité offensive. Si elles ont contribué à aider Stilwell à s’emparer de Myitkyina, elles n’ont pas réussi à entraver la dernière offensive japonaise en direction de l’Assam.
Le théâtre chinois offre un autre exemple de petite guerre avec le SACO, une unité sino-américaine de renseignement et de guérilla commandée par le capitaine de vaisseau Miles, en accord avec le général Taï Li, à la tête du « bureau de recherches et de statistiques » de Tchang Kaï-Chek. À la fin de la guerre, en liaison avec l’OSS créé par Donovan, le SACO dispose en Chine du Sud d’une dizaine de camps d’entraînement et se trouve en mesure d’envoyer sur les arrières des lignes japonaises des « colonnes » constituées de centaines de Chinois encadrées par des Américains, formés à la guérilla et au sabotage. D’après les Mémoires de Miles publiés au lendemain de la guerre, mais en grande partie sujets à caution, ces groupes auraient opéré le long de la côte et même dans l’intérieur jusqu’en Mongolie, infligeant aux Japonais des pertes sévères en hommes et en matériel.
Une affaire plus sérieuse concerne le détachement 101 du colonel américain Carl Eifler qui opère dans le nord de la Birmanie avec le soutien des membres de la tribu des Kachin. Vivant dans la haute vallée de l’Irraouadi, ces redoutables guerriers vouent une haine immémoriale aux Birmans et ne leur pardonnent pas leur ralliement aux Japonais. Dès 1942, les Rangers Kachin encadrés par des Américains se livrent à des opérations de sabotage et de harcèlement sur les arrières des troupes nipponnes. À la fin 1944, le détachement 101 aurait compté 566 Américains et près de 10.000 autochtones. Il aurait tué au total près de 5.500 Japonais et sauvé plus de 200 pilotes alliés. Les pertes du détachement n’auraient pas dépassé 15 Américains et 200 Kachin.
Les tentatives alliées de créer des maquis et des foyers de résistance dans d’autres régions du Sud-Est asiatique apparaissent, en revanche, beaucoup moins heureuses. Sans accepter le nouvel ordre nippon, les Malais et les Indonésiens ne mettent aucune ardeur à servir les anciens colonisateurs ou les Américains. Faute du soutien des populations, les tentatives d’infiltration d’agents à Java, à Sumatra ou à Bornéo se soldent par des échecs. Ces tentatives de pénétration ont parfois des résultats désastreux. La capture à Timor en septembre 1943 d’une équipe australo-portugaise de 34 hommes permet aux Japonais d’utiliser l’émetteur radio de cette unité et de transmettre de faux renseignements en Australie. Dans l’ignorance du sort de cette unité, les Alliés continuèrent à envoyer jusqu’à la fin de la guerre des détachements à Timor qui furent régulièrement interceptés dès leur arrivée.
De meilleurs résultats sont obtenus en Thaïlande et surtout aux Philippines, devenues rapidement le grand foyer de la guérilla en Extrême-Orient. Deux raisons principales sont à l’origine du phénomène. Tout d’abord les maladresses de l’occupant qui finissent par indisposer la majorité de la population, ensuite, la poursuite de la lutte par des unités régulières dans des régions isolées, en dépit de la convention de Corregidor prévoyant une capitulation complète.
Des groupes de partisans encadrés par des officiers américains ou philippins réussissent ainsi à se maintenir au nord de Luçon, à Panay, à Leyte, ou encore à Mindanao où opère l’unité du colonel Fertig qui finira par compter 40.000 hommes en 1944. À ces éléments s’ajoutent les guérilleros du parti communiste Hukbalahap, les Huks, très actifs au centre de Luçon. Progressivement, ces unités sont rejointes par des isolés et des volontaires désireux d’échapper à une occupation de plus en plus dure. D’une certaine manière, la guérilla des Philippines, à ses débuts tout au moins, évoque le mouvement des partisans soviétiques.
Dès l’été de 1942, le commandement américain s’efforce d’entrer en contact avec ces groupes. Des sous-marins déposent des agents, des postes de radio, des codes. À partir du printemps de 1943, une section régionale spéciale du quartier général de MacArthur se charge de renforcer les liaisons qui finissent par comprendre des armes, des explosifs, des journaux, des tracts et même toute une gamme d’articles, paquets de cigarettes, boîtes d’allumettes, badges, avec la photo de MacArthur et la phrase célèbre : « Je reviendrai ».
Cette résistance singulièrement active aurait fini par s’appuyer sur 250 000 hommes, bénéficiant du soutien de l’ensemble de la population. Par son efficacité, elle offre des rapprochements avec celles de bien des pays européens. Faute d’armement lourd et même léger, et de moyens de transport, les résultats militaires sont dans l’ensemble médiocres. Les partisans philippins opèrent encore à partir de zones-refuges qui constituent par leur nature même et par leur éloignement de médiocres plates-formes opérationnelles. Jusqu’à la fin, les Japonais ont pu tenir, sans trop de difficultés, les grands centres, les ports principaux et les axes majeurs de circulation.
En fait, jusqu’au débarquement de Leyte, d’octobre 1944, l’activité essentielle de cette résistance consiste à transmettre des renseignements par radio sur les implantations des troupes nipponnes, des terrains d’aviation, des dépôts de matériel et l’activité maritime dans le dédale de l’archipel. On finit par compter plus de 150 postes de surveillance dotés de radio installés le long des côtes. Ces renseignements faciliteront considérablement la tâche des sous-marins et de l’aviation de bombardement.
Tout au long de cette période, les responsables sont invités à renoncer aux opérations actives qui ont toute chance de conduire à des représailles extrêmement brutales, susceptibles de décourager les partisans aussi bien que les populations. Suivant une procédure appliquée là encore en Europe, c’est seulement au moment des débarquements que les résistants devront déclencher des opérations de sabotage et de harcèlement contre les occupants « avec le maximum de violence ». On retrouve ainsi le thème de l’insurrection pratiqué aussi bien en France qu’en Pologne.
En définitive, la guérilla d’Extrême-Orient a revêtu des formes extrêmement variables. En dehors des actions militaires de la dernière phase du conflit, elle a surtout affirmé son efficacité dans le domaine du renseignement. Tout comme en Europe, son influence politique s’est encore révélée considérable. Violemment antijaponais, les mouvements de résistance se sont affirmés profondément nationalistes et farouchement opposés au rétablissement des dominations antérieures. À cet égard, les Français ne devaient pas cacher leur amertume vis-à-vis de l’accord conclu entre Ho Chi Minh et les services américains. En échange de la fourniture de matériel de transmissions, d’armes individuelles et de produits médicaux, voire d’instructeurs, le Viêt-minh s’était engagé à fournir des renseignements et à secourir les pilotes alliés abattus au-dessus de l’Indochine. Cet accord parfaitement respecté contribua au renforcement du Viêt-minh et aux difficultés rencontrées par les Français lors de leur retour au Tonkin en 1946.
La guérilla a été également à l’origine de sanglants règlements de comptes entre ethnies ou groupes politiques opposés. Tout en luttant contre les Japonais, les Kachin du détachement 101 ont profité de l’aide américaine pour éliminer les membres de la tribu voisine, les Shan. En Chine, les « colonnes » SACO, sous couvert d’opérations de harcèlement contre les troupes nipponnes, ne se sont pas gênées pour liquider, à l’initiative du général Taï Li, le « Himmler chinois », des adversaires de Tchang Kaï-Chek et mener de violentes opérations contre les communistes du Yenan.
Aux Philippines, les maquisards communistes Huks ont consacré une très grande part de leur activité à la mise en place d’une réforme agraire – en assassinant les grands propriétaires – et d’institutions « démocratiques ». Un demi-siècle après la fin du conflit, ce mouvement communiste constitue toujours un des problèmes les plus épineux des Philippines. Les résistances, encouragées par les Alliés, ont ainsi contribué d’une manière souvent déterminante à la mutation politique de l’après-guerre.
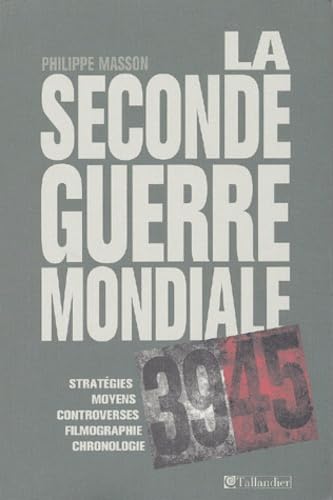
Philippe MASSON (1928-2005)
In La Seconde Guerre mondiale






