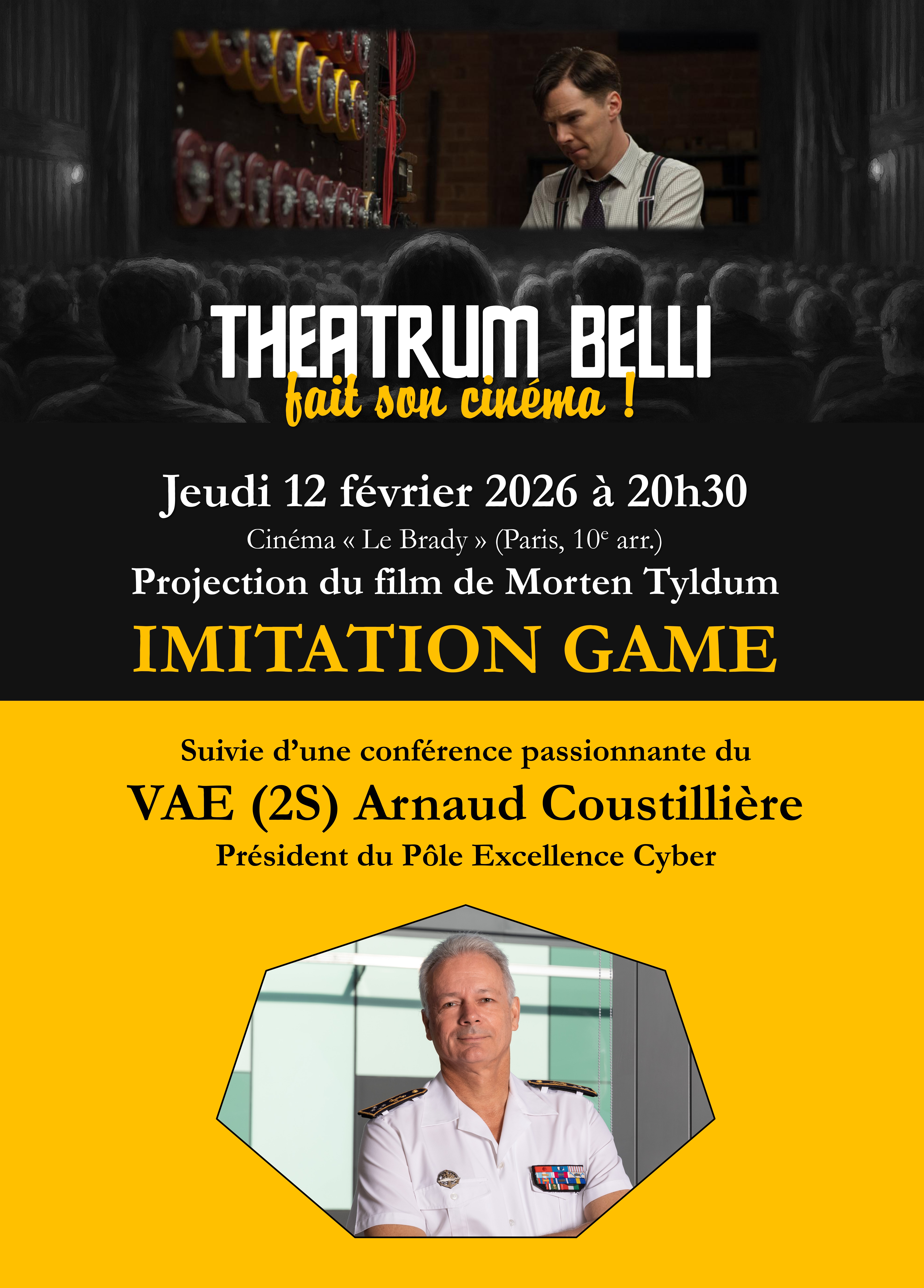Ce mémoire de Master 2 en Sécurité internationale et défense (Université Jean Moulin Lyon III, 2024-2025), rédigé par Mathéo Boccoz, analyse le concept d’autochtonisation dans les stratégies de contre-insurrection. Il s’agit d’une réflexion approfondie sur la manière dont des forces extérieures délèguent ou confient la gestion d’opérations de pacification et de lutte contre les insurrections à des acteurs locaux. Le travail, dirigé par Mme Isabelle Dufour, combine conceptualisation, analyse historique et étude comparée.
L’autochtonisation est définie comme l’ensemble des processus d’intégration, d’acculturation, d’autonomisation ou de remplacement par lesquels des éléments locaux — qu’il s’agisse de populations, de pratiques, de méthodes ou d’institutions — prennent le relai d’éléments extérieurs dans des contextes conflictuels. Le mémoire propose une grille analytique qui distingue deux grands types : l’autochtonisation asymétrique (intégration de la population locale au sein des forces étrangères) et symétrique (soutien à l’appareil local pour permettre aux forces étrangères de se désengager).
Après une introduction théorique, l’auteur propose deux études de cas emblématiques :
- La guerre d’Indochine (1946-1954) : la France cherche à intégrer les populations autochtones dans le corps expéditionnaire et à former des armées nationales vietnamiennes, laotiennes et cambodgiennes en réponse au manque de troupes et à la montée du Viêt-minh. Le processus culmine dans la création d’États locaux dotés de leurs propres forces armées, mais se heurte à des limites structurelles et politiques.
- L’intervention soviétique en Afghanistan (1979-1992) : ici, l’autochtonisation prend la forme d’un soutien massif à l’État afghan et à ses forces, dans l’espoir de contrer les moudjahidines. Malgré la multiplication des dispositifs de formation et la montée en responsabilité des Afghans, la dépendance au soutien soviétique reste forte et l’adaptation n’atteint jamais une pleine efficacité, contribuant à l’effondrement du régime en 1992.
L’étude met en avant les enjeux de légitimité, d’efficacité militaire et politique, ainsi que les défis sonnants à la délégation de la contre-insurrection. La typologie proposée permet de penser de manière critique les phénomènes contemporains de « vietnamisation », « afghanisation » ou plus généralement l’intégration des acteurs locaux dans les dispositifs de contrôle post-coloniaux et de conflits irréguliers.
Ce travail, rigoureux et original sur le plan conceptuel, offre de nouveaux outils d’analyse pour la recherche stratégique et questionne la réalité et les limites du passage de relais aux populations locales — d’hier à aujourd’hui — dans les guerres dites irrégulières.
Ce mémoire est proposé aux lecteurs de Theatrum Belli avec l’aimable autorisation de l’auteur. Qu’il en soit remercié.