La scène internationale connaît depuis quelques semaines une série d’événements qui rebattent les cartes du cadre juridique censé encadrer l’usage de l’arme nucléaire. En Russie, les récents essais du missile de croisière Bourevestnik et du drone sous-marin Poséidon ont ravivé les inquiétudes, tandis que la Corée du Nord multiplie les tirs balistiques. Face à cette escalade, le président américain Donald Trump a annoncé, le 30 octobre 2025, la reprise immédiate des essais nucléaires américains, mettant fin à un moratoire en vigueur depuis trente ans — et ce, malgré le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE).
La réaction du Kremlin ne s’est pas fait attendre. Le 5 novembre, Vladimir Poutine a averti que si un État signataire du traité reprenait ses essais, la Russie se verrait « contrainte de prendre des mesures de rétorsion appropriées », laissant clairement entendre qu’elle pourrait, elle aussi, relancer son programme d’essais nucléaires.
Quand un tweet peut faire vaciller un traité international
La décision du président Trump de relancer les essais nucléaires américains ne constitue pas seulement un geste politique : elle s’apparente à un acte unilatéral de gouvernement qui remet en cause l’équilibre juridique du TICE signé en 1996. En rompant le moratoire américain sur les essais, Washington crée une situation de « réciprocité négative » qui pourrait, à terme, vider le traité de sa substance.
Dans l’histoire du droit international, rares sont les déclarations unilatérales qui ont suffi à elles seules à créer une obligation juridique. Mais la Cour internationale de justice (CIJ) a ouvert la voie à une telle interprétation dès 1974, lors de l’« Affaire des essais nucléaires » opposant la France à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. À l’époque, Paris avait annoncé la fin des essais atmosphériques et leur transfert sous terre. La Cour avait alors estimé que cette déclaration publique, faite par le président Valéry Giscard d’Estaing, engageait la France juridiquement — même si elle n’avait pas été prononcée devant elle. Cette jurisprudence a consacré le principe selon lequel un acte unilatéral, dès lors qu’il est public et exprime clairement une intention, peut produire des effets de droit. Dans ce contexte, l’annonce de Donald Trump, faite publiquement et largement relayée, notamment sur les réseaux sociaux, répond aux critères d’un tel acte. En droit international, aucune forme solennelle n’est requise : ce qui importe, c’est la publicité de la déclaration et la possibilité pour les autres États d’en avoir connaissance. À ce titre, un simple message présidentiel sur X (ex-Twitter) peut suffire à créer une obligation ou, à l’inverse, à en défaire une.
L’histoire nucléaire française offre d’ailleurs plusieurs précédents. En juillet 1971, le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas avait décrété un moratoire sur les essais en cours, avant que le président Georges Pompidou n’autorise leur reprise deux ans plus tard dans le Pacifique Sud, malgré de vives protestations internationales. Un décret avait alors établi une zone de sécurité autour de l’atoll de Mururoa — mesure contestée devant les tribunaux, en vain. En 1974, Valéry Giscard d’Estaing décidait à son tour de mettre fin aux essais atmosphériques au profit d’essais souterrains en juin 1975 à Fangataufa. Enfin, en 1992, François Mitterrand avait suspendu unilatéralement les expérimentations nucléaires, avant que Jacques Chirac ne relance en 1995 une nouvelle campagne dans le Pacifique, assortie d’une zone d’interdiction de navigation. Ces épisodes rappellent à quel point la décision nucléaire relève d’abord du pouvoir présidentiel. Qu’elle prenne la forme d’un discours solennel, d’un décret ou désormais d’une publication sur les réseaux sociaux, elle engage l’État tout entier — et peut, parfois, redéfinir les règles du jeu international.
Le TICE, traité fantôme d’un ancien âge nucléaire
Que vaut encore un traité international face à une déclaration présidentielle ? La question se pose avec acuité depuis la décision américaine de relancer les essais nucléaires. Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), signé en 1996, est directement en cause. Avant son adoption, aucune règle du droit international n’interdisait formellement à un État de mener des essais sur son propre territoire : l’article VI du Traité de non-prolifération (TNP) se bornait à évoquer un objectif général de désarmement. Le TICE entendait aller plus loin, en stoppant toute explosion nucléaire — dans l’atmosphère, sous terre ou en mer — pour condamner à l’obsolescence progressive les arsenaux existants et ouvrir la voie à un monde sans armes nucléaires. Mais derrière cette ambition universelle se cache un édifice juridique fragile. Composé de 17 articles, le traité prévoit dans son article 4 la création d’un système international de surveillance sismique et radionucléaire, conçu pour détecter toute explosion illicite — un mécanisme qui intéressait particulièrement Washington, désireux de garder un œil sur ses rivaux. L’article 14, en revanche, conditionne l’entrée en vigueur du traité à la ratification par 44 États dotés de réacteurs nucléaires. Or, parmi eux, plusieurs acteurs clés — les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Pakistan, Israël, l’Iran, l’Égypte et la Corée du Nord — n’ont jamais franchi le pas.
Ce défaut de ratification a rapidement vidé le TICE de sa substance. Dès 1998, les essais indiens et pakistanais, menés à quelques semaines d’intervalle, ont mis fin à l’unanimité recherchée par le traité. En franchissant le seuil nucléaire sans être sanctionnés, New Delhi et Islamabad ont imposé une lecture pragmatique du droit international : celle de puissances revendiquant une « liberté nucléaire » au nom de leur sécurité nationale. Les États-Unis eux-mêmes ont refusé de ratifier le TICE. En 1999, le Sénat rejette le texte, tout en affichant une adhésion de principe à son esprit. Washington a continué à coopérer avec le dispositif de surveillance, mais sans engagement juridique contraignant. Pendant vingt-cinq ans, le traité est resté en suspens : actif sur le plan technique — à travers le réseau de stations sismiques internationales — mais politiquement inerte. Il a observé, impuissant, les essais nord-coréens de 2006 à 2017, tandis que les appels répétés de l’ONU à sa ratification restaient lettre morte. Puis, en 2023, la Russie a frappé un coup décisif : en retirant sa ratification, Moscou a invoqué la nécessité de « parité stratégique » avec les États-Unis, qui ne l’avaient jamais ratifié, tout en menaçant de réactiver son centre d’essais de Nouvelle-Zemble. La décision américaine du 30 octobre 2025 d’en finir avec le moratoire sur les essais parachève ce processus : le TICE ne lie désormais plus que la France et le Royaume-Uni — soit environ 5 % de l’arsenal nucléaire mondial. Autant dire que sa portée effective s’est réduite à néant.
Trente ans après sa signature, le traité n’est jamais entré en vigueur, faute d’un nombre suffisant de ratifications. À l’instar du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), il s’est heurté à la réalité politique : les Etats particulièrement intéressés ne l’ont pas mis en œuvre. Si, en vertu du droit international général, codifié par l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les signataires doivent s’abstenir « d’actes qui priveraient (un traité) de son objet ou de son but », il faut néanmoins souligner la précarité de la formule puisqu’elle demeure réversible à tout moment, l’Etat retrouve sa liberté d’action dès qu’il décide de ne plus devenir partie du Traité. Les accords de maîtrise des armements comportent, comme nombre de traités et conventions, une clause de retrait permettant à une partie, par une manifestation explicite de volonté, de mettre fin aux effets du traité à son égard, c’est le cas du TICE lequel, dans son article 9, définit un préavis de six mois tel que pourrait l’appliquer la France en riposte à la menace russe.
Benoît GRÉMARE
Docteur en droit public – Chercheur associé à l’Institut d’Études de Stratégie et de Défense – Lyon III.
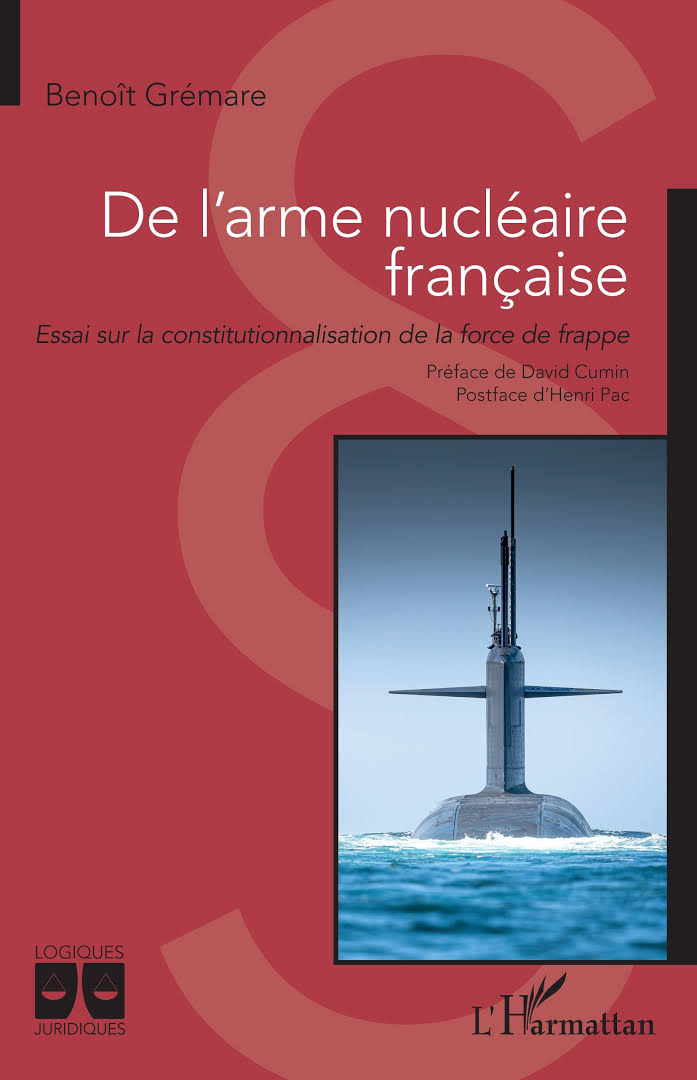
De l’arme nucléaire française
Le droit international est souvent sollicité pour interdire l’arme nucléaire. Pourtant, celle-ci bénéficie d’une légalité de principe qui structure l’ordre mondial et permet d’en déduire les fondements juridiques de la dissuasion nucléaire. En France, l’arme nucléaire détermine en partie l’appareil d’État en incarnant l’assurance-vie de la Nation en cas de crise grave. Cette dimension existentielle amène à s’interroger sur la pertinence de l’inscrire dans la Constitution. S’il se constate une coutume de l’exécutif, l’arme nucléaire française participe au fonctionnement des pouvoirs publics sans pour autant être une norme. Dépasser cette contrainte nécessiterait de systémiser en droit constitutionnel l’arme nucléaire en revenant à son concept originel de ± force de frappe ? Actualisant sa définition juridique, cet ouvrage propose de constitutionnaliser la force de frappe, afin de consacrer la valeur constitutionnelle de l’arme nucléaire au titre de l’indépendance nationale.
L’Harmattan, 2021, 273 pages.








