« Une armée de l’Air à laquelle toutes les ressources de la nation auront été consacrées, et qui sera formée d’une masse d’appareils de bataille et de reconnaissance agissant offensivement, conquerra la maîtrise sur une puissance dont les forces aériennes auront été morcelées. » Julio Douhet, Il Dominio dell’Aria (La Maîtrise de l’Air), 1921.
***
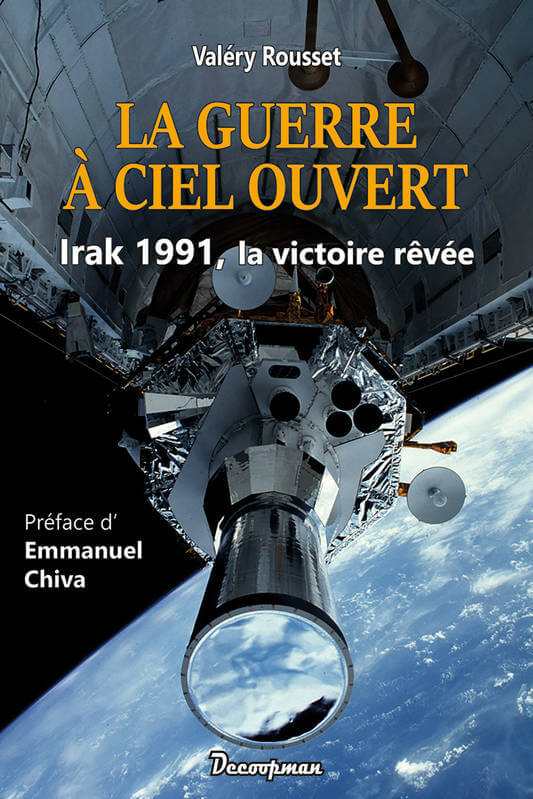 Depuis que le Prussien Clausewitz a souligné sa diversité, ce « véritable caméléon » qu’est la guerre moderne se nourrit des forces structurantes des États-nations les plus avancés : développement des idéologies, croissances économique et démographique, progrès des sciences et des techniques.
Depuis que le Prussien Clausewitz a souligné sa diversité, ce « véritable caméléon » qu’est la guerre moderne se nourrit des forces structurantes des États-nations les plus avancés : développement des idéologies, croissances économique et démographique, progrès des sciences et des techniques.
Expression violente des rapports sociaux, la guerre moderne se fait de même le creuset des percées technologiques et organisationnelles du monde militaire. Au sortir des conflits majeurs du XXe siècle, ces bouleversements se transmettent aux sociétés belligérantes, qui deviennent à leur tour, susceptibles de traduire leurs mutations par de nouvelles formes d’affrontement.
Les guerres du XXe siècle développent ainsi deux tendances successives et contradictoires :
- Dans un premier temps, un nombre croissant d’individus et de ressources sont conviés à remettre en cause leurs fondements politiques ou économiques, débouchant sur des guerres totales, guerres mondiales ou conflits révolutionnaires. La stratégie déborde alors du cadre militaire pour s’approprier une part croissante des ressources humaines et matérielles de la nation. Les outils de la guerre se généralisent, mis à la portée du plus grand nombre et capables de destructions de plus en plus étendues.
- Dans un second temps, la guerre se spécialise et se fait plus complexe ; sa conduite échappe aux dirigeants et aux populations. Ceux-ci, désormais spectateurs et otages d’un affrontement qui les dépasse, restituent à des spécialistes la participation active au conflit, dans le cadre d’opérations intenses et limitées. Après avoir culminé dans l’affrontement nucléaire virtuel de la guerre froide, ce phénomène s’étend aujourd’hui à l’espace ou au cyberespace, nouveaux champs d’affrontement par logiciel et robots interposés.
Dès lors, les relations entre stratégie et technologie semblent évoluer au profit de la première, la forçant brutalement à se renouveler. Depuis 1915 en effet, des percées technologiques suscitent régulièrement la remise en question des doctrines en vigueur, alors que l’intégration d’armements de rupture dans une doctrine cohérente se fait bien après leur introduction sur le champ de bataille. Le Blitzkrieg, ou « Guerre-éclair », en un est premier exemple ; la brillante improvisation opérative de mai-juin 1940 à l’ouest ne devient doctrine que l’année suivante à l’est, avant que l’immensité russe ne souligne ses limites, puis que le « rouleau compresseur » des armées blindées soviétiques ne se retourne contre son inventeur en 1945. L’Hyperwar, terme éphémère forgé dans l’après-guerre du Golfe en 1991, et qui désigne l’intégration d’opérations à haute intensité entre terre, air, mer, espace et information, connaît un sort similaire : théorisée après-coup, cette hyper-guerre se heurte également aux spécificités du théâtre de l’ex-Yougoslavie de 1995 à 1999. Plus étonnamment encore, la répétition du même type d’opérations intégrées multi-milieux contre l’Irak exsangue de 2003 débouche moins sur la victoire-éclair attendue que sur une longue guerre asymétrique à la disparition de l’Irak de Saddam Hussein. Aujourd’hui encore, ses ectoplasmes chiites, islamistes ou kurdes continuent de hanter les forces occidentales ou régionales déployées à l’intérieur ou autour de l’Irak. C’est que la guerre, comme toute expression des rapports sociaux, suppose un certain degré de coopération : elle se déroule d’autant mieux (au profit du vainqueur il est vrai), que les adversaires acceptent de jouer sur la même partition, quitte à faire entendre des instruments différents, voire dissonants…C’est toute la différence entre conflit symétrique ou dissymétrique, comme pour la libération du Koweït, et les conflits véritablement asymétriques qui suivent, dans lesquels l’adversaire s’efforce de contourner ou d’éviter la puissance d’un dispositif conventionnel de type occidental.
Or c’est sans doute dans le domaine aérien que cette dynamique apparaît le plus clairement.
Depuis que l’avion s’est émancipé de la bataille terrestre pour acquérir sa propre sphère d’application à la fin du premier conflit mondial, dans l’éphémère Independent Air Force de 1918 contre l’Allemagne, et plus encore dans l’Air Policing colonial britannique des années 1920 en Afghanistan, Irak ou Somalie (déjà), l’irruption de nouveaux systèmes d’armes vient périodiquement remodeler le visage de la campagne aérienne. Le bombardier stratégique qui émerge du premier conflit mondial, les défenses aériennes intégrées qui apparaissent au cours du second, et les armements autonomes de destruction massive ou au contraire de grande précision qui se développent dans la guerre froide, forment autant de points de référence qui jalonnent la maturation des stratégies aériennes.
Par ailleurs, la dimension aérienne prend au sein de la guerre elle-même une importance croissante, sinon prépondérante, au point de conditionner la conduite des opérations sur terre et sur mer. Le binôme avion-char constitue ainsi le fondement de la guerre-éclair de 1939-1941 en Europe ; le groupe de porte-avions celui de la campagne du Pacifique en 1941-1945 ; et l’aviation d’attaque ou l’hélicoptère de combat celui de la bataille aéroterrestre des années 1980, potentiellement dans la trouée de Fulda en centre-Europe, ou sur les champs de bataille du canal de Suez au plateau du Golan. Détrônés par l’aéronef, les cuirassés, navals ou terrestres (le char de bataille), sont contraints de survivre sous la menace aérienne ; ces mastodontes tentent alors de s’insérer avec fluidité et furtivité dans les défenses multicouches d’opérations interarmes, voire interarmées.
Étudier ce phénomène revient à suivre la maturation continue de la notion de puissance aérienne. Ce concept visionnaire est né avec l’ « avion » de Clément Ader, avant de suivre un développement prometteur dans l’aviation de l’entre-deux-guerres, où la « maîtrise de l’air » déciderait à elle seule de l’issue du conflit. Appliqués de Guernica en 1937 à Nagasaki en 1945, de tels principes ont montré leur caractère destructeur, mais aussi leurs limites, puisque aucune nation n’a jamais été vaincue depuis le ciel (même si l’opération Allied Force de 1999 contre la Serbie a rempli ses buts de guerre en déclenchant l’évacuation du Kosovo par la seule application de la puissance aérienne, mais échoué à détruire les armements serbes). En revanche, la supériorité aérienne conditionne le plus souvent le dénouement des guerres modernes, du bocage normand en 1944 à la vallée de l’Euphrate de 1991 à 2003, en passant par les multiples duels israélo-syriens à l’issue incontestée au-dessus du Liban.
C’est avant tout aux États-Unis que la stratégie s’appuie sur la puissance aérienne, enrichie dans la première Guerre froide de sa dimension aéroterrestre (hélicoptères et missiles tactiques), puis dans la nouvelle Guerre froide depuis le milieu des années 2010 d’une dimension spatiale (missiles balistiques qui transitent en orbite, opérations depuis l’orbite, et depuis peu opérations en orbite). Émergent dans l’après-guerre et confirmé par la guerre du Golfe, le fort potentiel technologique de la dimension aérospatiale est en lui-même source de prestige et de domination ; sa capacité à rayonner en tout point du territoire ennemi (et même du Globe), et le très faible coût humain de ses opérations menées à distance de sécurité, réservent donc à la puissance aérospatiale les faveurs de la conduite américaine de la guerre, quitte à déléguer les opérations terrestres à des « proxys ». Par diffusion, cette acception de la guerre moderne s’est étendue aux alliés des États-Unis, OTAN ou Israël d’abord, et plus récemment les nations de la coalition arabe contre les rebelles houtis au Yémen. Singeant vainement « Tempête du Désert », l’Arabie saoudite et ses alliés se heurtent à des guerriers résolus sur le terrain, renforcés de la puissance régionale iranienne grossie par la décomposition de l’Irak ; narguant le royaume saoudien et ses fournisseurs occidentaux par des attaques de missiles balistiques ou de croisière, panachées d’incursion de drones, ils ont repris à leur profit les technologies soviétiques, israéliennes, et américaines. En réaction, ces transferts inattendus de supériorité aérienne suscitent une nouvelle accumulation des mêmes arsenaux qui ont triomphé en 1991 contre l’Irak. L’histoire bafouille, et le caméléon de Clausewitz s’emballe, passant par toutes les couleurs…
Enserrée dans le carcan nucléaire de la guerre froide, cette guerre moderne devenue guerre d’experts, s’enrichit et se libère avec les apports de l’électronique et des technologies de l’information, dont l’utilisation banalisée du cyberespace, ou de ressources spatiales combinant imagerie, cartographie et données de précision. Appliquées prioritairement à la dimension aérienne, ces innovations désormais info-valorisées et réseau-centrées, ont façonné des armements révolutionnaires, capables d’opérer à distance de sécurité des destructions impressionnantes par leur étendue, ou au contraire par leur ponctualité et leur sélectivité dans le temps, le spectre électromagnétique ou l’espace physique. Les notions de fronts et d’arrières, d’opérations diurnes et par temps clair, semblent alors bien près de céder la place à un affrontement fluide, multi-milieu et permanent, où les composantes de surveillance, de reconnaissance, et de renseignement jouent le rôle de multiplicateur capacitaire.
À l’effondrement du bloc soviétique juste après la guerre du Golfe, la guerre moderne semblait appelée à devenir l’apanage d’une organisation sociale libérale, à forte valeur technologique. Aujourd’hui, l’essor de l’hyperpuissance chinoise et son modèle politico-économique ambigu contredisent cette tendance. Demain, la robotisation, la microminiaturisation et les promesses du New Space ou de l’internet des objets pourraient bien retirer la jouissance exclusive de cette puissance aux États-nations, pour la placer entre les mains de sociétés militaires privées, voire de groupes de pression idéologiques, mafieux ou terroristes. Voilà qui pourrait confisquer l’affrontement armé aux États, pour le replacer dans une perspective socioculturelle écartée depuis Clausewitz et son modèle réactionnaire napoléonien… Nouvelle révolution en perspective.
Ainsi, quand au lendemain du 2 août 1990, l’invasion du Koweït par l’Irak surprend les deux Grands et réveille l’Occident en amorçant une « seconde crise du Golfe » après la longue guerre Iran-Irak, la conflagration majeure qui suit prend valeur d’ultime défi aux stratégies et aux arsenaux forgés dans la guerre froide, tout en marquant une rupture durable dans la conduite des guerres modernes.
La « Tempête du Désert », guerre de libération du Koweït ou de neutralisation de l’Irak ? Guerre conventionnelle en tout cas, symétrique ou dissymétrique sans doute, et en cela typique des conflits du XXe siècle, même si le contexte géostratégique, déjà empreint des percées technologiques du XXIe siècle (GPS, soutien spatial aux opérations, communications mobiles voix et données, et médias d’information continue où prime la recherche du sensationnel), présente une dimension fortement atypique au bénéfice de la dimension aérienne.
Ce contexte exceptionnel de 1991 qui mélange superpuissance américaine, déclin de l’URSS et dépendance des pétromonarchies du Golfe, permet en effet de jeter les bases d’un consensus international sans précédent pour condamner l’agression irakienne au Conseil de Sécurité des Nations Unies, sans réaction significative de son ex-allié soviétique. Ces caractéristiques conduisent les États-Unis et la coalition, cautionnée par le mandat des Nations Unies, à assembler au profit de la défense des Pétromonarchies du Golfe puis de la reconquête du Koweït un dispositif initial défensif, qui devient rapidement offensif à dominante aérienne, prolongé pour la première fois d’une composante spatiale qui offre au combat sa quatrième dimension.
Autour des États-Unis, invités à défendre un vaste sol islamique à des milliers de kilomètres de leurs bases, se met alors en place un dispositif militaire de 35 pays coalisés, dont la montée en puissance bénéficie de la passivité d’une « drôle de guerre » irakienne, qui se déployer et d’entraîner la coalition pendant plus de 5 mois au milieu des riches infrastructures d’accueil de la péninsule arabique. Par-dessus tout, un important potentiel de destruction massive nucléaire, biologique ou chimique, brandi de part et d’autre, est resté inemployé, jouant probablement en cela son rôle de dissuasion. La victoire qui s’ensuit serait totale, si la forêt d’avions et de radars n’avait masqué l’arbre du missile balistique, gêne persistante à la supériorité aérienne depuis 1944 à travers l’emploi incontesté des V2, Scud, ou leurs dérivés Al Hussein et leurs successeurs chinois ou iraniens d’aujourd’hui. La guerre du Golfe ressemble à une victoire rêvée, mais au double sens d’idéale et d’idéalisée, car les années qui suivent, et le profond marasme qui caractérise le Moyen Orient depuis la disparition de l’Irak de Saddam Hussein, ont donné rétrospectivement à cette victoire annoncée un caractère illusoire.
Forte des nouveaux multiplicateurs de force offerts par la maîtrise de l’information, la plus puissante armada aérienne jamais réunie s’abat à la fois massivement, simultanément et sélectivement sur les centres de gravité de l’Irak, réduit à un système d’objectifs dans un plan de frappes intégrées. Dès les premières heures du 17 janvier 1991, la puissance militaire la plus aguerrie du golfe Persique, pourvue des défenses aériennes les plus denses du monde, s’effondre pour ne plus jamais se relever.
L’étude de ce conflit majeur et structurant passe donc par l’examen des opérations aériennes qui l’ont dominé, et qui sont indéniablement responsables de la paralysie du commandement irakien et de l’effondrement de ses forces, au point que la guerre terrestre ne représente plus qu’une chevauchée de cent heures sur les 43 jours de combats. En outre, le volume des opérations aériennes revient à 75 % aux armées des États-Unis, ce qui explique que les doctrines, les systèmes et les opérations décrits dans ces vingt chapitres sont très largement américains. Mais trente années de recul, t l’invasion puis l’occupation de l’Irak, nous obligent à prendre en compte les leçons du désarmement irakien et le point de vue de son régime, jusqu’à Saddam Hussein, longuement interrogé entre sa capture et son exécution.
Offrir une lecture à la fois stratégique et technologique de ces opérations remplit une triple finalité :
- Dégager tout d’abord les facteurs de succès de la puissance aérienne moderne, massivement et sélectivement appliquée contre l’Irak. Capable de paralyser le potentiel ennemi, pouvait-elle pour autant exercer sur lui un contrôle effectif et durable sans contrôler tout ou partie du sol irakien ?
- Souligner ensuite la nouvelle spécificité des conflits menés par les nations développées, détentrices d’une supériorité technologique et organisationnelle, sur des nations en développement ou des puissance émergentes. Ces dernières peuvent-elles échapper à la puissance aérienne en développant leurs propres stratégies indirectes ?
- Nuancer enfin les premiers constats d’une supériorité incontestée du renseignement et des armements de précision, qui semblent priver l’adversaire irakien d’un arsenal de destruction massive ou de ses vecteurs de frappe à longue portée. L’atteinte de cet objectif est en effet fortement nuancée par les actions de désarmement de l’Irak sous l’égide de l’ONU, et par la nouvelle invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, au prétexte même de la persistance d’un potentiel de destruction massive, avéré ou non. Les adversaires de l’occident en ont-ils tiré les leçons pour défier la supériorité conventionnelle des armées modernes ?
Cette perspective en trois mouvements, décrivant tout d’abord la menace irakienne, puis la mise en place du dispositif coalisé, puis sa mise en œuvre sous l’angle des opérations aériennes, revient à caractériser un conflit à haute intensité, un affrontement symétrique au sol et dissymétrique en mer ou dans les airs, représentatif des guerres majeures du XXe siècle, à la différence des conflits asymétriques du début du siècle suivant. Le rapport des pertes matérielles et humaines y atteint parfois cent contre un en faveur des coalisés, dont les pertes au feu sont elles-mêmes deux fois moindres que leurs propres pertes accidentelles. Les opinions publiques et leurs élus y développent une sensibilité croissante aux pertes humaines, qui s’étend aux pertes infligées à l’ennemi.
La guerre du Golfe de 1991 forme ainsi une double guerre ; sa relecture trente ans après, enrichie par l’analyse de nombreux documents déclassifiés, et par l’expérience de l’Irak in situ, nuance le triomphe initialement perçu, pour dégager une double victoire rêvée : pour la coalition menée par les États-Unis entraînés à défaire les armées blindées soviétiques, la destruction systématique d’un dispositif militaire irakien redoutable mais largement passif, qui lui offre rapidement et à moindre coût humain la victoire dans la guerre de libération du Koweït ; pour l’Irak de Saddam Hussein, défier cette même coalition dans une gesticulation militaro-psychologique, en se dérobant sur le terrain pour porter le conflit en Israël et vers le royaume saoudien par d’insaisissables missiles balistiques (et la première tentative de guerre écologique), tout en préservant son régime, constitue également une victoire stratégique et de prestige, quoique éphémère. En cela, la coalition a failli à neutraliser durablement l’Irak, comme le révèlent les crises de 1994, 1998, et surtout l’invasion américaine de 2003.
Valéry ROUSSET
Après un premier ouvrage d’analyse de ce conflit en 1996, vite épuisé, et fort de vingt-cinq ans d’études et de rencontres expertes aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, l’auteur revisite aujourd’hui la question, exploitant pour la première fois des sources irakiennes saisies lors de l’invasion de 2003 et des documents américains récemment déclassifiés, dans cet ouvrage de référence aux vingt chapitres précisément documentés et richement illustrés.
Éditions Decoopman, 2020, 430 pages, 29 €.
Cliquez ICI pour commander cet ouvrage passionnant et fortement instructif








