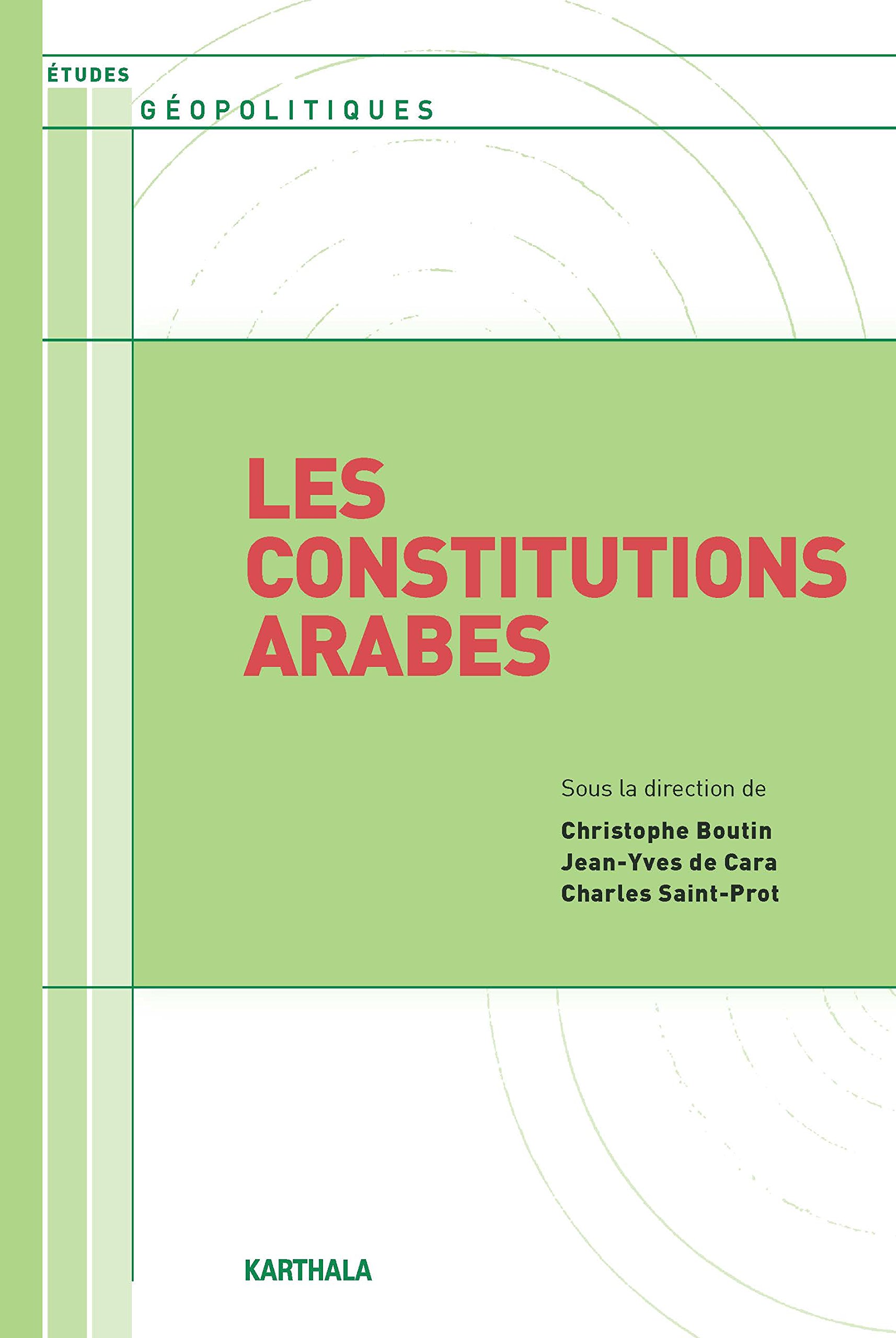 Le monde arabe a connu un mouvement constitutionnel au sens moderne du terme à partir du milieu du XIXe siècle. On peut retenir comme dates la promulgation de la constitution tunisienne, en 1861, ou celle de la constitution ottomane, en 1876. Ce mouvement s’est accru au début du XXe siècle et plusieurs constitutions ont été promulguées pendant l’entre deux guerre au Proche-Orient : égyptienne en 1923, irakienne en 1925, libanaise en 1926, syrienne en 1930. Mais il fallut attendre la décolonisation et la seconde moitié du XXe siècle pour que le mouvement s’achève.
Le monde arabe a connu un mouvement constitutionnel au sens moderne du terme à partir du milieu du XIXe siècle. On peut retenir comme dates la promulgation de la constitution tunisienne, en 1861, ou celle de la constitution ottomane, en 1876. Ce mouvement s’est accru au début du XXe siècle et plusieurs constitutions ont été promulguées pendant l’entre deux guerre au Proche-Orient : égyptienne en 1923, irakienne en 1925, libanaise en 1926, syrienne en 1930. Mais il fallut attendre la décolonisation et la seconde moitié du XXe siècle pour que le mouvement s’achève.
De manière classique, il s’est agi avec ces constitutions, dans un premier temps, d’organiser les pouvoirs, puis, dans ce que l’on pourrait appeler la seconde vague constitutionnelle, au tournant de notre siècle, de constitutionnaliser les droits et libertés. Mais un texte constitutionnel n’est pas seulement la description détaillée d’un certain équilibre des pouvoirs ou une liste pré-formatée de droits et libertés. C’est aussi un moment de définition et d’affirmation d’une identité.
Les constitutions arabes. S’agit-il des constitutions du monde arabe ou de constitutions « arabes » et en quoi alors sont-elles arabes ? Les réponses à ces questions, ou même le simple fait de se les poser nous conduit à avoir envers ces textes une lecture comparatiste que j’oserais qualifier d’« ethnologique ». Elle suppose en effet d’ôter les verres déformants nos prémisses culturelles pour rechercher, derrière des termes qui sont parfois communs, ou qui sont rendus tels par les traductions, la réalité de mondes différents.
Car ce terme d’arabe, que l’on retrouve effectivement au fil des textes évoqués n’est en fait presque jamais clairement défini. Une exception, celle de la constitution des Émirats arabes unis qui évoque une « grande patrie arabe » à laquelle cette fédération serait attachée par « les liens de la religion, de la langue, de l’histoire et du sort commun ».
Tout est dit ici des définitions croisées de l’arabité. D’une part, une histoire commune et la volonté de la poursuivre ensemble, dans ce qui est presque une paraphrase de la définition renanienne de la nation ; d’autre part, une langue et une religion partagées par les citoyens des divers États arabes. Mais est-ce si simple ?
À cause peut-être des actuelles divisions de cette « grande patrie arabe », l’approche supranationale, d’abord, se présente à la fois comme une donnée historique et comme un objectif.
L’histoire arabe partagée, la constitution égyptienne l’évoque ainsi en énumérant les grandes figures de sa renaissance. Mais ces hommes étaient unis dans une lutte qui mêlait souvent de manière un peu ambigüe patriotisme égyptien et nationalisme arabe.
La Syrie apporte elle une curieuse définition d’une arabité victimisée. « Tout au long de son histoire – énonce sa constitution -, la civilisation arabe, partie intégrante du patrimoine de l’Humanité, a été confrontée à d’énormes défis visant à briser sa volonté et à la soumettre à la domination coloniale. »
Mais l’histoire nationale de nombre de nos États n’est pas nécessairement uniquement arabe. Pour prendre deux exemples, l’État égyptien, dont on vient de voir qu’il honore les grands noms de l’idée arabe, précise en même temps qu’il défend l’héritage de l’Égypte « dans toute sa diversité et venant des périodes pharaonique, copte, islamique et moderne ». Quant au Maroc, il insiste lui sur une unité nationale « forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie », et, en sus, « nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen ».
Alors, nous l’avons dit, la grande nation arabe fait autant – sinon plus – partie de l’avenir que du passé. Le Bahreïn s’efforce « de réaliser les aspirations de la nation arabe à l’unité et au progrès ». L’Égypte « œuvre pour son intégration et son unité ». Quant à l’Arabie saoudite, elle s’efforce « de réaliser l’aspiration des nations arabe et musulmane à l’unité et à la solidarité ».
Puisque dès lors la coopération avec les autres États membres de cette nation arabe est nécessaire, il est fréquent de voir mentionner dans nos textes constitutionnels les liens avec la Ligue arabe, comme c’est par exemple le cas dans les constitutions des Comores, de l’Irak ou du Liban.
Pourtant, même dans cette perspective d’union future, le monde arabe n’est pas nécessairement présenté comme étant le seul cercle d’appartenance des différents États qui le composent. Combiné avec d’autres éléments, il semble même n’être pris que comme un aspect parmi d’autres d’une identité culturelle. La constitution algérienne évoque ainsi un « pays arabe, méditerranéen et africain », la mauritanienne un « peuple musulman, arabe et africain ».
Ressurgissent on le voit les diverses identités régionales. Il faut bien évidemment citer ici le Maghreb, à la fois comme appartenance géographique, mais sans oublier la référence à une organisation de coopération intégrée, l’Union du Maghreb arabe. On en trouve mention dans les constitutions de l’Algérie, de la Mauritanie, de la Tunisie et du Maroc.
Les pays d’Afrique, Algérie, Égypte, Tunisie, Mauritanie ou Maroc, évoquent également cette appartenance. Mais seules les Comores, affirmant leur attachement aux principes « définis par la charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ».
On peut retenir encore les solidarités « méditerranéennes » de l’Algérie, du Maroc ou de l’Égypte, et s’étonner enfin qu’en matière de coopération interétatique régionale seul le Bahreïn évoque son « association avec le Conseil de coopération du Golfe ».
On le voit, la référence historique arabe s’avère finalement plus instable qu’on pouvait le penser. Si l’appartenance identitaire arabe peut alors dépasser ces divisions géographiques, si elle peut réunir Maghreb et Machrek, c’est peut-être à cause de cet élément culturel essentiel qu’est l’usage d’une langue commune, d’où son importance dans les constitutions.
L’arabe est en effet langue « nationale et officielle » dans la plupart de nos textes constitutionnels. Elle est, comme telle, protégée au besoin. C’est le cas au Maroc, quand « l’État œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation ». Ou en Égypte, quand « l’État encourage la traduction de et vers la langue arabe ».
Pour autant cette officialisation n’est pas une obligation. La question s’est posée à la Ligue arabe qui disposait de deux critères pour définir l’adjectif « arabe » de son titre : d’une part, celui selon lequel la langue officielle de l’Etat postulant était l’arabe ; d’autre part, celui selon lequel la majorité de la population était arabe. Or c’est ce deuxième critère qui a été retenu lors de l’examen des demandes d’adhésion de la Somalie et de Djibouti, parce que la langue officielle de ces États n’était pas l’arabe.
De plus, l’usage d’une langue minoritaire, parfois reconnue comme une langue nationale à part entière, vient encore perturber une lecture trop rapide. En Algérie, le « tamazight est langue nationale ». En Mauritanie, « le poular, le soninké et le wolof, constituent, chacune en elle-même, un patrimoine national commun à tous les Mauritaniens ». Au Maroc « l’amazighe constitue une langue officielle de l’État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception ».
Mais c’est en Irak que la constitution est la plus détaillée sur ce point des différences linguistiques. D’une part, « le droit des Irakiens d’éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle comme le turkmène, le syriaque et l’arménien est garanti dans les établissements publics d’enseignement ». D’autre part, l’Irak compte deux langues officielles, l’arabe et le kurde, et la constitution elle-même précise que cela inclut l’usage des deux au Journal officiel, à la Chambre des députés, au Conseil des ministres, dans les tribunaux, les conférences officielles, les documents officiels, les écoles, et sur les billets de banque, les passeports ou les timbres.
Ajoutons que ces coexistences linguistiques sont rendues plus délicates encore alors que ces langues ne sont pas toujours fixées, et qu’il y a par exemple trois principales variétés de dialectes kurdes… et autant d’amazighes pour le seul Maroc.
On comprend les difficultés du critère linguistique. Mais en sus de cette nécessaire solidarité arabe qu’elle peut renforcer par son usage, la langue arabe est aussi, et surtout, la langue de l’Islam, religion d’État de nombreuses constitutions de notre monde arabe. Serait-ce alors l’élément identitaire prégnant ?
Il est vrai que le terme prend toute sa résonance à partir du moment où les conséquences de l’appartenance au monde islamique ne sont pas que religieuses. On le sait, l’Islam a vocation à irriguer le politique, étant, comme le précise fort justement la constitution du Bahreïn, en même temps « foi, code de lois et mode de vie ». L’Arabie saoudite représente bien sûr un cas à extrême puisque « le Saint Coran et la Sunna forment sa Constitution ».
Cette double facette de l’Islam a conduit – et conduit encore – certains de ses zélateurs à s’interroger sur la nécessité même de rédiger un texte constitutionnel. C’est le fameux slogan des Frères musulmans, repris depuis par bien des groupes : « Pas de constitution autre que le Coran ». C’est la question posée en 1966 par le roi Fayçal d’Arabie saoudite : « Une Constitution ? Pourquoi faire ? Le Coran est la Constitution la plus vieille et la plus efficace du monde ».
S’il y a donc malgré tout établissement d’une constitution, ce texte doit alors respecter les principes religieux. C’est ce que nous retrouvons bien sûr avec l’Arabie saoudite mais aussi dans nombre de constitutions qui prévoient la primauté de la Chari’a. Car c’est l’islam qui est « une source fondamentale de la législation » en Irak et en Mauritanie, mais c’est le plus souvent la Chari’a qui est évoquée.
L’État se trouve ainsi encadré et limité, dans l’édiction des normes mais parfois aussi au niveau institutionnel. Symboliquement par exemple, la plupart des textes fondamentaux de nos Etats arabes réservent la possibilité de l’accès à la fonction de chef de l’État aux seuls musulmans. L’exception, on le sait, est ici le cas du Liban, pays où le confessionnalisme politique influe sur le partage du pouvoir entre les différentes communautés religieuses présentes sur le territoire.
Reste que pour la solidarité islamique internationale on est loin de ce qui prévaut autour de la Ligue arabe, souvent citée on l’a dit. Plusieurs textes constitutionnels posent bien le principe. Aux Émirats arabes unis par exemple, « la politique étrangère de la Fédération vise à soutenir les causes et les intérêts islamiques ». Le Royaume du Maroc, où l’on rappellera que le souverain est aussi Commandeur des croyants, s’engage lui à « approfondir le sens d’appartenance à la Oumma arabo-islamique ». Mais seul le peuple des Comores « affirme son attachement aux principes définis par la charte de l’Organisation de la Conférence Islamique ».
Enfin, la dénomination de « religion d’État » ne doit pas faire oublier que nombre de ces textes constitutionnels précisent les conditions de libre exercice du culte des autres religions, ou que d’autres affirment leur vision d’un Islam modéré et ouvert qui ne semble pas être d’actualité partout.
Trois éléments de définition donc, l’histoire, la langue et la religion, et, l’on en conviendra, trois éléments plus divers qu’il n’y semble au premier coup d’œil. Trois éléments qui doivent souvent se combiner avec d’autres appartenances, avec d’autres solidarités, quand ce n’est pas avec d’autres identités. Bref, un monde de différences.
Cette perception différenciée du monde qui a produit ces constitutions arabes est aussi nécessaire lorsque les traductions nous renvoient à des termes faussement similaires aux nôtres.
C’est ainsi que nombre de constitutions arabes font usage du terme majilis al choura, ce que nous traduisons souvent par « assemblée » ou « parlement ». Mais de même que les parlements de notre Ancien régime n’étaient en rien comparables à nos assemblées parlementaires actuelles, de même certaines de ces assemblées sont dans une situation différente de nos organes législatifs occidentaux.
Il faut se rappeler que nous sommes dans un monde culturel musulman. Dans le cadre strictement religieux, la choura est un rassemblement de juges lettrés. Par extension, le terme peut effectivement désigner l’organe central d’un parti politique ou un parlement. Mais pour quel rôle ?
Comme rien dans le Coran ou les hadiths ne précise quel système politique doit adopter un État islamique, on a retenu, pour justifier l’établissement d’un régime parlementaire, le verset suivant du Coran : « Consulte-les sur toute chose ». Mais il faut lire le texte en entier. « Consulte-les sur toute chose ; mais, quand tu as pris une décision, place ta confiance en Dieu » ( Le Coran III. 159).
Nous sommes donc bien devant un organe consultatif, et pas nécessairement devant l’organe qui pourrait édicter la norme. Devant un organe aussi dont les membres tirent leur légitimité d’avoir été choisis par l’autorité qui les consulte, ce bon souverain qui fait le choix de bons conseillers, bien plus que d’une élection au suffrage universel.
C’est ainsi par exemple qu’au Bahreïn, où le préambule de la constitution décrit le système politique local comme étant « une monarchie constitutionnelle fondée sur la choura, le mode de gouvernement le plus élevé dans l’islam », le souverain n’est pas lié par les décisions prise par les institutions consultatives.
De plus, le majilis, littéralement le « lieu où l’on s’assoit », est aussi au Moyen-Orient la pièce de la maison utilisée pour recevoir famille et amis, une institution d’ailleurs inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2015. Dans un système clanique, qui reste prégnant dans le monde arabo-musulman, c’est le lieu où le chef de clan reçoit les commensaux et les clients.
Or l’institution persiste, notamment dans les pays du Golfe. Dans le majilis de tel ou tel, on débat aux yeux de tous et l’on y sollicite faveurs ou arbitrages. Il permet un mode de résolution des conflits parallèle au mode politique tel que nous le connaissons, avec son arbitrage par la loi.
Cette relation, à la limite du privé et du public, où l’autorité peut être – ou pas – titulaire d’un pouvoir ou d’une fonction politiques tel que nous l’entendons, conduit à une concurrence qui peut déligitimer la fonction purement politique. Pourquoi en effet faire une campagne politique, pourquoi militer si l’on peut plus efficacement faire changer les choses en agissant autrement ? Une question qui, d’ailleurs, ne concerne pas seulement le monde arabo-musulman…
Différences distance, prudence. Joseph de Maistre se posant la question « Qu’est-ce qu’une constitution ? » y répondait ainsi : « N’est-ce pas la solution du problème suivant ? Étant données la population, les mœurs, la religion, la situation géographique, les relations politiques, les richesses, les bonnes et les mauvaises qualités d’une certaine nation, trouver les lois qui lui conviennent ».
C’est le sens de notre ouvrage, qui tente de replacer systématiquement les textes constitutionnels dans le contexte géopolitique qui permet de les comprendre. Nous avons choisi de nous démarquer d’une analyse « purement juridique », abstraction soit inopérante, soit inquiétante si elle débouche sur l’idée d’un modèle constitutionnel qui aurait vocation à s’imposer à la planète entière.
Or le poids croissant des rapports émanant d’organismes onusiens, européens ou non gouvernementaux, organismes aux « experts » interchangeables et aux thématiques convenues, le poids aussi de leurs répercussions médiatiques, ont conduit en matière constitutionnelle à un glissement de l’institutionnel au juridisme.
Les constitutionnalistes attentifs à la mise en place subtile de ces poids et contrepoids qui fondent l’équilibre politique laissent alors la place à des spécialistes du contentieux prêts à tout sacrifier à l’absolue transcendance de leur idée du droit. On a pu dire avec dérision que le droit constitutionnel n’était jamais que le déguisement tardif de choix politiques. Peut-être, mais il avait alors au moins un lien avec la réalité, perdu pour le juriste qui se sent habité par une mission.
C’est pourquoi il importe de maintenir et de renforcer un dialogue constitutionnel qui doit être un dialogue des juristes et des politiques au moins autant qu’un dialogue des juges. Un dialogue qui doit certes passer par les contacts entre cours constitutionnelles, mais aussi par ces collaborations interparlementaires qui permettent aux législateurs des différents pays de comprendre, de l’intérieur, la réalité du fonctionnement des institutions étrangères.
Christophe BOUTIN
Professeur de droit public à l’Université de Caen, directeur des programmes de l’Observatoire d’études géopolitiques. Auteur de Le coup d’Etat, recours à la force ou dernier mot politique ?, codirection avec Frédéric Rouvillois, François-Xavier de Guibert, 2007 ; Les grands discours du XXe siècle, Flammarion, 2009 ; Sahara marocain, le dossier d’un conflit artificiel, codirection avec Charles Saint-Prot et Jean-Yves de Cara, éditions du Cerf, 2016.
Éditions Karthala, Collectif sous la direction de Christophe Boutin, Jean-Yves de Cara et Charles Saint-Prot, 348 pages, 24 €.
Cliquer ICI pour commander l’ouvrage








