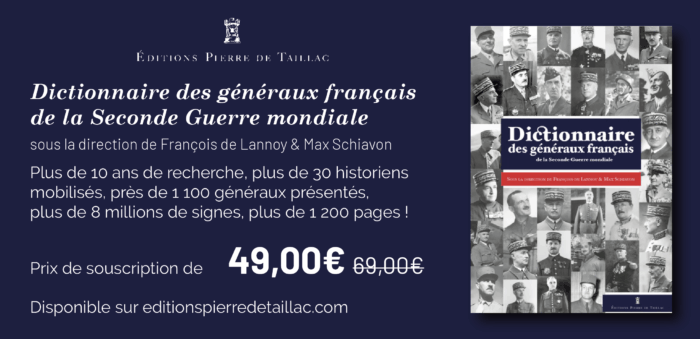L’histoire de la Seconde Guerre mondiale a été largement étudiée, mais il manquait un dictionnaire des 1 100 généraux français de la période. Il fallait deux historiens chevronnés pour mener à bien ce programme avec plus de 10 ans de recherche et plus de 30 historiens mobilisés. Un ouvrage appelé à devenir la référence et un outil de travail pour comprendre les élites militaires françaises de 1939-1945. Max Schiavon a bien voulu répondre à nos questions pour présenter ce travail.
Propos recueillis par Thierry Bouzard pour THEATRUM BELLI
***
Max Schiavon, vous êtes connu pour vos travaux sur le leadership efficace que vous avez enseigné en France et à l’étranger. Vous avez dirigé la recherche du Service Historique de la Défense et publié plusieurs biographies de généraux français (Gamelin, Weygand, Vauthier, Georges, Olry…). Vous avez donc une expertise dans les archives militaires, l’art du commandement et vous êtes familier de la 2e GM. D’où est venu le projet de ce Dictionnaire et comment l’avez-vous organisé ?
Au début des années 2010, j’ai beaucoup échangé avec François de Lannoy à propos des élites militaires françaises de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque nous avons voulu effectuer des comparaisons avec les généraux étrangers de la même période (âge/responsabilités, type de commandement, cursus, expérience combattante, etc), nous nous sommes aperçus que des études existaient à l’étranger, notamment en Allemagne ou un dictionnaire des généraux très complet fait autorité. Et côté français… Rien !
L’idée nous est naturellement venu de mettre en chantier un projet de longue haleine destiné à présenter tous les généraux français qui ont occupé un poste entre septembre 1939 et mai 1945.
Quant à l’organisation, nous avons de suite compris qu’il nous faudrait plusieurs années pour venir à bout de cette étude et que deux personnes ne suffiraient pas. Aussi nous avons fait appel à nos connaissances dans le monde de l’histoire pour participer, avec pour objectif de réunir des personnalités compétentes et enthousiastes.
Le plus difficile, au début, a été de définir quels généraux devaient faire l’objet d’une notice. En effet, il n’existait avant notre travail aucune liste exhaustive des généraux français entre 1939-1945. Nous avons donc utilisé toutes les sources disponibles : annuaires d’avant-guerre, annuaires d’après-guerre, Journaux officiels, notes de services, papiers du ministère de la Guerre, inventaires d’archives, témoignages, bibliographie, etc. Cela s’est avéré très, très compliqué : il a fallu près d’un an et certains généraux sont encore « réapparus » il y a 3 ans !
Avec François de Lannoy, vous avez déjà publié sur les généraux de la période (Les généraux français de 1940, ETAI, 2013 ; Les généraux français de la victoire, 1942-1945, ETAI, 2016), que va apporter votre ouvrage de nouveau par rapport à vos publications antérieures ?
Les deux livres que vous citez présentent en tout une cinquantaine de généraux alors que le Dictionnaire en contient 1 087 !
En outre, le croisement des archives, la connaissance de cette population a permis d’avoir une vision approfondie de leurs parcours et de mieux l’expliquer.
Le Dictionnaire va permettre d’avoir une vue globale de ce corps des officiers généraux, de leurs carrières, des qualités et des défauts de chacun mais aussi, par exemple, de savoir ce qu’ils ont fait après avoir quitté le service actif. Autre point : ces 1 087 généraux, c’est peu connu, ont publié des milliers de livres. Ils sont référencés dans le Dictionnaire.
Quelles sont les archives qui ont servi à votre équipe d’historiens ?
En premier lieu le dossier du général conservé au Service historique de la défense à Vincennes ainsi que des cartons contenant les archives des grandes unités. Ensuite la base numérisée de la Légion d’honneur, puis les archives départementales pour consulter l’état-civil afin de vérifier des points précis et déterminer qui étaient les ancêtres de ces généraux (sachant que tous les départements n’ont ou n’avaient pas encore numérisées leurs archives d’état-civil). La bibliothèque nationale a permis de recenser leurs publications. Nous avons aussi recherché les descendants de ces généraux pour savoir s’ils conservaient des archives privées. C’est ce qui nous a pris beaucoup de temps mais la moisson a été riche. Beaucoup de familles possèdent le dossier militaire de leur ancêtre, des papiers sur leur carrière et plusieurs dizaines ont rédigées de petites biographies familiales (parfois quelques pages seulement) qui nous ont été communiquées. Nous nous sommes aussi appuyés sur une bibliographie imposante : sans doute plus 4 000 livres ont été consultés.
Enfin certains « passionnés » nous ont aussi aidé : ainsi un chercheur recense les dizaines de milliers d’officiers qui ont participé à la campagne de 1939-1940, tandis qu’un autre poursuit toujours ses visites des cimetières de France pour y retrouver et inventorier les tombes des militaires qui y sont inhumés, etc. Ce Dictionnaire est donc bien une œuvre collective.
J’ajoute que toutes les pistes découvertes ont été suivies. La totalité du Dictionnaire a été relu par 4 personnes différentes pour corriger le maximum de coquilles, de fautes et harmoniser.
Nous avons rencontré nombre d’informations contradictoires, y compris dans le domaine de l’état-civil. Les noms propres de lieux sont mal orthographiés dans un cas sur 20 dans les citations de faits de guerre. Bien entendu, nous avons rectifié mais toujours après vérification. En un mot ce fut un travail de romain !
Il vous a fallu plus de 10 ans pour achever ces travaux. Tous les généraux ne sont pas traités de la même façon, quels ont été vos critères de tri et qu’avez-vous choisi de retenir dans les présentations de ces officiers ?
Nous avons choisi de présenter tous les généraux en activité ou rappelé au service entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945. Dans un premier temps nous avons éliminé les généraux placés à des postes territoriaux sans responsabilités opérationnelles. Par exemple un général âgé de 64 ans, rappelé en septembre 1939 pour commander la subdivision de Foix et replacé en 2e section dès novembre 1939. Puis, grâce au travail acharné d’un contributeur, nous avons décidé d’insérer malgré tout une notice succincte à leur sujet. Cela concerne une grosse centaine de généraux
De même les généraux de la Résistance (Chaban-Delmas, Bénouville, Moulin, etc.) font l’objet d’une notice courte car ils ont été promu à la fin de la Seconde Guerre mondiale et n’ont eu aucune activité militaire avant et après celle-ci.
En revanche, les colonels morts en déportation et promu généraux à titre posthume après le 8 mai 1945 mais pour prendre rang avant cette date, font l’objet d’une étude complète. Ils ont eu un comportement exemplaire non seulement au titre de la Résistance mais au cours de leur carrière militaire précédente et ils méritaient d’être sortis de l’oubli.
Les notices sont plus ou moins longues selon l’importance du général traité et son activité mais elles comportent des invariants : l’état-civil, le parcours (en terme militaire, l’état signalétique des services), les citations et grades dans l’ordre de la Légion d’honneur, surtout des appréciations aux moments cruciaux de la carrière : comme commandant de compagnie, de bataillon, de régiment, à l’École supérieure de guerre et au Centre des hautes études militaires (CHEM).
Ces appréciations portées à la connaissance du public sont une des grandes richesses de l’ouvrage.
Sans développer pourriez-vous lister quelques typologies de généraux et y associer quelques noms ?
Bien sûr. Cela n’a évidemment rien d’exhaustif :
- 5 généraux tués au combat : Ardant du Picq, Bouffet, Welvert, Jansen, Berniquet, Thierry d’Argenlieu.
- 5 généraux dans la Résistance : Bertrand, Gentil, Chouteau, Zeller, Dejussieu, de Grancey.
- 5 généraux morts en déportation : de Cugnac, Jouffrault, Dupuis, Mariot, Fresne de Virel.
- 5 généraux futurs parlementaires : Legentilhomme, Noiret, Billotte, Germain, Gilliot.
- 5 généraux dont les écrits ont marqué l’Histoire/qui sont devenus écrivains : Ingold, Weygand, Charbonneau, Jacomy, Clement-Grandcourt.
- 5 généraux méconnus qui méritent la lumière : Vauthier, Chédeville, Foiret (39 campagnes !), Beynet, Robert de Saint-Vincent.
- 5 généraux qui étaient de redoutables tacticiens : Guillaume, Leyer, Valluy, Koeltz, Marteau.
- 5 généraux assassinés par l’ennemi : Mesny, Lemmonier, Guillaut, Labat, Flament.
- 5 généraux qui ont connu une deuxième vie inattendue/surprenante/célèbre : Koenig, Pierre Billotte, Hurault, Péchot. Pechkov.
Le corps des officiers généraux évolue dans le long terme avec des personnalités suivies tout au long de leur carrière. Les bouleversements entraînés par la défaite de juin 1940, l’organisation de l’armée de l’armistice puis celle de la résistance et de la victoire, impactent les carrières, en bloquant certaines et en poussant d’autres. Vous avez quelques exemples ?
De 1940 à 1946, les membres des Forces françaises libres bénéficient d’un avancement accéléré, c’est le cas de Leclerc, de Koenig, de Larminat. de Brosset, de Legentilhomme, pour ne parler que des plus célèbres.
Mais les colonels ou généraux de l’armée d’armistice qui servent en Afrique du nord (donc qui n’ont pas rejoint de Gaulle) mais qui reprennent le combat en Tunisie fin 1942, en Italie avec le corps expéditionnaire français de Juin, puis en France avec la 1re armée de de Lattre, voient aussi leur carrière s’accélérer. Je peux citer Monsabert, Henri Martin, Vernejoul, Du Touzet du Vigier, Calliès, Sudre, etc.
Les carrières reprennent un cours quasi normal à partir de 1946, même si certains membres de « chapelles » ont tendance à se favoriser mutuellement jusqu’aux années 1970. Cela cesse ensuite parce qu’ils ont dépassé l’âge limite de service en activité.
- Auteurs : Sous la direction de François de Lannoy et Max Schiavon
- Editions : Pierre de Taillac
- Couverture : cartonnée
- Nombre de pages : 1 200 pages
- Format : 210 x 297 mm