Présentation du dossier 32 « Face aux ruptures, être prêt. »
Les lignes qui suivent visent à replacer l’article que vous allez lire dans le cadre général du prochain dossier du Cercle Maréchal Foch, « Face aux ruptures, être prêt ».
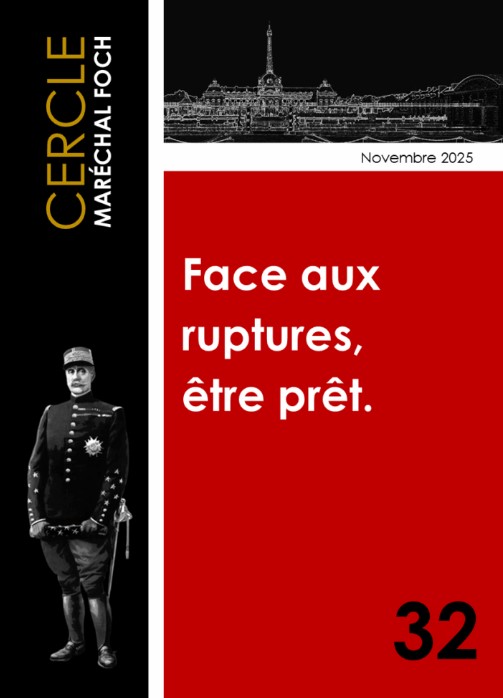 En effet, début 2025, le Cercle Maréchal Foch diffusait via THEATRUM BELLI son dossier de réflexion n° 31 « Le temps des ruptures ». S’appuyant sur le vote récent de la loi de programmation militaire 2024-30, le dossier prenait acte des nouvelles formes de conflictualité, du retour de la force désinhibée comme composante des relations interétatiques, du choc culturel que le retour de la guerre en Europe orientale constituait pour les populations « apaisées » de l’Union européenne, vivant dans un espace sans frontières, sans ennemi, sans idéologie collective…). On y évoquait les enjeux nationaux et internationaux, les défis technologiques et capacitaires, les questionnements éthiques et moraux qui découlaient de ce « changement d’époque ».
En effet, début 2025, le Cercle Maréchal Foch diffusait via THEATRUM BELLI son dossier de réflexion n° 31 « Le temps des ruptures ». S’appuyant sur le vote récent de la loi de programmation militaire 2024-30, le dossier prenait acte des nouvelles formes de conflictualité, du retour de la force désinhibée comme composante des relations interétatiques, du choc culturel que le retour de la guerre en Europe orientale constituait pour les populations « apaisées » de l’Union européenne, vivant dans un espace sans frontières, sans ennemi, sans idéologie collective…). On y évoquait les enjeux nationaux et internationaux, les défis technologiques et capacitaires, les questionnements éthiques et moraux qui découlaient de ce « changement d’époque ».
Un nouveau dossier, n° 32, est en cours de rédaction, intitulé « Face aux ruptures, être prêt ». Sans empiéter sur le rôle des organismes officiels et s’inspirant de la version 2025 de la revue nationale stratégique, il vise à dégager des principes généraux ou des orientations plus techniques qui pourraient soutenir les réflexions de tous ceux que le sujet de la défense nationale, dans le cadre européen, intéresse et, aujourd’hui, préoccupe. Ce dossier se refuse à un pessimisme qui encombre souvent les analyses de la situation actuelle et, en contrepoint de ce pessimisme du chemin à parcourir, entend mettre en avant un optimisme d’action et du but atteignable. Il entend cependant rester lucide et réaliste en s’appuyant sur l’expérience du passé, lointain comme plus récent…
Les allusions à « l’entre-deux guerres » étant nombreuses aujourd’hui, la première partie du dossier regroupera quelques éclairages sur les années 1935-1940. Il ne s’agit pas réécrire « L’étrange défaite » sans le talent de Marc Bloch, mais de choisir dans les prémices de la catastrophe de 1940 quelques instants où, avec le recul, il paraît incompréhensible qu’un voyant rouge ne se soit pas allumé sur le tableau de bord national, ou plutôt, s’étant allumé, pourquoi il fut si difficile de se préparer à l’épreuve qui s’annonçait.
Plus près de nous, la deuxième partie fait appel directement à nos rédacteurs, tous acteurs de la fin de guerre froide et de « la guerre mondiale de la France » pour reprendre le titre d’un livre récent de Michel Goya. À partir de la fin des années 1970, et surtout de 1990, les armées françaises (et l’on s’intéressera plus particulièrement à l’armée de Terre) ont été placées dans des situations opérationnelles imprévues, lointaines et exigeantes, dans un contexte de réduction de leurs moyens. De l’avis général, si les buts politiques furent loin d’être toujours atteints, les buts militaires le furent, avec plus ou moins de publicité, au prix d’efforts, y compris humains, souvent occultés. Cette partie récapitulera certains de ces efforts et permettra, nous l’espérons, de croire au « succès des armes de la France » pour les défis qui s’ouvrent désormais à nos armées.
La troisième partie se lancera dans l’exercice de la prévision dont on sait la difficulté, surtout, pour reprendre la boutade célèbre, lorsqu’elle traite de l’avenir. Il s’agira en fait d’un exercice de conviction de la part de rédacteurs qui, forts de leur expérience passée mais également de leur enracinement dans les réalités du moment, mettront sur la table « de la nourriture pour l’esprit », sans obligation de consommer !
Innovation majeure par rapport aux dossiers précédents, nous avons choisi de ne pas attendre d’avoir réuni l’ensemble des contributions de ce dossier n° 32 pour les mettre à la disposition de nos lecteurs. Elles seront publiées par THEATRUM BELLI au fur et à mesure de leur disponibilité, avant d’être réunies sous une forme complète. Vous trouverez donc ce rappel du but général et de l’articulation du dossier en tête de chaque publication, accompagné de l’indication de la partie à laquelle elle se rattache.
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’heure est au « réarmement » de l’Europe occidentale et à « l’économie de guerre ». Bien que l’Histoire ne se reproduise jamais dans un contexte général et selon des modalités identiques, le rappel des conditions dans lesquelles la France tenta de se réarmer en urgence à partir du milieu des années 19301 n’est pas inutile pour éclairer les défis que pose le réarmement actuel.
***
Alors que dans une partie de l’inconscient collectif national, les quatre gouvernements de Front Populaire sont assimilés à des gouvernements au pacifisme exacerbé, et même pour certains, responsables, en tant que tels, de la défaite, c’est l’exact contraire qui se révèle conforme à la vérité historique.
C’est à ce titre que, lors du procès de Riom où il comparaissait en tant qu’accusé, le président Léon Blum, en assurant lui-même sa défense a fait tourner ce procès en dérision vis-à-vis de l’accusation à un point tel que les autorités d’occupation ont dû intervenir auprès de Vichy pour l’ajournement sine die de ce procès.
Quels sont les faits ?
Peu après son arrivée au pouvoir, en juin 1936, le président Léon Blum avait demandé à l’état-major de lui préparer une étude sur la politique militaire et de lui chiffrer les besoins de la France en matière d’armements. En effet, confronté à l’impossibilité d’intervenir en Espagne, à la suite du refus britannique, le président Léon Blum en a tiré comme conclusion que la guerre devenait inéluctable en Europe, à moyen terme. Recevant le général Gamelin, il lui déclare : « Il ne faut pas que vous ayez de crainte, je suis bien conscient des dangers ». Ce dernier, reprenant une étude transmise par l’EMA l’année précédente lors du rétablissement de la conscription par l’Allemagne, chiffrait les besoins à 9 milliards (qu’il n’avait jamais obtenus des gouvernements précédents).
Daladier, ministre de la Guerre du Gouvernement de Front populaire juge alors ce montant insuffisant et le porte à 14 milliards étalés sur quatre ans2. Cet effort sera encore considérablement amplifié par la suite par un programme complémentaire au printemps 1938 d’un montant de 12 milliards, qui privilégiait tout particulièrement les armements antiaériens suivi par un nouveau programme au printemps 1939 d’un montant de près de 65 milliards. Ce gigantesque programme étalé sur quatre ans a été voté en mars 1939 (dont un plan complet de rénovation de la Flotte3), à la suite de l’annexion de la Bohême -Moravie par l’Allemagne, annonçant la guerre prochaine. Le hiatus, c’est que ce plan venant à échéance en 1943, cela signifiait que la France ne serait pas « prête » à affronter l’Allemagne avant cette date, 1942 a minima : c’était la rançon de quinze ans de laisser-aller en matière de budgets de défense nationale. Finalement, du 1er janvier 1937 à la guerre, sans tenir compte de la très forte inflation régnant ces années-là, ce seront 57 milliards qui seront affectés aux dépenses d’équipement.
Un Parlement unanime ?
À la suite de cette décision initiale, prise le 7 septembre 1936, ce sont 550 millions qui sont immédiatement débloqués4. À la Chambre, les députés du parti communiste français, qui ne participe pas directement au gouvernement mais le soutient, votent pour ce programme5. Les députés de droite s’abstiennent (officiellement pour ne pas passer pour des bellicistes fauteurs de guerre, en réalité, pour ne pas à avoir à accorder leurs voix à Blum !). Il convient de noter que, jusqu’à la chute du gouvernement Blum, et même au-delà, le parti communiste votera sans exception tous les budgets et crédits militaires, aériens et navals. En revanche, ses députés s’abstiendront lors des votes de politique étrangère en signe de protestation contre la décision de non-intervention en Espagne.
Pour ce qui est de ce plan de réarmement, de septembre 1936, un organe de presse de droite modérée, conservatrice et catholique bon teint, L’Illustration, pas forcément très favorable au gouvernement de Front populaire, écrit néanmoins6 : « (…) Dans un ordre d’idées analogue, c’est le même gouvernement de Front populaire qui a pris l’initiative de proposer les plus fortes dépenses militaires qui aient été proposées à la France depuis la guerre : 14 milliards de crédits supplémentaires répartis sur quatre années. C’est ainsi que les circonstances imposent parfois leurs nécessités aux doctrines ».
L’argument des lois sociales, notamment les « quarante heures » a également été mis en avant, lorsque les travailleurs allemands connaissaient des rythmes de soixante heures (dix heures de travail journalier durant six jours par semaine). Il convient quand même de considérer que la nature des deux régimes politiques n’était pas la même !

Réarmer, avec quelle industrie ?
Par ailleurs, cet argument est à mettre en parallèle avec l’inadaptation et la vétusté de l’appareil de production d’armement français. Il était essentiellement constitué de petites entreprises et ateliers familiaux, en mesure de concevoir et de produire des prototypes, mais totalement inadaptés à la production de masse. C’est le cas notamment des ateliers blindés7 et d’avions.
Il fallait attendre les effets des grandes lois structurelles votées le 6 août 1936, visant à nationaliser l’industrie d’armement autour de grands groupes comme AMX (Ateliers d’Issy-les-Moulineaux), nés de la nationalisation de la composante « armement blindé » de Renault en 1936, (ou les ateliers de production de canons Schneider au Creusot, ou encore les ateliers de production de canons antichars et antiaériens Hotchkiss de Levallois, ou enfin, les ateliers Brandt de fabrication de mortiers, transformés en arsenaux d’État). De plus, il fallait que l’État puisse y consacrer les investissements nécessaires à leur modernisation, gage de leur adaptation à la production de masse, et surtout standardisée8. C’était chose faite début 1938, lorsque le gouvernement décida de surseoir à la loi de quarante heures dans l’industrie de la Défense nationale, pour la porter d’abord à 48 heures puis successivement l’augmenter. Ainsi, en mars 1939, les établissements travaillant pour la défense nationale pouvaient travailler légalement jusqu’à 60 heures par semaine, la durée du travail étant même portée à 72 heures hebdomadaires en 1940.
Pour permettre la budgétisation de ces plans d’équipement, le Gouvernement Blum a décidé de recourir à un grand emprunt dit de la « Défense nationale » en mars 1937. Dans son discours de présentation, Léon Blum, soulignant le libéralisme des dispositions prises dans l’ordre monétaire, formula le vœu que le rapatriement des capitaux, qui avaient fui à l’étranger en juin 1936, s’investisse dans l’emprunt national. Cet emprunt devait être émis en franc, en livre sterling et en dollar, c’est-à-dire les devises des pays signataires de l’accord monétaire de stabilisation, de septembre 1936, signé entre Washington, Londres et Paris. Ainsi, le coupon émis devait-il se trouver à l’abri des fluctuations de la parité de ces monnaies entre elles.
L’Union nationale des combattants, dont on sait le rôle que ses membres parisiens ont joué dans les affaires de février 1934, approuva ces mesures, ainsi que diverses personnalités du monde politique, notamment, le président de la République, et les présidents des Chambres ; même le cardinal Verdier, archevêque de Paris, donna publiquement son approbation à l’emprunt de Défense nationale. Mais il fallait que le Parlement votât en faveur de cet emprunt, ce qui fut effectif, par 402 voix contre 32. Lors du débat, Jacques Duclos apporta le soutien du parti communiste. L’opposition des voix « contre » ne vint que de la part d’individualités de la droite. Quant au Sénat, il adopta le projet à la quasi-unanimité des votants, à l’exception notable d’un sénateur socialiste pacifiste du Puy-de-Dôme, Pierre Laval, qui vota contre. L’ouverture de la souscription fut fixée au 12 mars 1937, avec un taux d’intérêt de 4,5%, le prix d’émission à 98 francs et la première tranche limitée à 5 milliards.
Le résultat dépassa toutes les espérances : l’émission fut couverte dans la journée et la clôture prononcée le soir même. Même la CGT avait souscrit pour un montant de 250 000 francs, ce qui était considéré comme un exemple donné à ses fédérations. Le mardi suivant, 16 mars, la deuxième tranche d’un montant de 3 milliards fut couverte dans la journée. Les tranches suivantes remportèrent le même succès.
Les seules oppositions réelles à cet emprunt de Défense nationale sont venues des néo-socialistes de Marcel Déat et Adrien Marquet (L’éditorialiste de L’œuvre, Marcel Déat, titrera en mai 1939 un peu avant l’entrée en guerre, « Mourir pour Dantzig »9) ainsi que d’organes presse extrémistes de la droite dont l’opposition envers Léon Blum était autant de nature antisémite que politique.
Ainsi, l’idée selon laquelle le gouvernement de Front populaire aurait été le fossoyeur de la défaite en négligeant la Défense nationale par une priorité exclusive à la question sociale ne résiste pas à l’analyse. En matière de définition de la réalité de la politique suivie, les meilleurs indicateurs en ont toujours été les votes budgétaires et ceux de politique étrangère.
Ceci écrit, il n’en demeure pas moins que cet effort, colossal en matière de réarmement, aboutit à ce l’armée française dispose en 1939 de plus de chars que la Wehrmacht, souvent mieux blindés et mieux armés, avec cependant le défaut majeur d’être équipés d’une tourelle monoplace rendant extrêmement complexe le rôle du chef de char. Mais ce qui a fait la différence n’est certainement pas quelque rapport de force blindé quantitatif, voire qualitatif, que ce soit, mais une doctrine d’emploi innovante de la part de la Wehrmacht, même si, il convient de le souligner, le commandement allemand était loin d’être unanimement acquis aux idées développées par la jeune école blindée allemande, autour du triptyque char–avion–poste radio. Mais cette théorie a bénéficié du soutien du pouvoir politique, ce qui, dans un État totalitaire, est capital.
Enfin, si l’Armée et la Marine ont pu bénéficier des effets de cet effort de réarmement avant 1939, ce ne fut guère le cas pour l’armée de l’Air pour des raisons structurelles. La production aéronautique française se trouvait, avant 1936, disséminée entre une multitude d’unités relevant plus de l’atelier que de l’usine. Il en est résulté une dispersion des efforts en termes de production que la création récente de l’armée de l’Air en 1933 n’avait pas encore pu pallier.
Les grandes lois de nationalisation de 1936 allaient bien dans une direction de saine rationalisation et vers une production de masse, mais il fallait des délais pour faire évoluer un appareil productif aéronautique vieillot et dispersé. Les premiers effets ne se feront sentir qu’en 1938. Il ne faut pas perdre de vue que, si Édouard Daladier, alors président du Conseil, a dû se résoudre contre son gré, à suivre Chamberlain dans sa logique de capitulation à Munich, c’est qu’il savait la France totalement surclassée en matière aéronautique.
En conclusion, l’exemple français d’avant-guerre démontre à l’envi que tout effort de réarmement s’inscrit toujours dans le long terme, supporte difficilement les à-coups budgétaires et ne saurait, à lui seul, remettre à flot un système de défense malmené par des illusions préalables. En 1928 si, en pleine illusion lyrique, Aristide Briand pouvait s’écrier à la tribune de Genève « Arrière les canons, arrière les mitrailleuses, la guerre est devenue hors la loi », la grande crise qui allait déferler sur le monde au tout début des années trente, aboutit rapidement à l’instauration d’un régime totalitaire en Allemagne qui ne cachait nullement son intention de recourir à la guerre. Ce régime allait s’engager dans la voie du réarmement massif dès 1934, deux ans avant la France. Ce retard ne sera jamais comblé.
En 1939, outre le fait que l’armée française soit entrée en guerre avec un commandement défaillant, le modèle d’armée auquel son organisation politico-militaire avait abouti se révéla inadapté et surclassé par une armée qui, même dans la pire des situations réduite à sa plus simple expression en 1919, n’avait jamais succombé aux chants de sirènes pacifistes.
***
De cet épisode qui se conclut par la catastrophe de 1940, il est possible de tirer quelques enseignements.
Par leur essence même, les sociétés démocratiques fondées sur l’état de droit et une approche pacifiée des relations internationales sont naturellement enclines à repousser toute volonté de puissance, surtout fondée sur l’outil militaire, et d’en payer le prix social et financier. Ce n’est que la « montée des périls » (face à l’Allemagne national-socialiste des années 1934-38) ou un choc violent (Remilitarisation de la Rhénanie, guerre d’Espagne, Pearl Harbour) qui les entraînent sur la voie du réarmement et de l’action guerrière, à condition que leurs dirigeants soient à la fois lucides et suffisamment persuasifs pour surmonter les atermoiements et les oppositions qui ne manquent de s’exprimer.
Réarmer, ou accélérer un programme de développement capacitaire, réclame toujours un effort financier qui sort du cadre normal des budgets que la Nation peut supporter. La France des années 1930 finança son réarmement par le recours à l’emprunt ou à des avances de la Banque de France, alimentant des instruments financiers hors budget (compte spécial, caisse autonome de Défense nationale). De nos jours et dans le contexte économique national et européen, cette logique se retrouve dans les instruments mis en place par la France (fonds Défense ouvert aux particuliers, de Bpifrance) ou par la Commission européenne pour faciliter l’accès des États membres à des sources de financement communautaire spécifiques.
En amont des ressources financières, la capacité industrielle constitue le goulot d’étranglement du réarmement. Dans les années 1930, la nationalisation par le Front Populaire d’une industrie de défense vieillotte et émiettée permit sa modernisation technique sans pour autant accélérer sa montée en puissance rapide du fait du climat social et de la méconnaissance des réalités industrielles par les états-majors (le « complexe militaro-industriel » n’était pas encore né !). Dans le domaine aéronautique, en dépit de quelques belles réalisations techniques, il fallut se résoudre à se tourner vers les États-Unis pour chercher trop tardivement « la masse ». Si la situation actuelle n’est pas comparable, l’intégration de l’industrie de défense dans l’économie de marché, la difficulté d’accès au financement des investissements industriels et la juxtaposition de grands groupes installés et d’un tissu mouvant de nouveaux entrants de tailles diverses, impose de maintenir un certain dirigisme étatique (national ou communautaire).
Enfin, dans la mesure où tout « réarmement » répond à la mise en évidence d’une menace nouvelle ou identifiée comme telle, l’expérience des années 1930 montre qu’il doit être accompagné, et si possible précédé, d’une vision claire des besoins et de l’organisation des moyens. L’incapacité structurelle et intellectuelle du commandement militaire de cette période, hormis quelques esprits brillants mais isolés, ne permis pas au réarmement à marche forcée de s’adosser à la « révolution dans les affaires militaires » qu’annonçait la guerre d’Espagne.
NOTES :
- Outre les sources référencées, voir G. Bonnefous, l’Histoire politique de la IIIe République, Paris, P.U.F. 1986, Tome VI, pp. 98 et suivantes.
- Général Gamelin, Servir, Paris, Plon, 1948, Tome 2, p. 246. Ce différentiel entre les 9 milliards exprimés par l’EMA et les 14 alloués par le ministre, venait des besoins des Directions d’armes qui n’étaient pas subordonnées au chef d’état-major, mais directement au ministre.
- Deux porte-avions, deux « sister ships » des Richelieu et Jean Bart et la généralisation de l’Asdic. Ce plan ne verra jamais le jour.
- Pour employer des termes modernes, ces 550 millions de francs correspondent à des crédits de paiement (CP), tandis que les 14 milliards correspondent eux, à des autorisations d’engagement (AE).
- Qui s’identifie un peu aux actuelles lois de programmation, puisqu’il s’agit d’arrêter, dans un cadre quadriennal, les investissements au titre de l’équipement des forces.
- L’Illustration, n° 4882, 20 septembre 1936, p. 93.
- L’inadaptation des ateliers français était telle, qu’une image de propagande a circulé, montrant une double chaîne de production de chars B1 bis, alors que la chaîne était unique.
- C’est ainsi, qu’en matière de blindés (infanterie et cavalerie confondues), entre 1935 et 1939, l’armée est passée d’un parc articulé autour de 13 modèles en 1935 à 7 en 1939.
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Mourir_pour_Dantzig_%3F






