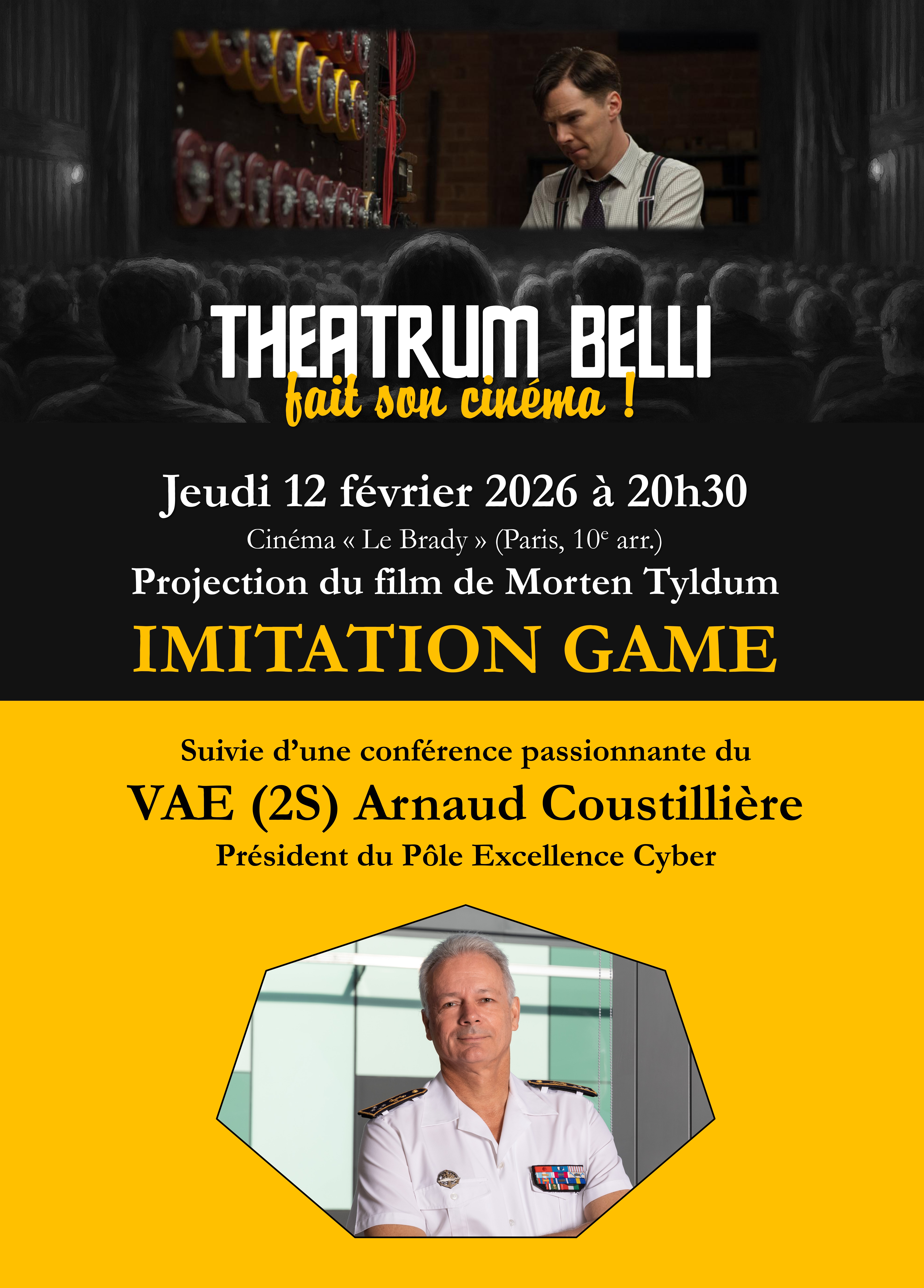La naissance de l’armée française s’est faite dans la douleur mais dès ses premières années d’existence, elle a su faire preuve d’une redoutable efficacité, mettant ainsi un terme à la guerre de Cent Ans. Retour sur ses origines.
Les balbutiements de l’armée permanente
Une armée, au sens moderne du terme, est une force permanente, composée de professionnels, financée par l’impôt et placée au service d’un pouvoir légalement constitué. Dans l’histoire de France, il faut attendre le règne de Charles VII pour voir l’émergence d’une telle institution. Jusqu’alors, et durant tout le Moyen Âge, le roi s’appuyait sur le ban et l’arrière-ban de ses vassaux et sous vassaux pour lever une armée, ces derniers étant tenus de le servir pendant une durée limitée. Ce système, simple en apparence, n’était pas exempte de défauts.
En effet, la loyauté plutôt fluctuante des nobles pouvait mettre à mal une campagne militaire engagée par le roi. En outre, en plein affrontement, certains vassaux n’hésitaient pas à combattre chacun de leur côté, sans considération stratégique ni tactique. Ce n’est qu’à la fin du Moyen Age et notamment durant la guerre de Cent Ans que l’armée permanente va voir le jour au sein du royaume de France.
Au début du conflit, les Français durent faire face à une armée anglaise déjà professionnalisée et dotée d’un fort esprit de corps, deux atouts qui faisaient cruellement défaut aux forces du roi de France. Les lourdes défaites de Crécy (1346) et de Poitiers (1356) remirent ainsi en cause le modèle militaire basé sur le système féodal.
Suite au désastre de la bataille de Poitiers, le roi de France Jean II le Bon est capturé et fait prisonnier par les Anglais. Son fils, le futur Charles V, élabore alors une nouvelle stratégie : éviter les batailles rangées et renforcer les fortifications des villes stratégiques pour empêcher qu’elles ne tombent aux mains de l’ennemi.
A la mort de son père, en captivité à Londres en 1364, il convoque les États généraux à Amiens afin de lever un impôt destiné à financer une armée permanente d’environ 6 000 hommes, soldée mensuellement et placée sous le contrôle du pouvoir monarchique. Les effectifs sont avant tout composés de volontaires de la petite noblesse[1].
Sous le commandement du célèbre Du Guesclin, cette nouvelle armée remporte dès la même année une victoire décisive à Cocherel contre les Anglais, ouvrant ainsi la voie au sacre de Charles V.
Tout au long de son règne, avec l’appui de son connétable Du Guesclin, il mène une politique de reconquête méthodique de son royaume, parvenant à le reprendre en grande partie.
Toutefois, rien ne laissait présager une volonté royale de maintenir durablement cette armée une fois les territoires repris. En effet, au début du règne de Charles VI, et notamment en raison d’une grave crise financière, cette force se dissout progressivement. Ce démantèlement s’avère désastreux : la terrible défaite d’Azincourt en 1415, combinée à la folie du roi, anéantissent les efforts de reconquête patiemment menés par son prédécesseur. Tout est à refaire, et le royaume se retrouve en grand péril.

De désastres en désastres jusqu’à la victoire

Peu après le traité de Troyes en 1420, qui désigne le roi d’Angleterre Henri V comme héritier légitime de la couronne de France à la mort de Charles VI, le dauphin, futur Charles VII et véritable héritier du royaume, se réfugie à Bourges.
Pour faire face à la menace anglo-bourguignonne, Charles VII ne dispose que de ressources limitées. Dans l’espoir de chasser les Anglais de France et tenir en respect leur allié bourguignon, il sollicite l’appui de mercenaires écossais sur le fondement de l’Auld Alliance. Malgré des débuts prometteurs, ces renforts se font sévèrement étriller à la bataille de Verneuil en 1424. Toutefois, l’armée royale parvient tout de même à infliger de lourdes pertes à l’ennemi.
C’est pourtant au fond de l’abîme que la France amorce son redressement. En 1429, Jeanne d’Arc joue un rôle déterminant, de part la ferveur qu’elle suscite, elle remotive les troupes et participe à la libération d’Orléans. Cette victoire est le point de départ de la campagne victorieuse sur la Loire. L’armée royale remporte notamment l’importante victoire de Patay, où l’élite des archers anglais est décimée. A cette époque, le roi de France privilégie les mercenaires pour combattre l’ennemi héréditaire. Mais la problématique étant que lorsque ces troupes sont démobilisées, elles vivent sur le pays et cause de nombreux dégâts sur des populations sans défense.
Le tournant décisif pour la création de cette armée permanente survient en 1435 avec la paix séparée entre la France et la Bourgogne, scellée par le traité d’Arras, elle permet d’isoler l’Angleterre sur le continent. L’arrivée de Jacques Cœur, argentier du roi, contribue également à restaurer les finances royales dont aura besoin le roi pour ses réformes.
La mise en place des compagnies d’ordonnance
Dans un premier temps, l’ordonnance d’Orléans du 2 novembre 1439 instaure un impôt permanent, la « taille », destiné d’une part à financer des troupes placées directement sous l’autorité du roi et d’autre part à mettre fin aux pillages des bandes de mercenaires. Puis, une fois les finances consolidées, les compagnies d’ordonnance voient le jour, vraisemblablement au premier trimestre de l’année 1445. L’ordonnance originelle instaurant ces compagnies a été perdue, néanmoins une copie en catalan a été retrouvée grâce à des recherches archivistiques[2].
Celle-ci ajoute quelques informations par rapport à l’ordonnance de Louppy le Chatel souvent cité par les historiens et datant du 26 mai de la même année. Ainsi l’ordonnance originelle fixe l’ensemble des contingents à 1 500 lances soit 3000 archers, 6 000 combattants et 9 000 chevaux.
Une lance étant composée d’un homme d’armes, trois chevaux, un coutilier, un page ainsi que de deux archers avec trois chevaux. Les chevaux permettent aux hommes de se déplacer rapidement mais seuls les hommes d’armes les utilisent au combat. Les coutiliers quant à eux combattent à pied et disposent d’un équipement disparates, ils utilisent aussi bien des haches, des épées ou encore des hallebardes. Pour les archers ils sont équipés d’arc et disposent d’une dague ou d’une épée longue pour se défendre. Dans le sud du royaume on préfère utiliser l’arbalète.
La première ordonnance désigne vingt et un grands capitaines. On y retrouve notamment : le connétable de Richemont, Poton de Xaintrailles et Jean de Bueil dit « le fléau des Anglais » anciens compagnons de route de Jeanne d’Arc, ou encore des anciens mercenaires étrangers comme l’écossais Robin Pettilow.
Ces hommes sont avant tout sélectionnés sur des critères de noblesse, de fidélité et de compétences militaires. Conformément à l’ordonnance le chef de lance recrute lui-même les hommes qui composeront sa lance.
Charles VII n’hésite pas à puiser dans le vivier important que constituent les écorcheurs, de véritables entrepreneurs de guerre pratiquant le pillage et le rançonnement qui sont avant tout des troupes démobilisées faute de moyens financiers.
Ils sont également des professionnels de la guerre capable de réaliser toutes sortes d’opérations militaires : sièges, batailles rangées, chevauchées etc. Ce sont des combattants féroces, bien loin de l’esprit chevaleresque qui dominait encore au siècle précédent. En tant qu’anciens mercenaires ils sont relativement bien équipés.

Vie et combat au sein d’une compagnie d’ordonnance
L’homme d’armes, qui est le véritable chef de lance, doit s’assurer du bon entretien de ses hommes et de leurs montures. De même, des officiers royaux veillent à ce que ces dispositions soient respectées sous peine de licencier les soldats les plus mal entretenus et indisciplinés. Si tel est le cas, la lance est dite « cassée ».
De 1445 à 1450, la revue de troupes avait lieu tous les mois, la solde était versée à ce moment-là. Après 1450, elle a lieu tous les trois mois. Malheureusement, ce nouvel intervalle qui devient trop important favorise l’indiscipline.
Enfin, chaque soldat a un rôle bien défini : le page s’occupe de l’intendance du coutilier et du chef de lance. Le valet quant à lui sert les archers. Cette armée, malgré ce début d’uniformisation, reste encore très diversifiée de par le matériel éclectique adopté par des hommes de différentes provinces. Chacun a son propre blason auxquels se rajoute ceux de la noblesse aux postes de commandement.
Les autres membres de la lance arboraient également sur leur tenue une croix blanche apposée sur un fond de couleur rouge, par opposition les Anglais portaient une croix rouge sur fond blanc.
Tous ces hommes sont soldés par le roi et lui sont fidèles. Le poète de la Renaissance Guillaume Drevyn illustre ce que devait être le serment original qui malheureusement n’est pas parvenu jusqu’à nous. Ainsi, il nous rapporte que les compagnons d’ordonnance s’engageaient à faire «vaillamment tout ce que leur seigneur leur commandera », de ne jamais abandonner leur compagnie ou de fuir « la mort pour le bien de la chose publique ».[3]
Le système évite la résurgence du phénomène des « écorcheurs » ; les troupes sont désormais sédentarisées dans des bourgs qui acceptent non sans mal d’obéir à l’autorité royale. Bon an mal an la cohabitation tient, mais dès 1449 soit quatre ans plus tard après la mise en place de l’ordonnance, la trêve entre les deux ennemis héréditaires est rompue.
Les compagnies d’ordonnance quittent leurs garnisons pour opérer d’abord en Normandie puis en Guyenne. La campagne de Normandie va révéler l’efficacité de ces troupes avec la bataille de Formigny en 1450. Ces troupes professionnelles tiennent le choc pendant trois heures face à des Anglais deux fois supérieurs en nombre, jusqu’à l’arrivée du connétable de Richemont qui permet d’emporter la victoire. Suite à cela, la Normandie retrouve le giron français.
De 1451 à 1453 deux campagnes sont nécessaires pour reconquérir la Guyenne qui depuis plus de deux siècles est restée fidèle aux Anglais. La première campagne, malgré de violents combats, est achevé en quelques mois et Bordeaux tombe rapidement.
Lors de la seconde campagne de Guyenne, suite au retour des Anglais, les compagnies d’ordonnance emportent encore une fois la victoire contre les Anglais à Castillon en 1453 grâce à l’emploi combiné de l’artillerie de campagne, de l’infanterie et d’une charge de cavalerie dévastatrice.
En seulement quatre ans, Charles VII a su réorganiser le système militaire français et jeter les bases d’une armée permanente, dont la France n’a jamais eu à rougir face aux nombreux conflits qu’elle a traversés jusqu’à aujourd’hui.

Si vous souhaitez plonger au cœur de l’armée française de cette époque et découvrir des aspects méconnus de la bataille de Castillon, commandez dès maintenant votre exemplaire en cliquant ICI pour commander sur Amazon ou ICI directement sur le site de l’éditeur.
NOTES :
- Françoise Autrand, Charles V : le Sage, Paris, Fayard, 1994.
- Stéphane Péquignot, De la France à Barcelone. Une version catalane de « l’ordonnance perdue » de Charles VII sur les gens d’armes (1445), Revue historique 2015/4 n° 676.
- Histoire militaire de la France, t.1, « Des Mérovingiens au Second Empire », Hervé Drévillon et Olivier Wieviorka (dir.), Perrin, 2018.