Présentation du dossier 32 « Face aux ruptures, être prêt. »
Les lignes qui suivent visent à replacer l’article que vous allez lire dans le cadre général du prochain dossier du Cercle Maréchal Foch, « Face aux ruptures, être prêt ».
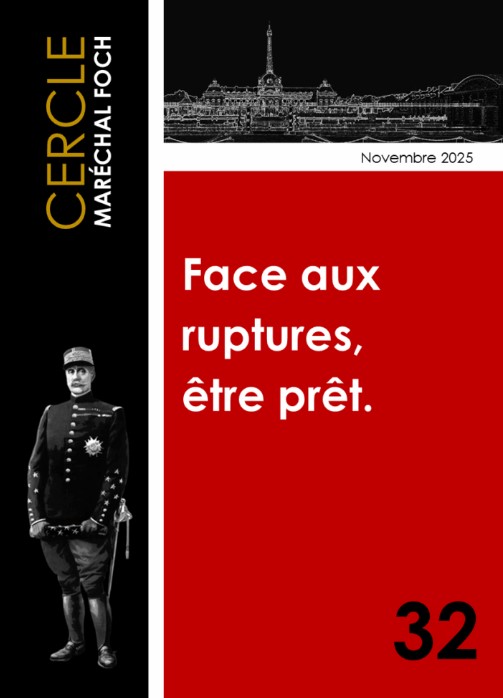 En effet, début 2025, le Cercle Maréchal Foch diffusait via THEATRUM BELLI son dossier de réflexion n° 31 « Le temps des ruptures ». S’appuyant sur le vote récent de la loi de programmation militaire 2024-30, le dossier prenait acte des nouvelles formes de conflictualité, du retour de la force désinhibée comme composante des relations interétatiques, du choc culturel que le retour de la guerre en Europe orientale constituait pour les populations « apaisées » de l’Union européenne, vivant dans un espace sans frontières, sans ennemi, sans idéologie collective…). On y évoquait les enjeux nationaux et internationaux, les défis technologiques et capacitaires, les questionnements éthiques et moraux qui découlaient de ce « changement d’époque ».
En effet, début 2025, le Cercle Maréchal Foch diffusait via THEATRUM BELLI son dossier de réflexion n° 31 « Le temps des ruptures ». S’appuyant sur le vote récent de la loi de programmation militaire 2024-30, le dossier prenait acte des nouvelles formes de conflictualité, du retour de la force désinhibée comme composante des relations interétatiques, du choc culturel que le retour de la guerre en Europe orientale constituait pour les populations « apaisées » de l’Union européenne, vivant dans un espace sans frontières, sans ennemi, sans idéologie collective…). On y évoquait les enjeux nationaux et internationaux, les défis technologiques et capacitaires, les questionnements éthiques et moraux qui découlaient de ce « changement d’époque ».
Un nouveau dossier, n° 32, est en cours de rédaction, intitulé « Face aux ruptures, être prêt ». Sans empiéter sur le rôle des organismes officiels et s’inspirant de la version 2025 de la revue nationale stratégique, il vise à dégager des principes généraux ou des orientations plus techniques qui pourraient soutenir les réflexions de tous ceux que le sujet de la défense nationale, dans le cadre européen, intéresse et, aujourd’hui, préoccupe. Ce dossier se refuse à un pessimisme qui encombre souvent les analyses de la situation actuelle et, en contrepoint de ce pessimisme du chemin à parcourir, entend mettre en avant un optimisme d’action et du but atteignable. Il entend cependant rester lucide et réaliste en s’appuyant sur l’expérience du passé, lointain comme plus récent…
Les allusions à « l’entre-deux guerres » étant nombreuses aujourd’hui, la première partie du dossier regroupera quelques éclairages sur les années 1935-1940. Il ne s’agit pas réécrire « L’étrange défaite » sans le talent de Marc Bloch, mais de choisir dans les prémices de la catastrophe de 1940 quelques instants où, avec le recul, il paraît incompréhensible qu’un voyant rouge ne se soit pas allumé sur le tableau de bord national, ou plutôt, s’étant allumé, pourquoi il fut si difficile de se préparer à l’épreuve qui s’annonçait.
Plus près de nous, la deuxième partie fait appel directement à nos rédacteurs, tous acteurs de la fin de guerre froide et de « la guerre mondiale de la France » pour reprendre le titre d’un livre récent de Michel Goya. À partir de la fin des années 1970, et surtout de 1990, les armées françaises (et l’on s’intéressera plus particulièrement à l’armée de Terre) ont été placées dans des situations opérationnelles imprévues, lointaines et exigeantes, dans un contexte de réduction de leurs moyens. De l’avis général, si les buts politiques furent loin d’être toujours atteints, les buts militaires le furent, avec plus ou moins de publicité, au prix d’efforts, y compris humains, souvent occultés. Cette partie récapitulera certains de ces efforts et permettra, nous l’espérons, de croire au « succès des armes de la France » pour les défis qui s’ouvrent désormais à nos armées.
La troisième partie se lancera dans l’exercice de la prévision dont on sait la difficulté, surtout, pour reprendre la boutade célèbre, lorsqu’elle traite de l’avenir. Il s’agira en fait d’un exercice de conviction de la part de rédacteurs qui, forts de leur expérience passée mais également de leur enracinement dans les réalités du moment, mettront sur la table « de la nourriture pour l’esprit », sans obligation de consommer !
Innovation majeure par rapport aux dossiers précédents, nous avons choisi de ne pas attendre d’avoir réuni l’ensemble des contributions de ce dossier n° 32 pour les mettre à la disposition de nos lecteurs. Elles seront publiées par THEATRUM BELLI au fur et à mesure de leur disponibilité, avant d’être réunies sous une forme complète. Vous trouverez donc ce rappel du but général et de l’articulation du dossier en tête de chaque publication, accompagné de l’indication de la partie à laquelle elle se rattache.
Engagés simultanément en 1978 au Liban, au Tchad et au Zaïre avec le même armement individuel que durant la guerre d’Algérie, les fantassins français trouvent face à eux des milices et armées équipées d’armes modernes, notamment les « fusils d’assaut », alors que le futur FAMAS reste toujours en attente de fabrication et n’entrera progressivement en service qu’au début des années 1980.
Cependant dès 1979, les unités déployées en opérations trouveront en « matériel de secteur » des « fusils d’assaut » achetés en urgence, mais en nombre limité, auprès d’un fournisseur suisse. Cet exemple anecdotique est cependant symbolique de la façon dont les armées ont su faire face dans les dernières décennies à des besoins d’équipement dictés par la nature imprévisible des opérations… Les lignes qui suivent se cantonneront à retracer l’expérience de l’armée de Terre, mais chaque armée, dans le cadre de ses opérations spécifiques, a connu la sienne.
En matière d’équipement, la période 1980-2015 peut être caractérisée en trois traits :
- la poursuite raisonnée et strictement organisée d’une programmation des grands matériels structurants des capacités exigées par le contrat opérationnel « standard » (si ce dernier a évolué en volume, il est resté assez constant en capacités dont certaines sont ainsi devenues au fil du temps « échantillionnaires »),
- l’adaptation réactive à l’imprévu, qu’il s’agisse de besoins techniques ou de la nature des adversaires et des opérations,
- la pression constante exercée par l’insuffisance des ressources financières et la rigidité des procédures administratives.
Dans le piège des « dividendes de la paix »
Si l’on considère la période allant du milieu des années 1970 à nos jours, il faut en premier lieu mettre en lumière le déroulement planifié et bien orchestré des programmes d’armement nationaux lancés dans la décennie 1960 et des plans d’équipement qui en découlaient : stimulée par le réel effort financier de la programmation « Giscard » (avec une progression du budget de la défense supérieure à celle du PIB), la période débute avec l’arrivée assez massive et rapide des blindés légers pour l’infanterie et l’arme blindée (VAB, AMX10P, AMX10RC) — tous amphibies —, du FAMAS et du Milan, des hélicoptères Gazelle et Puma, du poste radio 4G, etc… tous matériels que notre génération mettra en œuvre au fil d’opérations pour lesquelles ils n’avaient été conçus !
A partir de la chute du Mur de Berlin, l’élan et le rythme seront altérés par la recherche des « dividendes de la paix », une expression dont plus personne ne souhaite assumer la paternité ! Viendront ensuite à la fin des années 1990 le refroidissement « Juppé » et la revue des programmes « Jospin » qui en découla. Associés aux atermoiements de la coopération entre industriels européens, ils rendirent nettement plus laborieuse l’arrivée d’une nouvelle famille d’équipements (chars Leclerc, Tigre, NH90, successeurs des missiles Milan et Hot,…) et conduiront plus tard à la nécessité de lancer de coûteuses — à tous points de vue — opérations de rénovation des parcs en service, allant au-delà de leur seule mise à niveau de mi-vie.
Pour autant, l’armée de Terre, bien appuyée par la DGA, réussit au cours des années 2000 à surmonter les obstacles financiers et procéduraux pour poursuivre une préparation de l’avenir cohérente. Après qu’aient été sortis de l’ornière les programmes Leclerc, Tigre et surtout VBCI (dont le parc fut réalisé moins de dix ans après l’échec de la tentative de coopération franco-germano-britannique), le cap du futur fut pris résolument avec la démarche de « numérisation de l’espace de bataille », la NEB qui fit couler bien de salive à ses contempteurs, en parallèle de l’architecture « bulle opérationnelle aéroterrestre », la BOA dont naquit le « système de combat futur – SCF », rebaptisé Scorpion en 2007. La suite est plus vivace dans les mémoires… Toujours est-il que l’armée de Terre française des années 2020 est la seule en Europe avoir atteint ce niveau de cohérence de ses équipements autour du concept de combat (aéroterrestre) collaboratif, tout en assurant son interopérabilité technique avec l’OTAN.
Bien évidemment, il y eu des « trous dans la raquette », comme l’abandon de tout effort significatif pour la défense sol-air et le génie d’assaut (déminage, brêchage), ou des retards qui s’avèrent à déplorer aujourd’hui, principalement autour des drones. Mais c’est ici que doit être rappelée la capacité d’adaptation dont « l’armée de Terre des OPEX » sut faire preuve avec succès.
« Le job a été fait ! »
A partir des années 1980, l’armée de Terre, organisée et équipée pour jouer son rôle dans la bataille de Centre-Europe face au pacte de Varsovie, se trouva engagée, quasiment sans discontinuer, sur des terrains imprévus, dans des contextes géopolitiques et opérationnels aussi variés que parfois déconcertants, face à des adversaires et des menaces oubliés, si ce n’est inédits. Qu’elles aient trouvé leur origine dans la nature même des opérations ou dans les impératifs mis par les autorités politiques, les conditions d’emploi des « forces projetées » appelèrent systématiquement réactivité, créativité, flexibilité à la fois dans leurs équipements et dans le savoir-faire de leurs chefs et soldats pour les mettre en œuvre. En se souvenant que ces aventures débutèrent en 1978 par le parachutage en urgence au fin fond de l’Afrique d’un régiment dépourvu de cartes topographiques, et qui découvrit sur place avions et parachutes inconnus1…
Cependant, force est de constater que les matériels conçus pour la guerre froide ont globalement « fait le job » en OPEX, grâce, notamment pour la majorité des forces de contact, au choix heureux de la roue au détriment de la chenille qui aurait rendu leur emploi (et leur soutien) très difficile sur la plupart des théâtres d’opérations extérieures, en terrain ouvert comme dans les villes. Le durcissement des véhicules par des blindages additionnels a été relativement facile à réaliser, parfois directement sur place (comme en Afghanistan) et s’est seulement traduit par la perte de la capacité amphibie, qui répondait à la configuration hydrographique spécifique de la zone d’engagement prévue en Allemagne. Ces plates-formes blindées ont été ensuite améliorées, « au fil de l’eau », au fur et à mesure de l’apparition de nouvelles menaces : systèmes de brouillage des dispositifs électroniques de déclenchement des « engins explosifs improvisés » (brouilleurs anti-EEI2), détecteurs de départ de coups adverses, mise à l’abri des servants d’armes de bord par l’intégration de tourelleaux téléopérés, devenus la norme y compris pour les véhicules logistiques, lance-grenades automatiques, et bien d’autres dispositifs et boîtiers en tout genre… La guerre du Golfe (1990-91), en dépit de sa brièveté, avait déjà été marquée par cette démarche d’adaptation « en marchant »3, notamment pour la vision nocturne des équipages d’hélicoptères, les communications, la défense contre les armes chimiques (ce qui permet de souligner que tout au long des OPEX, en parallèle de la mise en place d’équipement individuels et collectifs de « protection de la force », le Service de santé des Armées accompagna également son engagement par une modernisation et une innovation permanentes dans la médecine de l’avant et le traitement des blessés graves, que la faiblesse relative du nombre des pertes en tués vient attester).
Le long engagement dans les Balkans, notamment le siège de Sarajevo, a vu naître des menaces nouvelles qu’il fallut contrer rapidement. Ce fut par exemple la lutte contre les snipers, qui donna lieu à la mise en place à la fois d’une doctrine et d’équipements nouveaux, qui en font désormais une spécialité d’excellence. Moins spectaculaire, la durée des rotations des unités, la précarité et la dispersion des cantonnements, associées à la rigueur du climat, firent de ce théâtre le banc d’essai et de renouvellement de tout l’équipement individuel et collectif de « vie en campagne » et d’habillement, assurant à la troupe de vivre et opérer dans des conditions rustiques sans perte progressive de capacité. C’est le même type d’effort qui fut fait, dans d’autres conditions climatiques, en Afghanistan et au Sahel, pour des effectifs et des conditions d’emploi qui n’avaient plus rien à voir avec les engagements africains des années 1980-90. Ainsi, l’équipement du soldat devint progressivement un véritable système d’armes, pour sa protection et son efficacité au combat. Une évolution qui associa très intimement l’armée de Terre au Service du Commissariat des Armées, créé dans les années 2000.
Ces deux théâtres, Afghanistan et Sahel, virent également la résurgence de la « guerre des grottes et des tunnels », oubliée depuis longtemps. Tout un attirail, en partie tiré du catalogue du « Vieux Campeur » mais également mobilisant les premiers robots terrestres, permit de mettre sur pied les équipes de fouille opérationnelle devenues, comme le déminage, la pointe de diamant des régiments du génie, au même titre que les multiples équipements « spéciaux » des forces du même nom… En Côte d’Ivoire et au Kosovo, c’est le contact physique avec des populations civiles hostiles qui commanda la mise sur pied en urgence d’une capacité de « contrôle de foule », sur la base de l’équipement et de l’entraînement de la Gendarmerie mobile, avec en sus quelques armes et munitions « à létalité réduite » qui n’étaient pas dans l’inventaire normal de l’armée de Terre.
Cette liste à la Prévert n’est pas limitative. On pourrait y ajouter de multiples autres équipements mis en service en urgence, mais avec succès et en toute sécurité chaque fois que nécessaire : les moyens de production géographique projetables, les systèmes de parachutage « grande hauteur, grande précision », sans omettre une multitudes de systèmes d’information et de communication spécifiques reliés H24 au territoire métropolitain.
Qui a gagné ?
Trois facteurs de réussite peuvent être mis en avant.
Tout d’abord, comme mentionné plus haut, le cœur des capacités en projection a été fourni par les matériels en service initialement conçus pour la guerre froide ; contrairement à d’autres armées occidentales, l’armée de Terre française n’a pas été contrainte d’acquérir des flottes volumineuses de véhicules et d’artillerie nouvelles pour faire face aux OPEX. Seules la lutte contre les engins explosifs et les opérations spéciales ont nécessité des « rééquipements » significatifs. De ce fait, l’adaptation des équipements aux OPEX n’a pas représenté une charge financière d’investissement susceptible de perturber gravement et durablement la préparation de l’avenir et les programmes futurs en cours de développement4. Le programme Scorpion ouvre les mêmes perspectives de flexibilité opérationnelle.
Ensuite, la plupart des « adaptations » n’ont pas été des « inventions » ou des découvertes. Bien des équipements ou systèmes mis en service en urgence lors des OPEX avaient été identifiés comme besoins potentiels ou observés lors des conflits de par le monde (notamment au Proche-Orient). Certains faisaient même l’objet de programmes en cours, mais non prioritaires, ou de propositions spontanées de l’industrie. Dès lors, une fois le besoin exprimé par les opérationnels, les services techniques de la DGA et des services de soutien, systématiquement associés à la Section technique de l’armée de Terre, ont pu assez rapidement faire leur travail d’acquisition et de qualification, d’autant que si les systèmes à acquérir furent très diversifiés, les quantités restèrent relativement limitées (sauf ce qui concerne l’équipement individuel et la protection des véhicules).
Le troisième facteur de réussite fut plus compliqué à concrétiser car il s’agissait de bousculer des habitudes bien installées.
Au niveau des équipements en service, si les matériels majeurs se révélèrent bien adaptés au prix des améliorations mentionnées plus haut, leur répartition au sein de l’armée de Terre ne put pas être maintenue en l’état, notamment à la jointure des décennies 2000-2010 marquée par les besoins du théâtre afghan, qu’il s’agisse des opérations ou de l’entraînement préalable (cette situation s’était déjà produite lors de la guerre du Golfe). Une nouvelle politique d’emploi et de gestion des parcs a été mise en place à partir de 2008, pour répondre à la fois à la contrainte budgétaire sur le soutien et à l’organisation des grandes opérations industrielles de rénovation à mi-vie. En centralisant de façon assez brutale la gestion des parcs les plus sensibles, elle devint rapidement un outil efficace pour affecter aux forces en opérations les volumes de matériels adaptés aux missions (notamment les véhicules blindés et certains armements). Cela se fit au détriment de la vie et de l’entraînement courants sur le territoire national. Ce fut un moment difficile pour la plupart des régiments, auquel mirent fin l’embellie budgétaire des années 2015 et suivantes, et surtout la mise en service progressive du programme Scorpion et de son environnement.
Les procédures d’acquisition furent un autre point bloquant à surmonter, bien que le phénomène soit connu depuis la guerre du Golfe qui avait nécessité quelques acquisitions en urgence, connues sous le terme de « crash programmes », appellation qui perdura qu’au début des années 2000. En 2004, une procédure dite « achat en urgence opérationnelle, AUO » fut mise en place, concomitamment à la nouvelle répartition des responsabilités en matière d’équipement qui donnait un rôle prééminent à l’état-major des armées, par rapport aux trois armées. A l’issue de discussions souvent serrées sur la nature et l’urgence des besoins, les armées purent faire valoir leurs besoins AUO au terme d’un processus interne itératif, qui pour l’armée de Terre s’intitula « adaptation réactive ». Au terme de ces discussions, les AUO pouvaient trouver un espace financier dans la programmation pluriannuelle, charge ensuite à la DGA de lancer des procédures rapides de contractualisation, conformes au code des marchés publics, lequel fut complété d’une troisième partie « relative aux marchés de défense et sécurité »5 (les services de soutien agissant de même pour les équipements ne nécessitant pas de qualification technique spécifique).
En parallèle, le recours à l’agence d’acquisition de l’OTAN (NAMSA, devenue depuis NSPA6) permit d’effectuer certaines acquisitions rapides « sur étagère », tandis qu’au prix de procédures plus longues et de contraintes d’emploi, la DGA eut également recours au marché américain selon la procédure des FMS7, comme ce fut le cas pour l’achat d’un lot de missiles antichar Javelin destinés au théâtre afghan.
Pour autant, tout n’alla pas sans difficultés dès lors que les technologies étaient sensibles et les montants financiers importants. Le marché des brouilleurs anti-IED lancé par la DGA en 2008 fit ainsi l’objet de recours industriels qui retardèrent leur fourniture aux forces engagées en Afghanistan.
Au bilan, on ne peut que constater qu’en dépit des difficultés techniques et administratives, le succès de l’adaptation réactive aura été au rendez-vous, dans un contexte opérationnel exigeant et une tendance budgétaire peu favorable. Aujourd’hui, les enseignements de la période sont institutionnalisés et « industrialisés » afin de donner aux armées la capacité d’anticipation et de réactivité que réclament les nouvelles incertitudes des engagements futurs. En créant un Commandement du combat futur doté d’outils puissants de prospective, innovation et expérimentation, l’armée de Terre a réuni, dans son champ de compétence, à son plus haut niveau décisionnel tous les éléments lui permettant d’éviter la surprise ou d’y réagir efficacement. De même, la DGA s’est placée dans une démarche similaire, avec de nouveaux instruments de prospective et d’innovation (notamment l’Agence d’innovation de défense), la mise sur pied d’une « Force d’acquisition rapide » et la volonté d’anticiper les blocages contractuels avec l’industrie (le « pacte drones » devrait permettre d’éviter le « drame des brouilleurs »). Autant d’éléments qui structurent peu à peu la « révolution dans les affaires capacitaires » mentionnée dans la version 2025 de la Revue nationale stratégique.
Attention au cocorico…
Pour autant ce regard positif sur le passé peut se heurter à des objections.
Une première tient au fait que les volumes de forces en OPEX auraient été trop limités pour servir d’étalon au futur possible en Europe. C’est oublier que dans les années 1980-90 pour la seule armée de Terre, les Balkans, le Cambodge, le Liban, la Somalie et le reste de l’Afrique ont mobilisé jusqu’à une quinzaine de bataillons relevés tous les quatre ou six mois pendant plusieurs années, une situation qui s’est renouvelée dans les années 2000 avec le Liban toujours, la Côte d’Ivoire, l’Afghanistan, puis le Moyen-Orient, le Sahel et leurs abords. Les opérations y ont été souvent, pour ceux qui les vivaient, « de haute intensité ».
L’effort serait-t-il hors de portée dans une confrontation avec la Russie et les risques d’escalade qu’elle comporte ? Ce n’est pas évident. Désormais en cours de total et rapide rééquipement, sur la base du programme Scorpion, l’armée de Terre est dès à présent en mesure de prendre son « créneau » dans le vaste dispositif de l’OTAN auquel elle est intimement intégrée. A très court terme, elle sera parfaitement capable de répondre à l’hypothèse d’engagement de « haute intensité » face à la Russie que « les experts » jugent la plus probable : faire face à un test contre l’OTAN qui serait sans doute violent mais de courte durée, sauf à entrer dans une phase où les forces conventionnelles retrouveraient alors le rôle de « fil déclencheur » de l’escalade nucléaire qui était le leur pendant la guerre froide. Si des besoins en capacités militaires existeront également dans la profondeur stratégique de l’OTAN, dont le territoire national, ils ne seront pas de même nature.
Dans ce cadre, toute comparaison avec les pertes et les consommations de la guerre d’attrition qui se déroule en Ukraine depuis 2022 ne paraît pas pertinente, même s’il ne faut pas laisser de côté la question de la constitution des stocks de munitions et de pièces de rechange suffisants pour faire face à un engagement violent, serait-il de courte durée.
Une seconde objection est précisément liée à la capacité de s’opposer violemment à un « test » aux frontières de l’OTAN et tient aux déficits capacitaires d’un affrontement conventionnel de haute intensité, déficits désormais bien mesurés, principalement les feux dans la profondeur et la défense sol-air (DSA). Les moyens correspondants, en Europe pour la DSA, à l’étranger pour les feux dans la profondeur, même si une solution « souveraine » progresse en France.
Les drones / robots (aériens, navals et terrestres) de toutes sortes sont également un sujet majeur, ainsi que la guerre électronique qui va avec. Ils sont pour une bonne part à l’origine du « blocage tactique » en Ukraine. Toutefois, bien qu’elles soient très évolutives, les technologies qui s’y attachent restent atteignables, sont largement déployées pour de multiples emplois civils et ne nécessitent ni une puissance industrielle démesurée, ni des budgets extraordinaires.
Dans tous ces domaines, les besoins sont identifiées, les tactiques d’emploi en cours d’expérimentation voire d’intégration, et la plupart des technologies disponibles. La levée de l’objection relève donc de l’effort budgétaire et de l’organisation industrielle. La balle est dans le camp des politiques et de la BITD !
Général de corps d’armée (2S) Jean-Tristan VERNA
- Opération Bonite. Prise de Kolwezi par le 2e REP le 19 mai 1978.
- Improvised Explosive Device, engins explosifs improvisés.
- La Section technique de l’armée de Terre (STAT) développa en urgence un char AMX30 télécommandé de déminage, en utilisant des rouleaux de déminage récupérés sur les anciens parcs du Pacte de Varsovie…. Une démarche qui devait se renouveler en Afghanistan avec le programme LEMIR de leurrage électronique des IED, mais avec un produit français.
- Seule idée de « grand programme » motivée par les OPEX, le besoin d’hélicoptères de transport lourd donna lieu à un débat intense, mêlant enjeux industriels, coût financier, cohérence interarmées, et coopération franco-allemande. En eurent raison l’étroitesse du marché européen, l’existence de solutions étrangères sur étagère et l’impossibilité d’aboutir, avec les Allemands, sur des profils de mission partagés.
- Cette évolution trouvait sa source initiale dans la transposition d’une directive européenne.
- Nato Support and Procurement Agency (qui succéda en 2015 à la Nato Maintenance and Support Agency)






