24 août 410 : sac de Rome.
Les tribus barbares deviennent plus fortes et unies face à la puissance romaine. À la fin du IVe siècle cependant, les Huns envahissent les territoires barbares, forçant les Wisigoths menés par Fritigern à chercher exil dans l’Empire romain en 376. Les taxes, la corruption et les vexations du pouvoir romain finissent par les retourner contre Rome, et les Wisigoths commencent à piller les Balkans. À la bataille d’Andrinople en 378, Fritigern bat l’empereur Valens qui est tué. Son successeur, l’empereur Théodose, change alors de stratégie. Il signe avec les Wisigoths un traité de paix en 382. Contre la fourniture d’un contingent de soldats à l’armée impériale, les Wisigoths deviennent des sujets autonomes de l’empire. Ils obtiennent le nord des diocèses de Dacie et de Thrace.
 Le successeur de Fritigern, Alaric, participe à l’invasion de l’ouest par les armées d’Orient de l’empereur Théodose. À la bataille de Frigidus, près de la moitié des Wisigoths meurent face à l’armée d’Eugène et son général Arbogast. Théodose est vainqueur, mais Alaric est convaincu que le Romain l’a mis en première ligne pour l’affaiblir.
Le successeur de Fritigern, Alaric, participe à l’invasion de l’ouest par les armées d’Orient de l’empereur Théodose. À la bataille de Frigidus, près de la moitié des Wisigoths meurent face à l’armée d’Eugène et son général Arbogast. Théodose est vainqueur, mais Alaric est convaincu que le Romain l’a mis en première ligne pour l’affaiblir.
Après la mort de Théodose, Alaric reprend les hostilités contre l’empire d’Orient mais Stilicon, le général de l’armée d’Occident, le repousse vers l’Italie. En 402, devant la menace wisigothe, la capitale de l’empire d’Occident est transférée de Mediolanum à Ravenne, plus facile à défendre. Alaric tente alors à plusieurs reprises d’envahir l’Italie mais est arrêté par Stilicon et défait lors des batailles de Pollentia et de Vérone. Alaric accepte alors d’aider Stilicon à reprendre la préfecture d’Illyricum pour l’empire d’Occident. Cependant, l’invasion des Suèves et des Vandales met fin au projet. Alaric ayant engagé les dépenses pour la campagne envisagée, Stilicon tente d’en obtenir le remboursement auprès du sénat, en vain, ce qui alimente le ressentiment des Wisigoths contre les Romains.
En 408, Arcadius meurt et Honorius veut partir pour l’Orient afin de réclamer le trône. Stilicon l’en dissuade, lui proposant d’y aller à sa place. Des rumeurs prétendent que Stilicon veut placer son fils à la tête de l’empire d’Orient. Une mutinerie éclate alors, menée par Olympius, où une grande partie des alliés de Stilicon meurent. Olympius persuade Honorius de déclarer Stilicon ennemi du peuple et est nommé magister officium. Stilicon qui a trouvé refuge dans une église est arrêté et tué. Ces événements sont suivis d’une vague de violence au cours de laquelle un grand nombre d’esclaves et de guerriers barbares, capturés par Stilicon, s’échappent et viennent trouver refuge chez Alaric. Celui-ci se retrouve alors avec une forte armée pour négocier avec les Romains.
Face à l’intransigeance de l’empereur Honorius qui refuse de lui accorder des terres, Alaric menace de prendre Rome en 408 puis une deuxième fois en 410. Afin d’obtenir gain de cause, il décide alors de mettre ses menaces à exécution par une démonstration de force en prenant la ville.
Malgré la puissante muraille construite par l’empereur Aurélien, la ville de Rome est alors vulnérable. Les troupes romaines chargées de protéger l’Italie ont été dispersées dans d’autres villes, si bien qu’il n’y a aucune garnison permanente pour la défendre. Quant à la garde prétorienne, elle n’existe plus depuis sa dissolution par Constantin en 312. De Ravenne, Honorius ne tente rien pour la secourir.
C’est donc une ville laissée à l’abandon que les Wisigoths d’Alaric Ier, maîtres de la côte, réduisent à la famine à l’été 410. Le 24 août, peut-être grâce à une trahison, ils entrent dans la ville par la porte Salaria6. Rome est pillée pendant trois jours, à commencer par les demeures sénatoriales de l’Aventin et du Caelius et les édifices publics des forums. Alaric ordonne néanmoins d’épargner la vie des hommes et l’honneur des femmes. Défense est faite de brûler les édifices religieux, les basiliques de Saint-Paul et de Saint-Pierre étant érigées en asile inviolable. Les guerriers épargnent tous ceux qui trouvent refuge dans les églises et rendent ensuite aux basiliques tout ce qui leur a été pris.
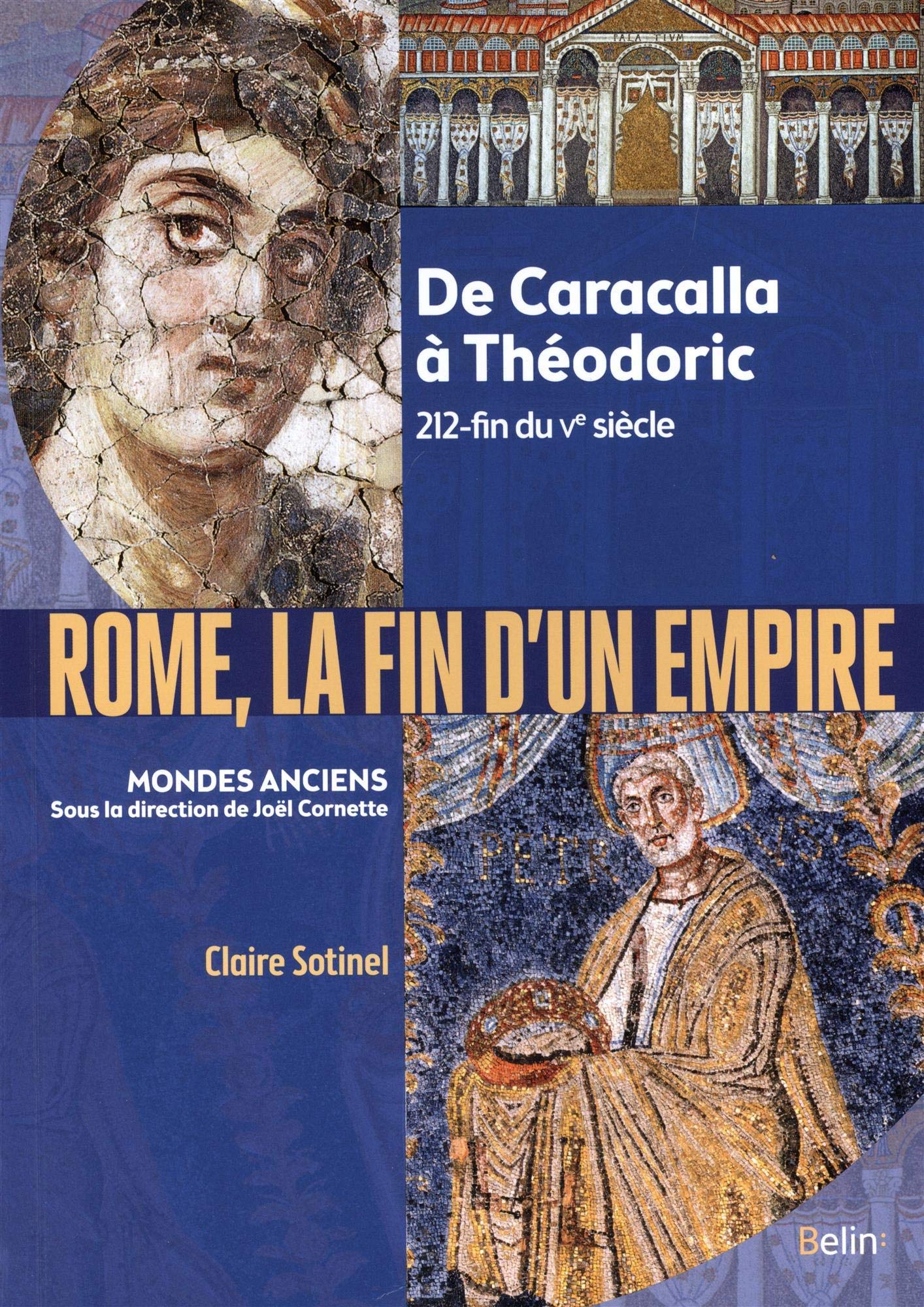 Cependant, une partie de la ville est brûlée. Les archives impériales, qui couvraient quatre siècles, d’Auguste jusqu’à Théodose Ier, sont détruites en plusieurs lieux de la ville. Ce sera une perte inestimable pour l’histoire, surtout en ce qui concerne les documents qui traitaient de la vie sociale et de la vie de tous les jours sous l’Empire romain. Les rares documents sauvés, parchemins ou papyrus, rejoindront les archives vaticanes ou celles de l’Empire byzantin à Constantinople. De nombreuses œuvres d’art (des statues, par exemple) sont détruites, car considérés de peu d’importance ou sans valeur. Ce qui restait de la vie universitaire est détruit, des bibliothèques sont incendiées et des enseignants sont assassinés. Malgré les demandes et promesses d’Alaric, de nombreux meurtres sont commis8. Beaucoup de Romains s’enfuient en Afrique romaine, en Égypte et jusqu’en Palestine.
Cependant, une partie de la ville est brûlée. Les archives impériales, qui couvraient quatre siècles, d’Auguste jusqu’à Théodose Ier, sont détruites en plusieurs lieux de la ville. Ce sera une perte inestimable pour l’histoire, surtout en ce qui concerne les documents qui traitaient de la vie sociale et de la vie de tous les jours sous l’Empire romain. Les rares documents sauvés, parchemins ou papyrus, rejoindront les archives vaticanes ou celles de l’Empire byzantin à Constantinople. De nombreuses œuvres d’art (des statues, par exemple) sont détruites, car considérés de peu d’importance ou sans valeur. Ce qui restait de la vie universitaire est détruit, des bibliothèques sont incendiées et des enseignants sont assassinés. Malgré les demandes et promesses d’Alaric, de nombreux meurtres sont commis8. Beaucoup de Romains s’enfuient en Afrique romaine, en Égypte et jusqu’en Palestine.
Alaric quitte la ville en emmenant avec lui Galla Placidia, sœur de l’empereur. Il avance vers le sud de l’Italie, qui reste à piller, comptant passer dans la province d’Afrique. Il prend Naples, mais meurt à la fin de l’année, en tentant de passer en Sicile. Son beau-frère Athaulf lui succède et repart vers le nord.
La nouvelle de la prise et du sac de Rome a un énorme retentissement dans l’Empire romain et provoque un traumatisme dans la population. L’arrivée de réfugiés nobles et les récits qu’ils propagent sur leurs malheurs et l’exode qui les frappe causent une émotion considérable9. Saint Jérôme parle de Rome comme du « tombeau du peuple romain ». Les païens considèrent alors que l’avènement du christianisme est à l’origine de sa chute, et c’est pour combattre cette idée que saint Augustin entreprend l’écriture de la La Cité de Dieu et que Paul Orose compose son Histoire contre les païens.
Certains historiens désignent cette date plutôt que 476 comme étant celle de la fin de l’Empire romain d’Occident : après 410 les « empereurs » ne sont plus en effet que des marionnettes, des êtres faibles, sans relief, souvent des enfants, encadrés par un clan ou un groupe d’intérêts.
Cependant, les historiens de l’Antiquité tardive contestent l’idée d’une chute brutale de l’Empire romain. Ils y voient une « transformation » progressive, constatant une continuité entre le monde classique et le monde médiéval, notamment sur le plan de la culture. Ainsi, il y aurait eu une modification graduelle sans rupture claire en dépit de l’épisode du sac de 410 ou plus tard de la fin de Romulus Augustule.
24 août 1572 : début du massacre de la Saint-Barthélémy.
Le massacre de la Saint-Barthélemy est le massacre de milliers de protestants par des catholiques déclenché à Paris, le , jour de la Saint-Barthélemy, prolongé pendant plusieurs jours dans la capitale, puis étendu à plus d’une vingtaine de villes de province durant les semaines suivantes et même les mois suivants.
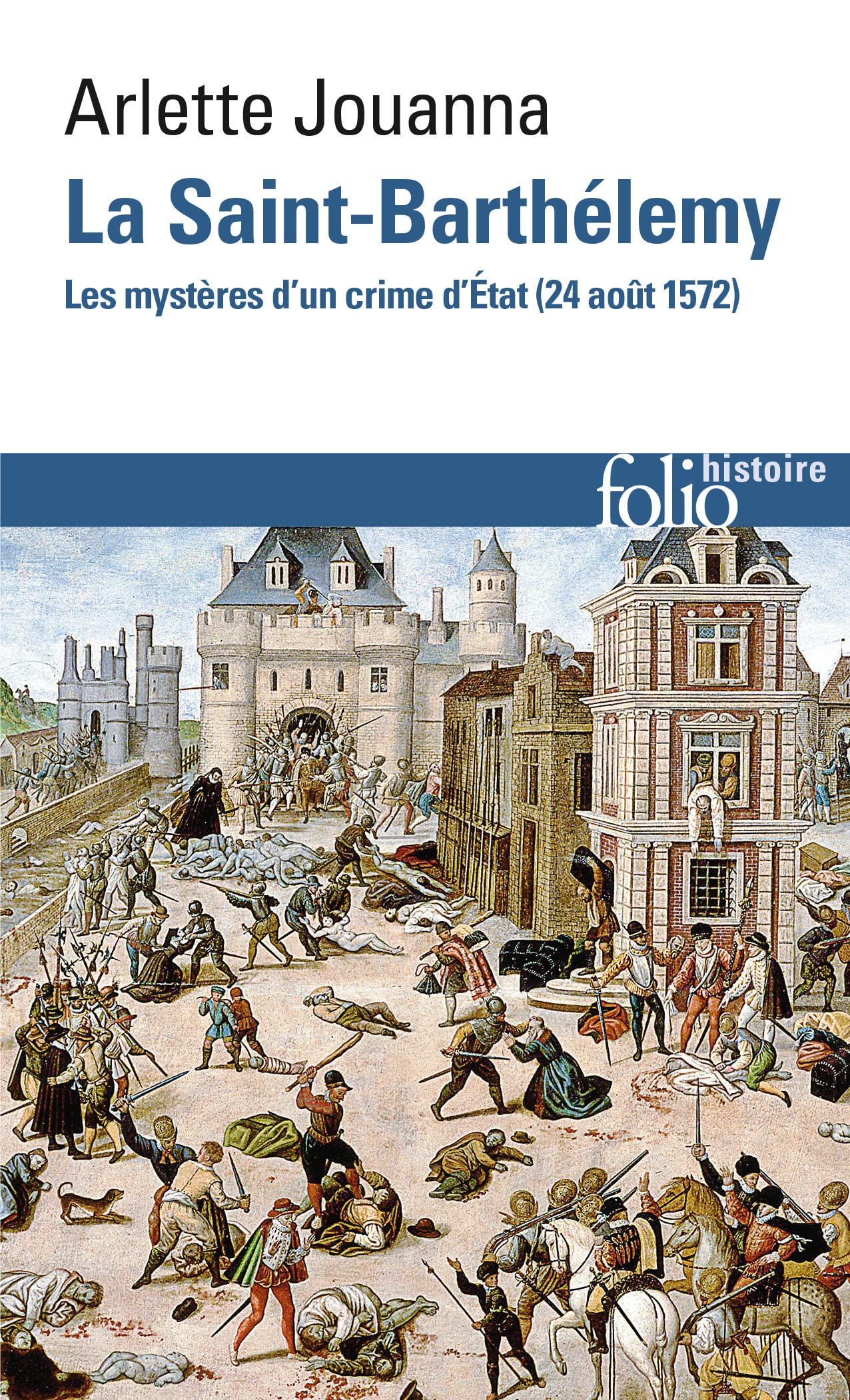 Cet événement des guerres de Religion résulte d’un enchevêtrement complexe de facteurs, aussi bien religieux et politiques que sociaux. Il est la conséquence des déchirements de la noblesse française entre catholiques et protestants, notamment de la vendetta entre la maison de Guise, catholique, et le clan des Châtillon-Montmorency, catholiques modérés et protestants. Il intervient deux ans après la paix de Saint-Germain, alors que l’amiral de Coligny, chef du parti protestant, vient de réintégrer le conseil royal. Aggravé par la réaction catholique parisienne hostile à la politique royale d’apaisement, il reflète également les tensions internationales entre les royaumes de France et d’Espagne, avivées par l’insurrection anti-espagnole aux Pays-Bas.
Cet événement des guerres de Religion résulte d’un enchevêtrement complexe de facteurs, aussi bien religieux et politiques que sociaux. Il est la conséquence des déchirements de la noblesse française entre catholiques et protestants, notamment de la vendetta entre la maison de Guise, catholique, et le clan des Châtillon-Montmorency, catholiques modérés et protestants. Il intervient deux ans après la paix de Saint-Germain, alors que l’amiral de Coligny, chef du parti protestant, vient de réintégrer le conseil royal. Aggravé par la réaction catholique parisienne hostile à la politique royale d’apaisement, il reflète également les tensions internationales entre les royaumes de France et d’Espagne, avivées par l’insurrection anti-espagnole aux Pays-Bas.
Faute de sources, les historiens sont longtemps restés partagés sur le rôle exact de la couronne de France, et la tradition historiographique a fait du roi Charles IX et de sa mère, Catherine de Médicis, les principaux responsables du massacre. Ils retiennent aujourd’hui que seuls les chefs militaires du parti protestant étaient visés par le gouvernement. Dès le matin du , Charles IX ordonne l’arrêt immédiat des tueries mais, dépassé par l’acharnement des massacreurs, il ne peut les empêcher.
24 août 1704 : bataille navale de Vélez-Málaga (guerre de Succession d’Espagne).
La bataille navale de Vélez-Malaga intervient pendant la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714). Dans ce conflit, la France soutient le roi d’Espagne Philippe V, petit-fils du roi de France Louis XIV, contre les autres puissances européennes (archiduché d’Autriche, royaume d’Angleterre, Provinces-Unies).
La prise de Gibraltar par l’amiral anglais Rooke le pose un grave problème au roi de France. Désormais, les escadres de Toulon sont coupées de l’Atlantique. Aussi, Louis XIV décide-t-il de reprendre Gibraltar aux Anglais.
Pour ce faire, il confie le commandement de la flotte à Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse et amiral de France, ce qui, au demeurant, constitue un acte unique dans l’histoire de la marine de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. L’entreprise française n’aboutit pas au résultat escompté (Gibraltar reste aux Anglais) mais la flotte britannique subit de lourdes pertes en hommes, ce qui entraîne la démission de l’amiral Rooke. Les vaisseaux de l’amiral Byng, le « héros de Gibraltar », n’ont pas participé à l’affrontement faute de munitions. Prudemment, la flotte française se replie sur Toulon sans avoir perdu un seul bâtiment.
Gibraltar appartient encore aujourd’hui aux Britanniques ce qui occasionne de temps à autre des tensions diplomatiques entre l’Espagne et le Royaume-Uni.
On trouve, d’un côté, une flotte franco-espagnole (mais la participation espagnole se limite à la présence de galères qui ne prendront pas part au combat), et, de l’autre, une flotte anglo-hollandaise.
| Coté français | Coté anglo-batave |
| La mobilisation de l’escadre du Ponant, basée à Brest dans l’océan Atlantique et de l’escadre du Levant, basée à Toulon en Méditerranée, permettent à la France de réunir un total de 93 navires. L’armée navale dispose de 3 522 canons et de 24 275 hommes. | Rooke possède 65 navires dont 53 vaisseaux et 12 autres bâtiments dont quelques galiotes à bombes, sans compter les navires hollandais. La flotte anglaise dispose de 3 614 canons et de 22 453 hommes. Mais au total, « les flottes, pour le nombre des vaisseaux, étaient à peu près égales ». |
Le combat s’engage le 24 août 1704 à 8 heures du matin. Les Anglais, placés au vent des Français, se laissent porter vers eux pour engager le combat.
L’avant-garde française de Villette-Mursay essaie de doubler l’avant-garde britannique de Schovell, pour la prendre entre deux feux. Celle-ci augmente sa vitesse pour contrer la manœuvre. Ce faisant, se creuse un espace entre le corps de bataille et l’avant-garde britannique.
Le comte de Toulouse tente de profiter du passage pour rompre la ligne anglaise mais la manœuvre échoue. La plupart des historiens oublient de mentionner cette volonté de vouloir rompre la ligne et les théories du Père Hoste La canonnade devient générale tout au long de la ligne de bataille. Le vaisseau amiral français, Le Foudroyant, parvient à démâter le navire amiral anglais, Royal Catherine. Le Sérieux, de Champmeslin, tente par 3 fois de prendre à l’abordage le Kent, sans succès. Le hollandais Albermarle, deux-ponts de 64 canons, ne craint pas de se mesurer au Soleil Royal, trois-ponts de 102 canons.
« On n’avait pas vu de longtemps à la mer de combat plus furieux ni plus opiniâtre ». Rooke écrit : « C’est une des plus dures batailles que j’ai jamais vues. »
Vers 16 heures, le combat s’éteint à l’avant-garde. Le Fier, de Villette-Mursay, a reçu une bombe qui a détruit une partie de son arrière et de sa dunette. Le vaisseau sort de la ligne. Mais son escadre interprète mal son mouvement, croyant devoir suivre un ordre de dégagement. L’avant-garde britannique en profite pour venir au secours de l’escadre rouge.
Cependant les Britanniques ne poussent pas leur avantage et le combat au centre décroit et s’éteint vers 18-19 heures. À l’arrière-garde, le feu continue jusque vers 20 heures. Les deux flottes s’éloignent pour la nuit.
Le 25, le vent est passé à l’ouest. Les deux flottes restent en vue l’une de l’autre et réparent leurs dommages. Les Britanniques ont été particulièrement malmenés car les Français ont surtout tiré « à démâter ».
Le 26, le vent est repassé à l’est. Les deux flottes reviennent en vue l’une de l’autre, mais évitent de reprendre le combat. Chez les Britanniques, il ne peut en être question : ils sont quasiment à court de munitions. Chez les Français, on discute, puis on décide que l’on a gagné puisque l’adversaire ne veut pas reprendre le combat. La flotte repart vers Toulon.
Le 27, au soulagement des Britanniques, la flotte française n’est plus en vue. Gibraltar ne sera pas inquiété. Mais Rooke sera critiqué et n’obtiendra plus de commandements.
La bataille de Vélez-Málaga est l’une des plus rudes des guerres maritimes de Louis XIV. Les Français ont tiré 102 886 coups de canons.
Aucun navire n’a été capturé ni détruit au cours de la bataille, mais les pertes n’en sont pas moins élevées. La France déplore 1 585 tués (34,4 %) contre 2 325 pour les Anglais (50,4 %) et 700 pour les Hollandais (15,2 %), soit un total de 4 610 morts en 12 heures. En moyenne cela représente un mort toutes les dix secondes.
Cette bataille, livrée selon les règles théorisées, entre autres, par le Père Hoste, va devenir emblématique. D’abord parce qu’elle sera le dernier engagement majeur livré pendant près de quarante ans et qu’elle restera comme référence pour les nouvelles générations de marins. Les Britanniques y trouveront les raisons de chercher l’avantage du vent pour combattre, les Français leurs raisons de choisir le combat sous le vent. Pour les deux camps, elle provoque la sacralisation de la ligne de bataille, comme seule formation capable d’assurer la victoire ou, à tout le moins, d’éviter la défaite. En ce sens, Vélez-Málaga annonce, et explique la bataille de Toulon (1744).

24 août 1814 : les Britanniques incendient la Maison Blanche.
À la suite de la première abdication de Napoléon 1er, les Britanniques envoient des troupes en Amérique du Nord pour renforcer leurs garnisons du Canada, mener des raids contre les villes américaines et laver l’affront de l’incendie de York, un an auparavant. Le général Ross attaque la ville avec 4000 hommes qui incendient le Capitole et la Maison Blanche. Des pierres noircies ont été conservées à l’intérieur de l’édifice pour rappeler l’évènement.
***
C’est la seule fois depuis la guerre d’indépendance américaine qu’une puissance étrangère a capturé et occupé la capitale des États-Unis.
Après la défaite des forces américaines à la bataille de Bladensburg le 24 août 1814, une force britannique dirigée par le major-général Robert Ross marcha sur Washington. La discipline stricte des troupes et les ordres du commandement britannique de ne brûler que les bâtiments publics firent que la plupart des résidences privées furent préservées, mais tous les édifices du gouvernement américain furent en grande partie détruits y compris la Maison-Blanche, le Capitole des États-Unis et d’autres installations gouvernementales.
L’incendie fut en quelque sorte la réponse à celui de York (aujourd’hui Toronto), Haut-Canada lors de la bataille de York ().
Moins de quatre jours après le début de l’attaque, un violent orage – peut-être un ouragan – et une tornade ont éteint les incendies et causé d’autres destructions. L’occupation de Washington a duré environ 26 heures.
Le président James Madison, les responsables militaires et son gouvernement évacuèrent et purent trouver refuge pour la nuit à Brookeville, une petite ville du comté de Montgomery, dans le Maryland. Le président Madison a passé la nuit dans la maison de Caleb Bentley, un quaker qui vivait et travaillait à Brookeville. La maison de Bentley, connue aujourd’hui sous le nom de Madison House, existe toujours.

24 août 1821 : traité de Córdoba (fin de la guerre d’indépendance du Mexique).
Par ce traité, l’Espagne reconnaît l’indépendance du Mexique. Mais en réalité, cet accord signé par le nouveau vice-roi Juan O’Donojú, et Agustín de Iturbide pour le Mexique, ne sera pas reconnu par l’Espagne.
Des troupes concentrées dans la forteresse de San Juan de Ulúa contrôleront le port de Veracruz jusqu’en 1825. Et même après leur départ, l’Espagne cherchera longtemps à reprendre le Mexique, notamment par la tentative de reconquête en 1829. L’Espagne ne reconnaitra officiellement l’indépendance du Mexique qu’en 1836.
La première constitution de la république fédérale mexicaine — Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos — est promulguée le .
24 août 1929 : naissance de Yasser Arafat.
Yasser Arafat, né le au Caire en Égypte et mort le à Clamart (Hauts-de-Seine, France), de son vrai nom Mohamed Abdel Raouf Arafat al-Qoudwa al-Husseini et connu aussi sous son surnom (kounya) d’Abou Ammar, est un activiste et homme d’État palestinien.
 Dirigeant du Fatah puis également de l’Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat est resté pendant plusieurs décennies une figure controversée de l’expression des aspirations nationales des Palestiniens avant d’apparaître pour Israël comme un partenaire de discussions dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien dans les années 1990.
Dirigeant du Fatah puis également de l’Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat est resté pendant plusieurs décennies une figure controversée de l’expression des aspirations nationales des Palestiniens avant d’apparaître pour Israël comme un partenaire de discussions dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien dans les années 1990.
Yasser Arafat représente alors les Palestiniens dans les différentes négociations de paix et signe les accords d’Oslo en 1993. Il devient le premier président de la nouvelle Autorité palestinienne et reçoit le prix Nobel de la paix 1994 en compagnie de Shimon Peres et Yitzhak Rabin.
À partir de 2001, après l’échec du sommet de Taba et le déclenchement de la Seconde intifada, il perd progressivement de son crédit auprès d’une partie de son peuple qui lui reproche la corruption de son autorité. Il se retrouve isolé sur la scène internationale tandis que les Israéliens élisent Ariel Sharon au poste de Premier ministre d’Israël, amenant un durcissement de la position israélienne vis-à-vis du dirigeant palestinien, contraint à ne plus quitter Ramallah (Cisjordanie). Cet isolement n’est rompu qu’à la veille de sa mort, quand il est emmené d’urgence à Clamart, où il meurt à 75 ans.
En 2012, la dépouille de Yasser Arafat est exhumée pour étudier l’hypothèse d’une mort par empoisonnement au polonium 210. L’équipe d’experts suisses conclut à l’empoisonnement mais les équipes russes et françaises à une mort de vieillesse à la suite d’une gastro-entérite. En 2015, le parquet de Nanterre prononce un non-lieu dans l’enquête sur sa mort.

24 août 1929 : massacre d’Hébron.
Des Arabes y tuent environ 70 Juifs, en blessent une cinquantaine et pillent des maisons et des synagogues. Les Juifs survivants sont au nombre de 435, dont certains grâce à l’intervention de voisins arabes. Ils sont évacués par les autorités britanniques les jours qui suivent.
Ces attaques, qui font suite à des rumeurs selon lesquelles les Juifs essayeraient de conquérir les lieux saints de Jérusalem, sont les plus importantes de celles liées aux émeutes de Palestine en 1929 qui font un total de 133 Juifs et 116 Arabes tués.
Les attaques de 1929 et le massacre d’Hébron en particulier sont un pas supplémentaire dans l’évolution des relations entre Juifs et Arabes dans la région et jouent un rôle déterminant tant pour l’histoire du sionisme que pour celle du nationalisme palestinien. Elles mettent un terme à une présence juive à Hébron.
24 août 1943 : mort à 34 ans de la philosophe humaniste Simone Weil.
Sans élaborer de système nouveau, elle souhaite faire de la philosophie une manière de vivre, non pour acquérir des connaissances, mais pour être dans la vérité. Dès 1931, elle enseigne la philosophie et s’intéresse aux courants marxistes antistaliniens. Elle est l’une des rares philosophes à avoir tenté de comprendre la « condition ouvrière » par l’expérience concrète du travail en milieu industriel et agricole. Successivement militante syndicale, proche ou sympathisante des groupes révolutionnaires trotskystes et anarchistes et des formations d’extrême-gauche, mais sans toutefois adhérer à aucun parti politique, écrivant notamment dans les revues La Révolution prolétarienne et La Critique sociale, puis engagée dans la Résistance au sein des milieux gaullistes de Londres, Simone Weil prend ouvertement position à plusieurs reprises dans ses écrits contre le nazisme, et n’a cessé de vivre dans une quête de la justice et de la charité. S’intéressant à la question du sens du travail et de la dignité des travailleurs, elle postule un régime politique qui « ne serait ni capitaliste ni socialiste ».
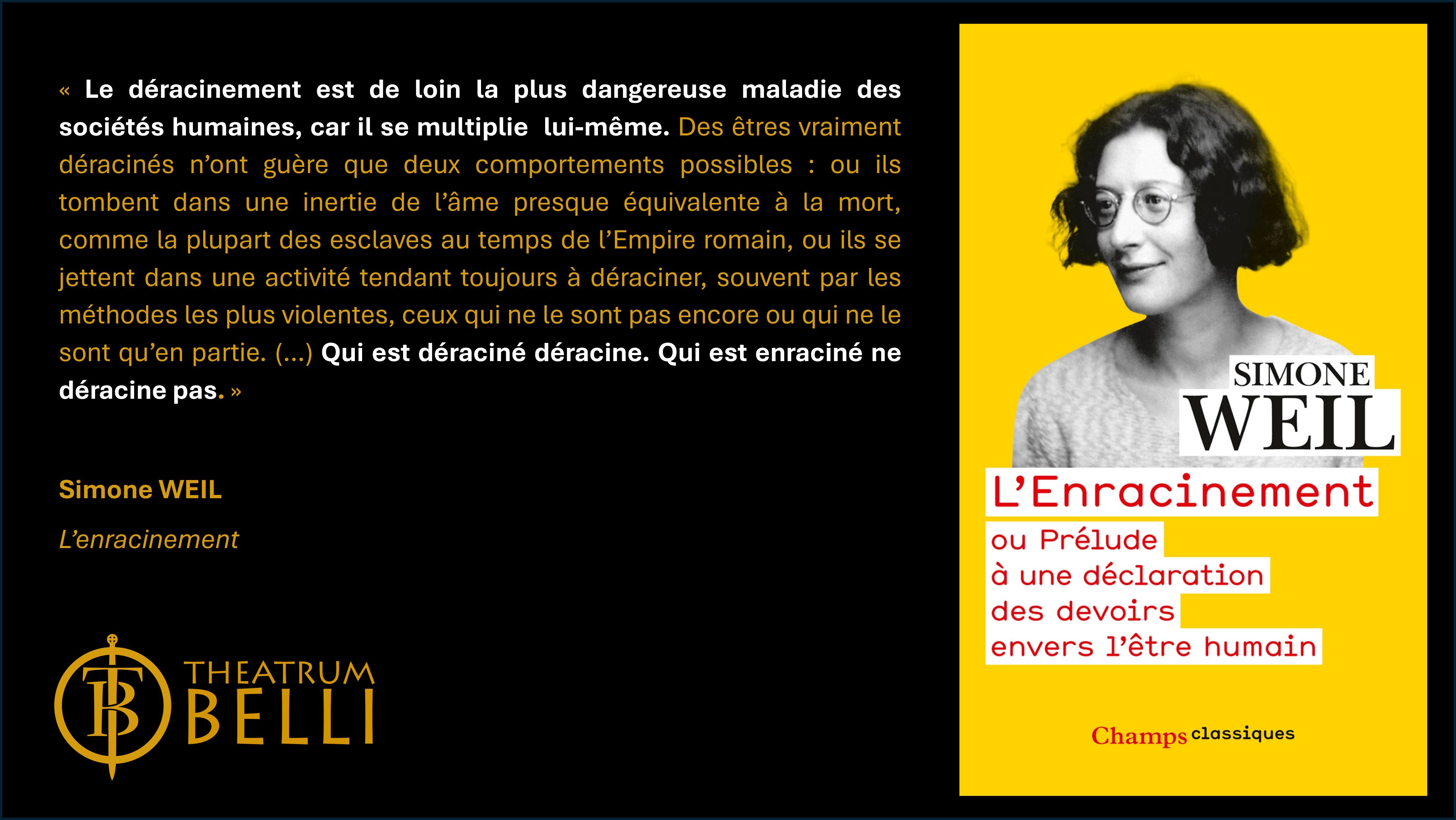
L’enracinement (version audio)
24 août 1944 : mort de l’aspirant François Philippe, compagnon de la Libération.

François Philippe est né le 12 août 1922 à Cysoing dans le Nord.
Chargé par son père de conduire une partie de sa famille en Bretagne au moment de la débâcle de 06/1940, il entend l’Appel du 18/06 et décide de rallier l’Angleterre et de rejoindre le Général de Gaulle. Il prend la mer le 19/06. Parvenu en Grande-Bretagne, il signe son engagement dans les FFL mais, de nouveau considéré comme trop jeune, est affecté, dans un premier temps, au rodage des camions.
Faisant l’impossible pour être muté dans une unité combattante, il parvient à recevoir son affectation au Train des Equipages. En 10/40 il débarque au Cameroun où il suit pendant plusieurs mois une formation militaire. Au sein de la Brigade d’Orient, il reçoit le « baptême du feu » en Erythrée où il se distingue en 03-04/1941. Il est alors nommé brigadier et, pendant la campagne de Syrie, continue à assurer le ravitaillement de son unité avec sang-froid et clairvoyance.
Après les opérations de Syrie de 06/1941, il prend part, au sein de la 1ère BFL, à la campagne de Libye, notamment à Bir-Hakeim où il est grièvement blessé au genou le 26/02/1942, par mitraillage d’avion en assurant le ravitaillement de la position. Après 6 mois passés à l’hôpital et en convalescence, il rejoint la 1ère DFL mais cette fois-ci comme artilleur au 1er Régiment d’artillerie, à ce titre il participe à la bataille d’El Alamein avant d’être présenté d’office à un cours d’élève officier d’artillerie. Le maréchal des logis Philippe est ensuite engagé avec son unité en Tunisie où il est promu au grade d’aspirant le 1/10/1943.
En Italie, à partir du mois de 04/1944, en qualité d’observateur du 2e Groupe du 1er RA, il est toujours à la pointe des combats. Il est cité à l’ordre du corps d’armée pour avoir, lors des combats de 05/44, communiqué d’importants renseignements ayant servi à détruire la résistance ennemie malgré un violent feu d’artillerie avec un réel mépris du danger.
Le 11/06/1944, il une nouvelle fois blessé à son poste de combat, à l’observatoire de Montefiascone par un éclat d’obus. Refusant de se laisser évacuer, il rejoint avec enthousiasme son unité. Une fois la campagne d’Italie achevée, il fait partie de la délégation de la 1ère DFL reçue par le Pape Pie XII. Le 16/08/1944 il débarque en Provence et participe à la bataille pour la prise de Toulon.
Le 24 août, en recherche d’observation avancée pour réduire les dernières résistances de Toulon, l’aspirant Philippe et la jeep de l’Etat-major du 2e Groupe sont pris sous le feu de canons de 88 allemands sur la route de la Farlède à La Crau.
Il est tué sur le coup. Il a été inhumé au cimetière de La Crau (Var).
• Chevalier de la Légion d’Honneur
• Compagnon de la Libération
• Croix de Guerre 39/45 (2 citations)
• Croix de Guerre 39/45 (2 citations)
• Médaille Coloniale avec agrafes « Erythrée » – « Libye 42 » – « Tunisie »
• Médaille Commémorative de la Guerre 39/45
24 août 1944 : 3e attaque aérienne sur le cuirassé allemand Tirpitz (opération Goodwood).
L’opération Goodwood était une série de raids aériens britanniques menés contre le cuirassé allemand Tirpitz à son mouillage dans le Kaafjord, en Norvège occupée, fin août 1944. Ce fut la dernière d’une série d’attaques menées par la Home Fleet en 1944, visant à endommager ou à couler le Tirpitz et ainsi à éliminer la menace qu’il représentait pour la navigation alliée. Les précédents raids sur le Kaafjord menés par l’aviation navale n’avaient impliqué qu’une seule attaque aérienne ; l’opération Goodwood en a compté plusieurs en une seule semaine. La Royal Navy espérait que ces raids affaibliraient les redoutables défenses allemandes.
La flotte britannique quitta sa base le 18 août et lança son premier raid contre Kaafjord le matin du 22 août. L’attaque échoua, et un petit raid le soir même infligea peu de dégâts. Des attaques furent menées les 24 et 29 août, également infructueuses. Le Tirpitz avait été touché par deux bombes lors du raid du 24 août, mais aucune n’avait causé de dégâts significatifs. Les pertes britanniques lors de l’opération Goodwood s’élevèrent à 17 avions toutes causes confondues, une frégate coulée par un sous-marin et un porte-avions d’escorte gravement endommagé. Les forces allemandes subirent la perte de 12 avions et des dommages à 7 navires.
Fin août 1944, la responsabilité de l’attaque du Tirpitz fut transférée à la Royal Air Force. Lors de trois raids de bombardiers intensifs menés en septembre et octobre 1944, le cuirassé fut d’abord endommagé, puis coulé. Les historiens considèrent l’opération Goodwood comme un échec majeur pour la Fleet Air Arm et attribuent ses résultats aux faiblesses de ses avions et de son armement.

***
Dès le début de l’année 1942, le Tirpitz représentait une menace importante pour les convois alliés transportant du ravitaillement vers l’Union soviétique via la mer de Norvège. Stationné dans les fjords de la côte norvégienne, le cuirassé était capable de submerger les forces d’escorte rapprochée affectées aux convois arctiques ou de percer dans l’Atlantique Nord. Pour contrer cette menace, les Alliés devaient maintenir une puissante force navale au sein de la Home Fleet britannique , et des navires capitaux accompagnaient la plupart des convois sur une partie du trajet jusqu’à l’Union soviétique.
Plusieurs attaques aériennes et navales furent lancées contre le Tirpitz en 1942 et 1943. Le 6 mars 1942, des bombardiers-torpilleurs du porte-avions HMS Victorious attaquèrent le cuirassé alors qu’il tentait d’intercepter le convoi PQ 12, mais ne réussirent à l’atteindre. Des bombardiers de la Royal Air Force et des forces aériennes soviétiques tentèrent également de frapper le Tirpitz dans ses mouillages à plusieurs reprises en 1942 et 1943, sans toutefois lui infliger de dégâts. Le 23 septembre 1943, deux sous-marins de poche britanniques de classe X pénétrèrent les défenses entourant le mouillage principal du cuirassé à Kaafjord, dans le nord de la Norvège, lors de l’opération Source, et placèrent des charges explosives dans l’eau sous lui. Cette attaque causa d’importants dommages au Tirpitz, le mettant hors service pendant six mois.
À la suite de l’opération Source, l’attaque du Tirpitz fut confiée aux porte-avions de la Home Fleet. Après des mois de préparatifs, une attaque réussie (opération Tungsten), impliquant deux forces d’attaque composées de 20 bombardiers en piqué Fairey Barracuda escortés par 40 chasseurs, fut menée le 3 avril 1944. Si l’équipage du Tirpitz subit de lourdes pertes durant cette opération, le cuirassé ne fut pas gravement endommagé. Néanmoins, il fut mis hors service pendant plusieurs mois supplémentaires, le temps de terminer les réparations.
La Home Fleet lança quatre autres raids contre le Tirpitz entre avril et juillet 1944, bien que le cuirassé ne soit attaqué que lors de la dernière de ces opérations. Ces attaques furent entravées par le transfert de nombreux aviateurs de la Home Fleet vers d’autres unités après l’opération Tungsten, car les équipages de remplacement étaient moins expérimentés. Le premier raid (Opération Planet) commença le 21 avril, mais il fut annulé trois jours plus tard lorsque des agents stationnés près de Kaafjord signalèrent du mauvais temps au-dessus de la zone cible. La Home Fleet reprit la mer pour attaquer à nouveau le Tirpitz à la mi-mai dans ce qui fut désigné comme l’opération Brawn. Une force de frappe de 27 Barracudas escortés par des chasseurs Vought F4U Corsair et Supermarine Seafire décolla des porte-avions HMS Furious et Victorious le 15 mai, mais retourna aux navires sans attaquer après avoir rencontré de lourds nuages au-dessus du Kaafjord. Le raid suivant, l’opération Tiger Claw, a été lancé fin mai mais annulé en raison du mauvais temps le 28 du mois. L’attaque suivante (opération Mascot) a été programmée pour la mi-juillet, avant la reprise des convois arctiques, suspendus depuis avril 1944 afin de libérer des navires pour le débarquement de Normandie. La force de frappe de 44 Barracudas et 40 chasseurs dépêchés le 17 juillet a atteint la zone cible, mais a trouvé le Tirpitz masqué par un écran de fumée protecteur et l’attaque n’a pas réussi à infliger de dommages au cuirassé.
Dans les semaines qui suivirent l’opération Mascot, le Tirpitz continua de se préparer à d’éventuelles opérations de combat. Après des essais dans les eaux abritées de l’Altafjord, il prit la mer le 31 juillet et le 1er août pour s’entraîner avec ses destroyers de protection. Des générateurs de fumée supplémentaires furent également installés autour du Kaafjord pour améliorer les défenses déjà solides de la zone. Ces activités furent rapportées par des espions, et l’Amirauté britannique les interpréta comme signifiant que le Tirpitz se préparait à un raid contre la marine alliée. Pour se défendre contre cette menace, il fut décidé de mener de nouvelles attaques contre le cuirassé à son mouillage dans le Kaafjord au moment de la prochaine série de convois arctiques. En réalité, la marine allemande ne prévoyait pas d’utiliser le Tirpitz de manière offensive car il serait très vulnérable aux forces navales et aériennes alliées supérieures s’il prenait la mer. Au lieu de cela, le cuirassé était maintenu en service actif pour immobiliser les navires de guerre et les avions alliés.
L’échec de l’opération Mascot convainquit le commandant de la Home Fleet, l’amiral Sir Henry Moore, que l’avion d’attaque principal de la Fleet Air Arm, le bombardier en piqué Fairey Barracuda, n’était pas adapté aux opérations contre le Kaafjord. La faible vitesse des bombardiers en piqué donnant aux défenseurs du Kaafjord suffisamment de temps pour couvrir le Tirpitz d’un écran de fumée entre le moment où les raids étaient détectés et leur arrivée au-dessus de la zone cible, Moore conclut que de nouvelles attaques utilisant ces appareils seraient vaines. Cependant, l’Amirauté estima que des frappes répétées du Kaafjord avec des Barracudas sur une période de 48 heures risquaient d’affaiblir les défenses allemandes et d’épuiser les réserves de carburant des générateurs de fumée protecteurs du Tirpitz. On envisagea également de faire décoller des porte-avions des bombardiers rapides et à long rayon d’action de Havilland Mosquito pour tenter d’obtenir un effet de surprise, mais aucun de ces avions basés à terre ne pouvait être épargné pour soutenir les bombardements alliés sur l’Allemagne. Malgré ses appréhensions, Moore accepta de tenter une nouvelle frappe contre le Tirpitz.
Comme proposé par l’Amirauté, les plans de Moore pour la nouvelle attaque sur le Kaafjord prévoyaient que les avions de la Home Fleet attaqueraient la région pendant plusieurs jours. Alors que les avions de chasse impliqués dans les raids précédents n’avaient utilisé que leurs mitrailleuses pour mitrailler les défenses allemandes afin de réduire la menace qu’ils représentaient pour les Barracudas, il fut décidé d’utiliser certains de ces appareils comme bombardiers en piqué pendant l’opération Goodwood. En préparation, les deux escadrons de Corsair et un seul escadron de Grumman F6F Hellcat sélectionnés pour participer à l’attaque reçurent un entraînement aux tactiques de bombardement en piqué entre les opérations Mascot et Goodwood. Autre nouveauté : la décision d’utiliser des avions de la Fleet Air Arm pour larguer des mines près de Tirpitz et de l’entrée du Kaafjord. Les mines larguées près du cuirassé devaient être équipées de fusées à retardement, et on espérait que les explosions de ces dispositifs inciteraient le capitaine du Tirpitz à tenter de déplacer le navire de guerre vers des eaux plus sûres et à traverser le champ de mines à l’entrée du fjord. Au cours de la période précédant l’opération Goodwood, les escadrons volants de la Home Fleet ont mené des exercices d’entraînement en utilisant un champ de tir à Loch Eriboll dans le nord de l’Écosse ; le terrain dans cette zone est comparable à celui autour de Kaafjord, et le loch avait également été utilisé à cette fin dans le cadre des préparatifs de l’opération Tungsten.
La flotte d’attaque de l’opération Goodwood était divisée en trois groupes. L’amiral Moore embarqua à bord du cuirassé HMS Duke of York, qui naviguait avec les porte-avions HMS Indefatigable (navire amiral du contre-amiral Rhoderick McGrigor, commandant de la 1re escadre de croiseurs), Formidable et Furious, ainsi que deux croiseurs et quatorze destroyers. La deuxième force comprenait les porte-avions d’escorte HMS Nabob et Trumpeter, le croiseur HMS Kent et un groupe de frégates. Deux pétroliers escortés par quatre corvettes naviguaient séparément pour soutenir les deux groupes d’attaque.
Les porte-avions embarquaient le plus grand groupe d’avions de la Fleet Air Arm assemblé jusqu’à ce point de la guerre. Leur principal élément frappant était les 35 Barracuda affectés aux 820, 826, 827 et 828 escadrons aéronavals qui opéraient à partir des trois porte-avions de la flotte. Les deux unités de la 6e escadre de chasse navale, les 1841 et 1842 escadrons, pilotaient 30 Corsair depuis le Formidable. Un total de 48 Seafire étaient affectés aux 801, 880, 887 et 894 escadrons à bord de l’Indefatigable et du Furious. De plus, les 1770 et 1840 escadrons exploitaient respectivement 12 chasseurs Fairey Firefly et 12 Hellcat depuis l’Indefatigable. Les deux porte-avions d’escorte embarquaient un total de 20 Grumman TBF Avengers (qui étaient responsables de l’élément de largage de mines de l’opération Goodwood) et 8 chasseurs Grumman F4F Wildcat ; ces avions étaient répartis entre le 846e Escadron à bord du Trumpeter et le 852e Escadron à bord du Nabob.
Français Le mouillage du Tirpitz à Kaafjord était fortement défendu. Avant l’opération Tungsten, onze batteries de canons antiaériens, plusieurs navires de guerre antiaériens et un système de générateurs de fumée capables de cacher le Tirpitz aux avions étaient situés autour du fjord. Après l’attaque, des stations radar supplémentaires et des postes d’observation ont été établis et le nombre de générateurs de fumée a été augmenté. Les défenses aériennes du Tirpitz ont été renforcées en l’équipant de canons supplémentaires de 20 millimètres, en modifiant les canons de 150 millimètres afin qu’ils puissent être utilisés pour attaquer les avions et en fournissant des obus antiaériens pour ses canons principaux de 380 millimètres. La Luftwaffe avait peu de chasseurs stationnés sur les aérodromes près de Kaafjord, et leurs opérations étaient limitées par un manque de carburant.
22 août
La force d’attaque de l’opération Goodwood appareilla le 18 août. Le calendrier de l’opération était prévu pour permettre à la Home Fleet de protéger également le convoi JW 59, parti d’Écosse le 15 août à destination de l’Union soviétique. Après un voyage sans incident vers le nord, les forces d’attaque arrivèrent au large de la Norvège le 20 août. Alors que la première attaque contre Kaafjord était prévue pour le 21 août, les conditions météorologiques ce jour-là étaient impropres aux opérations aériennes, et Moore décida de la reporter de 24 heures. Les Allemands furent alertés de la présence de la flotte britannique le 21 août, lorsque des messages radio des porte-avions furent détectés.
La première frappe contre Kaafjord fut lancée le 22 août. Les conditions de vol étant mauvaises en raison de la faible couverture nuageuse, Moore décida d’attaquer ce jour-là, car certains de ses navires commençaient à manquer de carburant et devaient bientôt quitter la Norvège pour se ravitailler. À 11 heures, une force composée de 32 Barracuda, 24 Corsair, 11 Fireflie, 9 Hellcat et 8 Seafire fut lancée depuis les trois porte-avions. Aucun Avenger ne fut dépêché, le ciel nuageux étant inadapté à l’exécution de leur mission. Étant donné le peu de mines disponibles et l’impossibilité pour les Avenger d’atterrir en toute sécurité avec ces armes, le largage de mines du plan aurait échoué si les avions ne parvenaient pas à localiser le Tirpitz et devaient larguer leurs charges à la mer.
Alors que la force de frappe approchait de la côte, d’épais nuages furent aperçus couvrant les collines près du Kaafjord. Parce que les nuages empêchaient un bombardement précis, les Barracuda et les Corsair retournèrent vers les porte-avions sans attaquer. Les chasseurs Hellcat et Firefly continuèrent leur route et s’approchèrent du fjord sous la base des nuages. Ces avions réussirent à surprendre, et le Tirpitz ne fut pas masqué par la fumée lorsqu’ils arrivèrent au-dessus du Kaafjord. Les Fireflie lancèrent l’attaque à 12 h 49 en mitraillant les canons antiaériens allemands sur et autour du Tirpitz . Deux minutes plus tard, neuf Hellcat attaquèrent le cuirassé avec des bombes de 230 kg mais ne réussirent à aucun coup. Alors que la force de frappe retournait vers les porte-avions, elle détruisit deux des hydravions du Tirpitz dans le port de Bukta et endommagea gravement le sous-marin U-965 à Hammerfest. À Ingøy , au nord de Hammerfest, trois Hellcat mitraillèrent une station radio allemande. L’attaque mit le feu aux bâtiments de la station et endommagea les antennes. Les huit Seafire lancèrent des attaques de diversion sur la zone de Banak et une base d’hydravions voisine, détruisant cinq hydravions allemands. Trois avions britanniques furent perdus lors de l’attaque du matin du 22 août ; un Hellcat et un Seafire furent abattus, et l’un des Barracuda fut contraint d’amerrir en mer lors de son vol de retour.
Français Après la récupération de la force de frappe, une grande partie de la Home Fleet s’éloigna des côtes norvégiennes pour se ravitailler en carburant. Un groupe comprenant le Formidable, le Furious, deux croiseurs et plusieurs destroyers mit le cap sur les deux pétroliers de la flotte, et le groupe de porte-avions d’escorte se retira afin que les porte-avions puissent ravitailler leurs escorteurs. À 17 h 25, le Nabob fut touché par une torpille tirée par l’U-354. Le porte-avions subit de graves dommages et 21 morts, mais put poursuivre des opérations aériennes limitées. Peu après, l’U-354 torpilla la frégate HMS Bickerton alors que cette dernière recherchait l’attaquant du Nabob. Le Nabob fut contraint de retourner à la base de la Home Fleet à Scapa Flow ce soir-là, escorté par le Trumpeter, un croiseur et plusieurs destroyers. Le Formidable et le Furious couvrirent leur retrait ; Durant cette période, le Furious se ravitailla également en carburant auprès des pétroliers de la Home Fleet. Le départ des deux porte-avions d’escorte signifia l’annulation de la composante de largage de mines de l’opération Goodwood. La poupe du Bickerton fut détruite par la torpille, et il aurait pu être renfloué. Cependant, le commandant de la force ne souhaitait pas avoir à protéger deux navires endommagés, et la frégate fut sabordée vers 20h30 le 22 août. Peu après les attaques contre le Nabob et le Bickerton , des Seafire du 894e escadron aéronaval abattirent deux avions de reconnaissance allemands Blohm & Voss BV 138.
Dans la soirée du 22 août, une force de huit Firefly et de six Hellcat armés de bombes de l’Indefatigable lança un nouveau raid sur le Kaafjord. Ce fut la première d’une série de petites attaques de harcèlement destinées à affaiblir les défenses allemandes. Les forces allemandes ne détectèrent pas les avions avant leur arrivée au-dessus du Kaafjord à 19 h 10, et les attaques de mitraillage des Firefly sur les positions allemandes tuèrent un membre de l’équipage du Tirpitz et en blessèrent dix. Cependant, les bombes des Hellcat ne parvinrent pas à infliger de dégâts au cuirassé. Les chasseurs britanniques attaquèrent également des navires et des stations radar allemands lors de leur vol de retour, endommageant deux pétroliers, un navire de ravitaillement et un patrouilleur. Aucun avion britannique ne fut perdu lors de ce raid.
24 août
Le brouillard a provoqué l’annulation des opérations aériennes de l’Indefatigable le 23 août, y compris une attaque de diversion prévue contre la navigation allemande à Langfjord. Les deux autres porte-avions et leurs escortes ont rejoint le Moore et l’Indefatigable au large de la Norvège dans la matinée du 24 août. Bien que les conditions ce jour-là étaient initialement brumeuses, le temps s’est suffisamment éclairci dans l’après-midi pour permettre une frappe contre Kaafjord. La force d’attaque comprenait 33 Barracuda transportant des bombes perforantes de 730 kg, 24 Corsair (dont 5 armés d’une bombe de 450 kg), 10 Hellcat, 10 Firefly et 8 Seafire. Dans une tentative de surprise, les avions ont décollé des porte-avions d’un point plus au sud que ceux utilisés lors des raids précédents. L’avion d’attaque a ensuite volé parallèlement à la côte, avant d’atterrir et d’approcher du Kaafjord par le sud. Une station radar allemande a détecté la force à 15 h 41 et a immédiatement alerté le Tirpitz.
L’attaque britannique a commencé à 16 heures. Elle a été initiée par des attaques sur les positions de canons allemands par les Hellcat et les Firefly, qui volaient cinq minutes devant les Barracuda et les Corsair. L’écran de fumée protecteur du Tirpitz n’était pas complètement en place au début du raid, mais au moment où les Barracudas et les Corsair sont arrivés, il était complètement recouvert de fumée. En conséquence, ces avions ont dû bombarder le navire à l’aveugle, larguant leurs armes à des altitudes comprises entre 5 000 et 4 000 pieds (1 500 et 1 200 m). Seules deux bombes ont touché le Tirpitz. La première était une bombe de 230 kg larguée par un Hellcat qui a explosé sur le toit de sa tourelle principale « Bruno ». Français L’explosion détruisit le quadruple support de canon antiaérien de 20 millimètres situé au sommet de la tourelle, mais ne causa pas de dommages significatifs à la tourelle elle-même. La deuxième bombe à frapper le navire était une bombe perforante de 730 kg) qui traversa cinq ponts, tua un marin dans une salle radio et se logea près d’une salle de commutation électrique. Cette bombe n’explosa pas, et les experts allemands en déminage déterminèrent plus tard qu’elle n’avait été que partiellement remplie d’explosifs. Le rapport allemand sur l’attaque jugea que si la bombe avait explosé, elle aurait causé des dommages « incommensurables ». Les chasseurs britanniques attaquèrent également d’autres navires et installations allemands dans la région du Kaafjord, endommageant deux patrouilleurs, un dragueur de mines et une station radar, ainsi qu’un dépôt de munitions et trois canons d’une batterie antiaérienne. Le dernier hydravion Arado Ar 196 du Tirpitz fut attaqué dans le port de Bukta et endommagé au-delà de toute réparation. Quatre Corsair et deux Hellcat furent abattus pendant le raid, et l’équipage du cuirassé subit 8 morts et 18 blessés. Les pertes parmi les unités antiaériennes stationnées autour de Kaafjord furent lourdes.
À 19 h 30 le 24 août, deux Firefly effectuèrent une sortie de reconnaissance photographique au-dessus du Kaafjord pour recueillir des renseignements sur les résultats de l’attaque ; leur présence poussa les Allemands à générer un écran de fumée au-dessus du fjord et à tirer un barrage antiaérien intensif. Lors d’une autre action ce jour-là, l’U-354 fut coulé au large de Bear Island par le Fairey Swordfish opérant depuis le porte-avions d’escorte HMS Vindex qui escortait le convoi JW 59.
Le commandement allemand de Kaafjord jugea que les attaques du 24 août avaient été « sans aucun doute les plus lourdes et les plus déterminées jusqu’à présent » et demanda le transfert d’unités de chasse du nord de la Finlande pour renforcer les défenses de la zone. Compte tenu des autres besoins de la chasse allemande à cette époque, la demande fut rejetée le 26 août par le quartier général de la Luftwaffe.
Les coups de vent et le brouillard empêchèrent les Britanniques de mener de nouvelles attaques entre le 25 et le 28 août. Le 25 août, l’Indefatigable, le Formidable, deux croiseurs et sept destroyers se ravitaillèrent en carburant auprès des pétroliers. Les deux croiseurs se détachèrent plus tard de la force et retournèrent à Scapa Flow. Le Duke of York, le Furious, un croiseur et cinq destroyers naviguèrent également vers les îles Féroé pour charger des provisions. Avant de quitter la flotte, le Furious transféra deux Barracudas et une paire de Hellcat à l’Indefatigable. Le vieux Furious étant jugé inapte aux opérations de combat, il quitta les îles Féroé pour Scapa Flow avec le croiseur et plusieurs destroyers. Le 29 août, le Duke of York et les destroyers restants rejoignirent le corps principal de la Home Fleet au nord de la Norvège. Durant cette période, le personnel de maintenance des escadrons volants s’est employé à réparer les avions qui avaient été endommagés lors des attaques du 24 août.
Le convoi JW 59 termina son voyage le 25 août, la plupart de ses navires accostant à Kola, dans le nord de la Russie. Le convoi avait été attaqué à plusieurs reprises par des sous-marins allemands du 20 au 24 août, et ses navires de guerre et avions d’escorte coulèrent deux sous-marins. Tous les navires marchands arrivèrent sains et saufs, la seule perte alliée étant le sloop HMS Kite, torpillé et coulé par l’U-344 le 21 août.
29 août
L’attaque finale de l’opération Goodwood eut lieu le 29 août. La force de frappe comprenait 26 Barracuda, 17 Corsair (dont deux armés de bombes de 450 kg), 10 Firefly et sept Hellcat. Sept Seafire effectuèrent également un raid de diversion sur Hammerfest. Afin de fournir aux bombardiers des points de visée précis une fois l’écran de fumée artificiel généré autour de Tirpitz, quatre Hellcat furent armés de bombes indicatrices de cible. Les bombardiers commencèrent leurs tirs à 15 h 30.
Les avions britanniques ne parvinrent pas à créer la surprise. Les stations radar allemandes suivaient les patrouilles anti-sous-marines et de chasse de routine de la Home Fleet, et les Seafire furent détectés à 16 h 40 alors qu’ils se trouvaient à 87 km du Kaafjord. En réponse à ce rapport, les générateurs de fumée autour du Kaafjord furent activés et les défenseurs du fjord rejoignirent leurs positions de combat. L’arrivée du gros des avions britanniques au-dessus du Kaafjord fut retardée par des vents plus forts que prévu et une erreur de navigation, et ils n’atteignirent la zone cible qu’à 17 h 25. À ce moment-là, le Tirpitz était recouvert d’un épais écran de fumée, et aucun des aviateurs britanniques n’aperçut le navire. Les Barracuda et les Corsair furent contraints de bombarder le Kaafjord à l’aveugle, et bien qu’aucun coup ne fût porté au cuirassé, six membres de son équipage furent blessés par des fragments de bombes provenant de quasi-collisions. Les navires et les positions de tir allemands furent une fois de plus mitraillés par les chasseurs, sans toutefois causer de dégâts significatifs. Un tir antiaérien nourri depuis le Tirpitz, dirigé par un groupe d’observateurs postés sur une montagne près de Kaafjord, abattit un Corsair et un Firefly.
Après le raid du 29 août, la Home Fleet fit route vers l’ouest pour couvrir le convoi RA 59A, parti du nord de la Russie le 28 août à destination du Royaume-Uni. En raison de pénuries de carburant, l’Indefatigable et trois destroyers se détachèrent plus tard dans la journée pour retourner à Scapa Flow, suivis 24 heures plus tard par le Formidable et deux destroyers. Le Duke of York et six destroyers restèrent en poste dans la mer Arctique jusqu’à 11 heures le 1er septembre, date à laquelle le convoi fut jugé à l’abri d’une attaque.
Au total, les pertes de la Fleet Air Arm pendant l’opération Goodwood s’élevèrent à 40 aviateurs tués et 17 avions détruits. Le Nabob fut également jugé au-delà d’une réparation économique et fut retiré du service. Du côté allemand, le Tirpitz ne subit que des dommages superficiels.
Après le raid du 29 août, les Britanniques apprirent grâce aux renseignements transmis par Ultra que le Tirpitz n’avait subi aucun dommage significatif au cours de l’opération Goodwood. Dans des déclarations publiques, la Royal Navy a affirmé avoir endommagé ou coulé 19 navires de guerre allemands au cours des attaques sur Kaafjord, mais n’a pas signalé de dommages au Tirpitz.
Durant les derniers jours de l’opération Goodwood, les planificateurs de la Royal Navy décidèrent de ne pas ordonner de nouvelles opérations de la Fleet Air Arm contre le Kaafjord. Ils considérèrent que les Allemands étaient désormais capables de couvrir le Tirpitz de fumée avant que les Barracuda n’atteignent le cuirassé, et que ces appareils ne pouvaient emporter de bombes suffisamment puissantes pour infliger de lourds dégâts. Une attaque du Kaafjord par des Mosquitos lancés depuis des porte-avions fut envisagée, mais les bombardiers légers restèrent en nombre insuffisant et furent jugés inadaptés à la tâche. De plus, le transfert des porte-avions vers le Pacifique devint de plus en plus nécessaire pour renforcer la contribution britannique à la guerre contre le Japon.
Le Tirpitz étant toujours considéré comme une menace pour la navigation, le Comité des chefs d’état-major britannique et le commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, le général Dwight D. Eisenhower, décidèrent fin août de mener de nouvelles attaques contre lui à l’aide de bombardiers lourds de la Royal Air Force. Le 15 septembre, une force d’Avro Lancaster attaqua le Kaafjord après s’être ravitaillé dans des bases du nord de la Russie et infligea des dommages irréparables au cuirassé. Après ce raid, il fit voile vers un mouillage près de Tromsø pour servir de batterie de défense côtière immobile. Une autre attaque de bombardiers lourds, le 29 octobre, ne causa que des dégâts mineurs. Lors d’un troisième raid organisé le 12 novembre, le Tirpitz fut touché par plusieurs bombes Tallboy et chavira, coulant avec de lourdes pertes humaines.
Les historiens ont jugé l’opération Goodwood comme un échec. En 1961, l’historien officiel britannique Stephen Roskill affirmait que les attaques marquaient la fin d’une « série d’opérations dont les résultats ne peuvent être qualifiés que d’extrêmement décevants ». Il concluait que la possibilité de couler le Tirpitz était « faible » en raison des lacunes des Barracuda et de leur armement. De même, Norman Polmar affirmait en 1969 que l’opération Goodwood était « peut-être l’échec le plus marquant de la FAA (Fleet Air Arm) pendant la Seconde Guerre mondiale et pouvait être directement attribué au manque d’avions performants – les Barracudas étaient trop lents et ne pouvaient emporter des bombes suffisamment puissantes pour mener des attaques efficaces ». Plus récemment, Mark Llewellyn Evans jugeait les résultats de l’opération Goodwood « pathétiques » et Patrick Bishop concluait que « la plus grande opération de la Fleet Air Arm pendant la guerre… s’était soldée par un échec ».
24 août 1944 : mort accidentelle du fameux pilote italien Carlo Emanuele Buscaglia.
Buscaglia est né à Novare, dans le Piémont, en 1915 et est entré à l’Académie aéronautique italienne (Académie de l’armée de l’air) en octobre 1934. En 1937, il a été nommé Sottotenente (sous-lieutenant).
Le 1er juillet 1937, Buscaglia fut affecté au 50e escadron (32e escadre de bombardement), alors équipé du Savoia-Marchetti SM81, obsolète, remplacé plus tard par le SM.79, plus performant. En 1939, il fut promu lieutenant. En février suivant, il fut transféré au 252e escadron (46e escadre de bombardement), et avec cette unité, il participa à sa première mission militaire, le 21 juin 1940.
Le 25 juillet, il se porte volontaire pour rejoindre le Reparto Speciale Aerosiluranti (« Détachement spécial de bombardiers-torpilleurs ») de la Regia Aeronautica, rebaptisé plus tard 240e Escadron de bombardiers-torpilleurs, basé en Libye. Dans la nuit du 17 septembre 1940, Buscaglia remporte son premier succès avec un SM.79 armé de torpilles, endommageant lourdement le croiseur HMS Kent. Début décembre, il attaque également avec succès le croiseur HMS Glasgow.
En janvier 1941, l’unité de Buscaglia fut transférée à Catane, d’où il participa à l’action avec des Ju 87 allemands au cours de laquelle le porte-avions HMS Illustrious fut gravement endommagé. Promu capitaine, Buscaglia fut nommé commandant d’une nouvelle unité de torpilleurs, le 281e escadron, basé à l’ aéroport de Grottaglie, dans les Pouilles. De là, il participa à la bataille du cap Matapan.
En 1942, Buscaglia avait déjà obtenu cinq fois la Médaille d’argent de la valeur militaire et la Croix de fer allemande de deuxième classe. En avril, il fut sélectionné pour commander le nouveau 132e groupe de torpilles, coulant ensuite plusieurs navires en Méditerranée. Le 12 août de la même année, en compagnie de l’as allemand Hans-Joachim Marseille, il fut reçu à Rome par Benito Mussolini, qui le promut major .
Le 12 novembre 1942, lors d’une action contre l’invasion alliée de l’Afrique du Nord, l’avion de Buscaglia fut abattu par un Spitfire britannique. Il fut déclaré « tué au combat » et la Médaille d’or de la vaillance militaire lui fut décernée à titre posthume. Cependant, bien que blessé et gravement brûlé, Buscaglia survécut, ayant été capturé par les troupes alliées et transféré dans un camp de prisonniers de guerre aux États-Unis, à Fort Meade.
Après l’armistice du 8 septembre 1943, Buscaglia fut appelé à combattre aux côtés des Alliés, au sein de la toute nouvelle Aeronautica Cobelligerante del Sud. Entre-temps, dans le nord de l’Italie encore occupé par l’Allemagne, une aile de l’Aeronautica Nazionale Repubblicana (l’armée de l’air de la République sociale italienne fantoche), le 1° Gruppo Aerosiluranti, portait son nom.
Le 15 juillet 1944, Buscaglia prit le commandement de la 28e escadre de bombardiers, équipée de Martin Baltimore et basée à l’aéroport de Campo Vesuvio, près de Naples. Le 23 août, alors qu’il tentait de piloter un de ces nouveaux appareils sans instructeur, Buscaglia s’écrasa au décollage. Il mourut le lendemain à l’hôpital de Naples.
La 3e escadre de l’actuelle Aeronautica Militare Italiana, basée à Villafranca di Verona, porte son nom.

24 août 1949 : le traité créant l’OTAN entre en vigueur (Washington).
Les Etats parties au présent Traité, réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements.
Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit.
Soucieux de favoriser dans la région de l’Atlantique Nord le bien-être et la stabilité. Résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation de la paix et de la sécurité. Se sont mis d’accord sur le présent Traité de l’Atlantique Nord :
Article 1
Les parties s’engagent, ainsi qu’il est stipulé dans la Charte des Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s’abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
Article 2
Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s’efforceront d’éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d’entre elles ou entre toutes.
Article 3
Afin d’assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et conjointement, d’une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.
Article 4
Les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée.
Article 5
Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales.
Article 6 ¹
Pour l’application de l’article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :
- contre le territoire de l’une d’elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d’Algérie 2, contre le territoire de la Turquie ou contre les îles placées sous la juridiction de l’une des parties dans la région de l’Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer;
- contre les forces, navires ou aéronefs de l’une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu’en toute autre région de l’Europe dans laquelle les forces d’occupation de l’une des parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou dans la région de l’Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci.
Article 7
Le présent Traité n’affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 8
Chacune des parties déclare qu’aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n’est en contradiction avec les dispositions du présent Traité et assume l’obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le Traité.
Article 9
Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d’elle sera représentée pour examiner les questions relatives à l’application du Traité. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l’application des articles 3 et 5.
Article 10
Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre Etat européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l’Atlantique Nord. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant son instrument d’accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d’accession.
Article 11
Ce Traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats qui l’ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, y compris celles de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées et entrera en application à l’égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification 3.
Article 12
Après que le Traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l’une d’elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus conformément à la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 13
Après que le Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.
Article 14
Ce Traité, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.
NOTES :
-
La définition des territoires auxquels l’article 5 s’applique a été modifiée par l’article 2 du Protocole d’accession au Traité de l’Atlantique Nord de la Grèce et de la Turquie, signé le 22 octobre 1951
-
Le 16 janvier 1963, le Conseil de l’Atlantique Nord a noté que, s’agissant des anciens départements français d’Algérie, les clauses pertinentes du Traité étaient devenues inapplicables à la date du 3 juillet 1962.
-
Le Traité est entré en vigueur le 24 août 1949, après le dépôt des instruments de ratification de tous les Etats signataires.

24 août 1949 : mort à 73 ans de l’ingénieur aéronautique britannique John William Dunne.
John William Dunne est né le 2 décembre 1875 à Curragh Camp, un camp de l’armée britannique dans le comté de Kildare, en Irlande. Il était le fils aîné de l’Irlandais Sir John Hart Dunne, KCB (1835–1924), et de son épouse anglaise Julia Elizabeth Dunne (née Chapman). Bien que né en Irlande d’un père irlandais, il était né d’une mère anglaise et n’était né en Irlande que parce que son père était lieutenant-colonel du 99e régiment britannique (Lanarkshire), qui se trouvait alors en poste dans ce pays.
 Il passa la majeure partie de son enfance et de sa carrière en Angleterre. Très jeune, il fut victime d’un grave accident et resta alité pendant plusieurs années. C’est à cette époque qu’il s’intéressa à la philosophie. À neuf ans seulement, il interrogea sa nourrice sur la nature du temps. À treize ans, il fit un rêve dans lequel il se trouvait dans un engin volant sans direction.
Il passa la majeure partie de son enfance et de sa carrière en Angleterre. Très jeune, il fut victime d’un grave accident et resta alité pendant plusieurs années. C’est à cette époque qu’il s’intéressa à la philosophie. À neuf ans seulement, il interrogea sa nourrice sur la nature du temps. À treize ans, il fit un rêve dans lequel il se trouvait dans un engin volant sans direction.
Après le déclenchement de la Seconde Guerre des Boers, Dunne s’engagea comme simple soldat dans l’Imperial Yeomanry et combattit en Afrique du Sud sous les ordres du général Roberts. En 1900, il fut victime d’une épidémie de fièvre typhoïde et fut rapatrié.
Rétabli et nommé sous-lieutenant dans le régiment du Wiltshire le 28 août 1901, il retourna en Afrique du Sud pour une seconde mission en mars 1902. Il tomba de nouveau malade et fut diagnostiqué d’une maladie cardiaque, ce qui le força à rentrer chez lui l’année suivante. Il consacra une grande partie de son temps restant dans l’armée à des travaux aéronautiques pendant son congé maladie.
En congé de maladie militaire en 1901, Dunne entreprit une étude systématique du vol. Son premier essai de maquette, inspiré d’un roman de Jules Verne, échoua. Comme beaucoup d’autres pionniers, il observa attentivement les oiseaux en vol. Cependant, contrairement à la plupart, il était convaincu qu’un avion sûr devait posséder une stabilité aérodynamique intrinsèque. Encouragé notamment par H.G. Wells, dont il se lia d’amitié en 1902, il réalisa un grand nombre de petits modèles d’essai qui aboutirent finalement au développement d’une configuration d’aile en flèche sans empennage stable.
À son retour en Angleterre pour la deuxième fois, il reprit ses études de vol et, en 1906, il avait développé une configuration de « pointe de flèche » à aile en flèche et sans queue qui était intrinsèquement stable et deviendrait sa marque de fabrique.
À la demande du colonel John Capper , commandant de l’unité, il fut affecté en juin 1906 à la nouvelle usine de ballons de l’armée à South Farnborough. Dunne souhaitait construire un monoplan, mais à l’époque, l’armée réclamait des biplans et Capper lui donna des instructions en conséquence.
Un planeur habité, le D.1, équipé de moteurs et d’hélices, fut construit dans le plus grand secret et, en juillet 1907, transporté à Blair Atholl, dans les Highlands écossaises, pour des essais en vol. Lors de son unique vol réussi, Capper le fit voler juste assez longtemps pour démontrer sa stabilité avant de s’écraser contre un mur. Il fut réparé et équipé de son châssis motorisé, mais fut endommagé lors de sa première et unique tentative de vol, lorsque le chariot de décollage dévia de sa trajectoire.
Durant l’hiver 1907-1908, Dunne conçut le triplan Dunne-Huntington et un planeur plus petit, le D.2, pour tester ce concept. Le planeur ne fut pas construit, mais l’appareil grandeur nature fut finalement construit par AK Huntington et vola avec succès à partir de 1910.
La saison 1908 à Blair Atholl vit l’arrivée de deux nouveaux appareils de Farnborough : le planeur D.3 et l’aéroplane motorisé D.4. Le planeur vola bien sous les ordres du lieutenant Launcelot Gibbs, tandis que le D.4 connut un succès limité, manquant cruellement de puissance et, par conséquent, selon les termes de Dunne, « plus un sauteur qu’un avion ».
Dunne retourna à la fabrique de ballons au milieu d’une enquête gouvernementale sur l’aéronautique militaire. Suite à ses conclusions, le ministère de la Guerre cessa tout travail sur les avions à moteur et, au printemps 1909, Dunne quitta la fabrique de ballons. Il était alors également membre de la Société aéronautique.
Grâce à l’investissement financier de ses amis, Dunne créa le Blair Atholl Aeroplane Syndicate pour poursuivre ses expériences et occupa un hangar sur le nouveau terrain d’aviation de l’aéroclub à Eastchurch, sur l’île de Sheppey. Short Brothers y possédait une usine et fut chargé de construire le D.5, un biplan globalement similaire, sur lequel Dunne installa un moteur Green de 35 ch plus puissant. Après une série de vols de plus en plus réussis, le 20 décembre 1910, Dunne démontra la stabilité intrinsèque du D.5 devant un public émerveillé, parmi lequel figuraient deux observateurs officiels, Orville Wright et Griffith Brewer, ce qui en fit le premier avion dont la stabilité en vol était démontrée. Il put lâcher les commandes et prendre des notes sur une feuille de papier.
Le projet suivant de Dunne, indépendant de l’armée, fut un monoplan, le D.6, construit par son ancien commandant, le colonel Capper. Il ne vola pas, mais ses dérivés, le D.7 et le D.7bis, volèrent de 1911 à 1913. Des exemplaires de construction britannique volèrent à Sheppey et à Larkhill , dans la plaine de Salisbury, et un autre fut construit par la société Astra en France.
Parallèlement aux travaux sur les monoplans, le biplan Dunne D.8 fut développé à partir du D.5. En 1913, un exemplaire fut acheté par Nieuport (qui avait repris l’activité aéronautique d’Astra) et traversa la Manche pour rejoindre la France. L’année suivante, Farnborough, fortement réorganisée, évalua le modèle. La production fut concédée sous licence à Nieuport en France et à Burgess aux États-Unis, mais seul le Burgess-Dunne fut produit en série.
À partir de 1913, la santé fragile de Dunne le contraignit à se retirer de l’aviation active. Le Blair Atholl Syndicate fut racheté par le conglomérat d’armement Armstrong Whitworth, et Dunne commença à travailler sur un D.11. Lorsque la guerre éclata en 1914, le projet fut abandonné et Dunne se consacra à d’autres travaux.
Dunne a publié son premier livre sur la pêche à la mouche sèche en 1924, avec une nouvelle méthode de fabrication de mouches artificielles réalistes .
Parallèlement, il étudiait les rêves prémonitoires qu’il croyait avoir vécus avec d’autres. En 1927, il avait élaboré la théorie du temps sériel qui allait le rendre célèbre et en publia un compte rendu, ainsi que ses recherches sur les rêves, dans son ouvrage suivant, An Experiment with Time. En 1932, la Society for Psychical Research (SPR) tenta de reproduire ses résultats expérimentaux sur la précognition des rêves, mais son chercheur, Theodore Besterman, échoua suite à une controverse. Le rédacteur en chef de la revue de la SPR introduisit même son rapport par un avertissement distanciant la Société de ses conclusions, et Dunne donna sa propre version deux ans plus tard dans une nouvelle édition de son livre.
Lors de la première de sa pièce de théâtre « Time and the Conways » (1937) du dramaturge J.B. Priestley , Dunne présenta sa théorie à la troupe. Il donna ensuite une émission télévisée. Dunne continua à travailler sur le sérialisme tout au long de sa vie et écrivit plusieurs autres livres, ainsi que de fréquentes mises à jour de « An Experiment with Time ».
Le 3 juillet 1928, à l’âge de 52 ans, il épousa l’honorable Cicely Twisleton-Wykeham-Fiennes, fille de Geoffrey Cecil Twisleton-Wykeham-Fiennes, 18e baron Saye et Sele, et ils vécurent ensuite longtemps au château de Broughton, résidence familiale . Ils eurent deux enfants et il leur écrivit certaines de ses histoires du soir dans deux autres livres, Les Lions sauteurs de Bornéo et Saint Georges et les sorcières (publié aux États-Unis sous le titre « Une expérience avec Saint George »).
Dunne créa quelques-uns des premiers avions pratiques et stables. La plupart d’entre eux se distinguaient par leur configuration sans queue et en flèche. La stabilité était obtenue par un enroulement progressif du bord d’attaque, de l’emplanture à l’extrémité, une caractéristique connue sous le nom de « washout ». Un équilibre judicieux de ses caractéristiques permettait l’utilisation de seulement deux commandes de vol. L’inconvénient était que, sans gouvernail, les atterrissages par vent de travers étaient impossibles et l’approche devait se faire face au vent.
Les avions conçus par Dunne comprenaient :
- D.1, 1907. Biplan, d’abord utilisé comme planeur, puis la version motorisée fut endommagée lors de sa première tentative de décollage.
- D.2. Petit planeur d’essai proposé pour le triplan Dunne-Huntington, non construit.
- Triplan Dunne-Huntington , conçu entre 1907 et 1908, utilisé en 1910. Aile tandem triple avec aile centrale haute et aile avant plus petite, ce qui conduit certains à le qualifier de biplan. Construit par le professeur AK Huntington selon la conception de Dunne, le seul type qui n’était pas de configuration balayée sans queue.
- D.3, 1908. Planeur biplan, volait bien.
- D.4, 1908. Biplan motorisé, réalisant des sauts courts.
- D.5, 1910. Biplan motorisé. Premier avion Dunne à voler, premier avion sans queue à voler, stable en vol. Suite à un accident, il fut reconstruit sous une forme modifiée, le D.8.
- D.6 , 1911. Monoplan, n’a jamais volé.
- D.7, 1911. Monoplan, volait bien. Le D.7-bis était une version du D.7 propulsée par un moteur Gnome .
- D.8, 1912. Biplan, construit en plusieurs exemplaires. Le D.8-bis était une version du D.8 propulsée par un moteur Gnome ; un exemplaire a volé d’ Eastchurch à Paris en 1913.
- D.9, 1913. Projet de biplan ou sesquiplan à envergure inégale, jamais réalisé.
- D.10, 1913. Version à portée plus courte du D.8. S’est avéré un échec.
- Burgess-Dunne. Variantes construites sous licence dérivées du D.8 et fabriquées sous licence aux États-Unis de 1913 à 1916 ; versions terrestres et hydravions ; ont volé avec les forces aériennes militaires américaines et canadiennes.
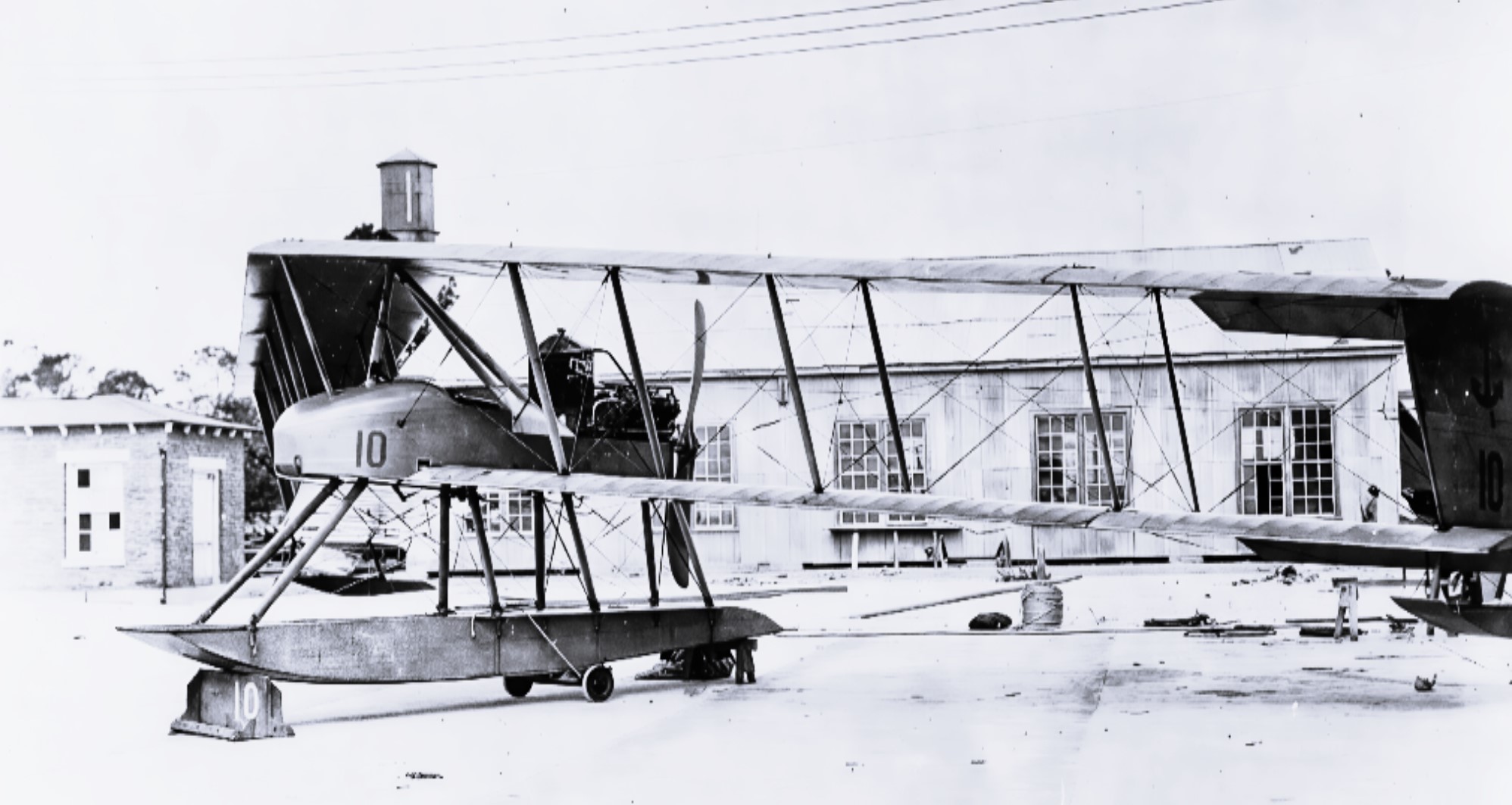
24 août 1954 : un hélicoptère Piasecki H-21C Shawnee devient le 1er hélicoptère à traverser les États-Unis sans escale avec l’aide d’un ravitaillement en vol.
Le Piasecki H-21 Workhorse/Shawnee est un hélicoptère américain, le quatrième d’une série d’hélicoptères à rotor tandem conçus et construits par Piasecki Helicopter (plus tard Boeing Vertol ). Communément appelé « la banane volante », c’était un hélicoptère multi-missions, pouvant être équipé de roues, de skis ou de flotteurs. Le H-21 a été initialement développé par Piasecki comme hélicoptère de sauvetage en Arctique. Ses caractéristiques de fonctionnement par temps froid lui permettaient de fonctionner jusqu’à -54 °C et de bénéficier d’une maintenance régulière dans des conditions de froid extrême.
Piasecki Helicopter a conçu et vendu avec succès à la marine américaine une série d’hélicoptères à rotors tandem, à commencer par le HRP-1 de 1944. Le HRP-1 était surnommé la « banane volante » en raison de l’inclinaison ascendante de son fuselage arrière, qui garantissait que les grands rotors ne puissent pas heurter le fuselage, quelle que soit l’attitude de vol. Ce nom a ensuite été appliqué à d’autres hélicoptères Piasecki de conception similaire, dont le H-21.
En 1949, Piasecki proposa à l’US Air Force (USAF) le YH-21 Workhorse, une version améliorée et entièrement métallique du HRP-1. Doté de deux rotors tripales contrarotatifs en tandem, entièrement articulés, le H-21 était propulsé par un moteur radial Curtis-Wright R-1820-103 Cyclone neuf cylindres suralimenté et refroidi par air , développant 1 150 ch.
Français Après le premier vol du YH-21 le 11 avril 1952, l’USAF commanda 32 modèles SAR H-21A et 163 de la variante de transport d’assaut H-21B plus puissante. Le H-21B était équipé d’une version améliorée du moteur Wright 103, développant 1 425 chevaux-vapeur (1 063 kW) et doté de pales de rotor allongées de 6 pouces (152 mm). Grâce à ses capacités améliorées, le H-21B pouvait transporter 22 fantassins entièrement équipés ou 12 civières, plus de la place pour deux infirmiers, en tant qu’hélicoptère d’ évacuation sanitaire. Grâce à ses capacités hivernales arctiques, les H-21A et H-21B furent mis en service par l’USAF et l’Aviation royale canadienne (ARC) pour entretenir et entretenir les installations radar du Réseau d’alerte avancée (DEW) s’étendant des îles Aléoutiennes et de l’Alaska à travers l’ Arctique canadien jusqu’au Groenland et à l’Islande.
En 1952, quelques H-21A ont été évalués par l’escadron d’hélicoptères HMX-1 de l’USMC pour l’assaut aérien.
Le 24 août 1954, grâce au ravitaillement en vol assuré par un U-1A Otter de l’armée américaine, un H-21C connu sous le nom d’Amblin’ Annie est devenu le premier hélicoptère à traverser les États-Unis sans escale. L’armée a expérimenté l’armement du H-21C comme hélicoptère de combat ; certains Shawnee étaient équipés de canons flexibles sous le nez, tandis que d’autres étaient équipés de canons de porte.
En 1957, un H-21B a été prêté au Corps des Marines des États-Unis (USMC) pour évaluer l’hélicoptère comme remorqueur aéroporté pour remorquer des navires de débarquement et des véhicules de débarquement amphibies en panne jusqu’à la plage. Au cours de l’évaluation, le H-21B a remorqué un LST à 5 nœuds (9,3 km/h ; 5,8 mph) et un véhicule amphibie à chenilles simulé de l’eau jusqu’à la plage. Le moteur Wright amélioré de 1425 ch utilisé dans le H-21B a également été utilisé dans les variantes ultérieures vendues à la fois à l’armée américaine (sous le nom de H-21C Shawnee) et aux forces militaires de plusieurs autres nations. En 1962, le H-21 a été rebaptisé CH-21 dans l’armée américaine.
En 1959, Vertol Aircraft, nouveau nom de Piasecki Helicopters, a imaginé un concept de transport de charges lourdes sur courtes distances, consistant à relier entre deux et six H-21B par des poutres pour soulever de lourdes charges. Ce système était jugé dangereux, car un problème mécanique sur l’un des hélicoptères pendant le levage pouvait déséquilibrer la structure et provoquer le crash de tous les hélicoptères.

24 août 1958 : mort de Maurice Bonté, compagnon de la Libération.

Maurice Bonté est né le 22 septembre 1904 à Zonnebeke (Belgique).
Ouvrier agricole, de nationalité belge, il s’engage dans la Légion étrangère à Nevers le 14 septembre 1939. Affecté d’abord au 1er régiment étranger d’infanterie (1er REI) en Algérie, il passe en mars 1940 à la 13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère (13e DBMLE). Avec cette unité, il participe à la campagne de Norvège (combats de Narvik et de Bjervik) au printemps 1940.
Evacué en Grande-Bretagne avec le corps expéditionnaire commandé par le général Béthouart, il choisit de continuer le combat dans les rangs de la France libre dès juillet 1940.
Avec la 13e Demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE), il prend part à l’opération devant Dakar (septembre 1940) puis à la campagne d’Erythrée contre les Italiens (mars-mai 1941) et à celle de Syrie contre les forces de Vichy (juin-juillet 1941).
Caporal en septembre 1941, il combat en Libye avec la 1ère brigade française libre et notamment à Bir-Hakeim. Il est promu caporal-chef en octobre 1942 juste avant d’être blessé une première fois à la cheville par éclat d’obus lors des combats d’El Alamein en Egypte le 23 octobre 1942. Cela ne l’empêche pas de panser des camarades blessés et d’en aider un autre à rejoindre les lignes avant d’être évacué sur le groupe sanitaire de la division.
Rétabli, il rejoint son unité fin janvier 1943 et prend part à la fin de la campagne de Tunisie avant de combattre en Italie d’avril à juin 1944. Il débarque en Provence le 17 août 1944 et prend part aux combats de libération du Sud-est et de la vallée du Rhône.
Promu sergent en septembre 1944, Maurice Bonté se distingue dans les Vosges. Le 5 novembre 1944, il est gravement blessé par balle en menant son groupe de combat à l’attaque de la cote 1013 sur les hauteurs de Rochesson. Longuement hospitalisé, il est démobilisé début 1946.
Il retrouve alors la Nièvre et son métier d’ouvrier agricole.
Maurice Bonté est décédé le 24 août 1958 à Cosne-sur-Loire. Il a été inhumé à Saint-Père dans la Nièvre.
• Compagnon de la Libération – décret du 7 mars 1945
• Médaille Militaire
• Croix de Guerre 1939/45 (3 citations)
• Médaille Coloniale avec agrafes « Erythrée », « Libye », « Bir-Hakeim », « Tunisie »
• Médaille du Levant
• Médaille des Blessés
24 août 1966 : mort à 71 ans du général polonais Tadeusz Bór-Komorowski.
Fils de Mieczysław Komorowski et Wanda née Zaleska, Tadeusz Komorowski est né à Chorobrów dans la propriété de son parent le général Tadeusz Rozwadowski.
Diplômé en 1913 du lycée de Lwów, il entame sa carrière militaire dans l’armée austro-hongroise. En 1915, il sort de l’Académie militaire thérésienne avec le grade de sous-lieutenant de cavalerie.
Pendant la Première Guerre mondiale, Komorowski sert sur les fronts russe et italien. Après le recouvrement de l’indépendance de la Pologne à la fin de la guerre, il intègre l’armée polonaise et sert dans le 9e Régiment de lanciers de la Petite-Pologne. En , il prend le commandement du 12e Régiment des lanciers de Podolie.
Il participe à la guerre contre les bolcheviks et il est blessé lors de la bataille de Komarów, l’une des plus grandes batailles de cavalerie du XXe siècle, terminée par une lourde défaite de l’armée soviétique de Semion Boudienny. Pour sa participation aux combats contre l’Armée rouge, Komorowski est décoré de l’Ordre de Virtuti Militari et trois fois de la Croix de la Valeur.
Ensuite, il est adjoint du commandant du 9e Régiment de lanciers à Żółkiew. Excellent cavalier, il devient instructeur d’équitation à l’école des officiers d’artillerie à Toruń (1922-1923), adjoint du commandant du 8e Régiment de lanciers à Cracovie, puis commandant de l’école professionnelle des sous-officiers à Jaworów (1926 -1928). Ensuite, pendant dix ans, il commande le 9e régiment de lanciers, stationné d’abord à Czortków puis à Trembowla. En 1938, il est nommé commandant de l’École centrale de cavalerie à Grudziądz.
En 1924, Komorowski fait partie de l’équipe hippique polonaise aux Jeux olympiques d’été à Paris. Aux Jeux olympiques d’été de 1936 à Berlin, il entraîne l’équipe équestre polonaise (Henryk Leliwa-Roycewicz, Zdzisław Kawecki, Seweryn Kulesza) qui remporte une médaille d’argent au concours complet.
Pendant la campagne de Pologne de 1939, il est le commandant d’un groupe de cavalerie à Garwolin, puis adjoint du colonel Adam Zakrzewski, commandant de la brigade de cavalerie dans l’armée « Lublin ». Après la fin des combats, Komorowski évite la captivité et se rend à Cracovie où il crée Organizacja Wojskowa (OW), une organisation militaire clandestine qu’il dirige jusqu’à sa fusion en avec Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), l’ancêtre de l’Armia Krajowa (AK).
En , Komorowski gagne Varsovie où il est nommé adjoint du commandant en chef de l’AK, le général Stefan Rowecki. AK, une véritable armée de l’intérieur placée sous l’autorité politique du Gouvernement polonais en exil à Londres, dirigé par le général Władysław Sikorski qui cumule alors les postes de premier ministre et de chef des forces armées polonaises. En été 1944, Armia Krajowa comptera plus de 300 000 hommes et femmes, ce qui en fait le mouvement de résistance le plus important d’Europe.
Après l’arrestation de Stefan Rowecki par la Gestapo le , Tadeusz Komorowski le remplace au commandement de l’AK. L’arrestation du chef de la Résistance polonaise dans le pays coïncide, à quelques jours près, avec la disparition du général Władysław Sikorski, le chef du Gouvernement polonais en exil, dans un accident d’avion à Gibraltar du .
La situation de la Pologne libre est d’autant plus fragilisée que les relations diplomatiques avec les Soviétiques sont rompues par le Kremlin depuis le 25 avril 1943, à la suite de la demande du gouvernement polonais d’explications au sujet de la découverte du charnier de milliers d’officiers polonais à Katyn.
Le , Komorowski donne l’ordre de lancer l’Opération Tempête dans une tentative de coopération militaire avec l’Armée rouge en mouvement vers la Pologne dans la lutte contre l’Allemagne. C’est aussi une tentative politique de persuader les Soviétiques de reconnaître les droits polonais sur les terres de la Deuxième République Polonaise sur lesquelles l’Armée rouge est entrée.
Les expériences des combats des mois suivants dans la région de Vilnius, ainsi que dans les provinces de Lwów et de Tarnopol, montrent rapidement que les Soviétiques n’ont pas l’intention de reconnaître l’indépendance de la Pologne.
À l’origine, l’Opération Tempête élaborée encore par Rowecki ne prévoyait pas de combats à Varsovie. Cependant, au début du mois de , le premier ministre Stanisław Mikołajczyk, dans un message adressé au délégué du gouvernement au pays, demande si une telle éventualité est prévue. En Pologne, cette dépêche est interprétée comme une invitation à élaborer une stratégie adéquate. Le , les généraux Tadeusz Komorowski, Leopold Okulicki, pseudonyme Niedźwiadek (Petit ours), et Tadeusz Pełczyński, Grzegorz, décident d’entreprendre des opérations militaires dans la capitale.
Au cours des jours suivants, les consultations au sein du quartier général de l’armée de l’intérieur polonaise se poursuivent. Le Conseil de l’Unité Nationale se déclare favorable à la prise de Varsovie avant que l’Armée rouge n’y entre.
Le , le Gouvernement polonais autorise le général Komorowski et Jan Stanisław Jankowski pseudonyme « Soból », vice-Premier ministre du gouvernement et son délégué au pays, de commencer une action armée pour libérer Varsovie. Les radios soviétiques demandent aussi un soulèvement. Avec l’Armée rouge à l’approche de la ville, le général Komorowski donne l’ordre du soulèvement de Varsovie qui débute le 1er. Il s’agit d’une décision politique aux conséquences tragiques, mais mûrement réfléchie. Les Polonais savent que l’Armée rouge qui progresse à l’Est ne se bat pas pour libérer la Pologne mais pour y remplacer le système totalitaire nazi par le système totalitaire communiste. L’insurrection de la capitale polonaise sera l’un des épisodes les plus tragiques de la seconde guerre mondiale.
Pendant 63 jours, la bataille fait rage avec une sauvagerie sans précédent. Les estimations des effectifs de l’AK vont de 250 000 à 350 000 combattants. La moitié n’est même pas armée. Mis à part les soldats de l’AK, d’autres se portent volontaires, y compris des femmes et des enfants tout juste adolescents. Alors que la situation des insurgés devient de plus en plus dramatique, l’Armée rouge reste passive, arrêtée sur la rive droite de la Vistule. Elle bloque même l’approvisionnement en munitions des unités polonaises au sein de l’Armée rouge pour les empêcher de secourir leurs compatriotes assiégés. L’insurrection de Varsovie reçoit un soutien très limité de la part des Alliés occidentaux. Des parachutages peu nombreux d’armes et d’autres matériels n’ont que très peu d’impact.
Le , le général Komorowski est nommé par le président Władysław Raczkiewicz commandant en chef des Forces Armées Polonaises à la suite de la démission du général Kazimierz Sosnkowski. Le 1er, face à une défaite inévitable, Komorowski désigne son successeur à la tête de la Résistance polonaise : le général Leopold Okulicki. Le , le général Komorowski signe l’acte de reddition avec les honneurs militaires.
Cependant, cette capitulation ne met pas fin au calvaire de Varsovie. Hitler ordonne qu’elle soit « rasée sans laisser de traces ». La ville sera détruite à 85 %. La capitale polonaise n’est plus qu’un « point géographique » alors que d’innombrables actes de génocide sont commis sur la population civile. 180 000 civils périssent. 60 000 civils sont déportés dans des camps de concentration et 150 000 condamnés aux travaux forcés en Allemagne ou à l’errance dans leur pays. Quant aux insurgés, 18 000 sont tués, 25 000 sont blessés et 15 000, dont le général Komorowski, sont envoyés en captivité.
Komorowski est interné dans un camp de prisonniers de guerre, l’Oflag 73 à Langwasser, puis à partir de à Colditz en Saxe. Dans les derniers jours de la guerre, il est évacué et transporté en Suisse. Libéré par les Alliés en , il s’exile à Londres où il est obligé de gagner sa vie comme tapissier puisque le gouvernement britannique retire sa reconnaissance au gouvernement londonien de son ancien allié polonais.
Cependant, Tadeusz Komorowski continue à se préoccuper du sort de la communauté polonaise. Premier ministre du gouvernement polonais en exil de 1947 à 1949, il est ensuite membre, avec le général Władysław Anders et le comte Edward Raczyński, du Conseil des Trois, autorité politique principale des émigrés.
En 1952, il publie ses mémoires intitulés Histoire de l’armée secrète.
Il meurt à Londres le où il sera enterré. Son épouse Irena, née en 1904, est morte en 1968.
En 1994, son fils Adam Komorowski ramène les cendres du général en Pologne, qui sont alors inhumées avec les honneurs au cimetière de Powązki à Varsovie. L’uniforme du général est un des objets les plus précieux du Musée de l’Armia Krajowa et de l’État polonais clandestin à Cracovie.
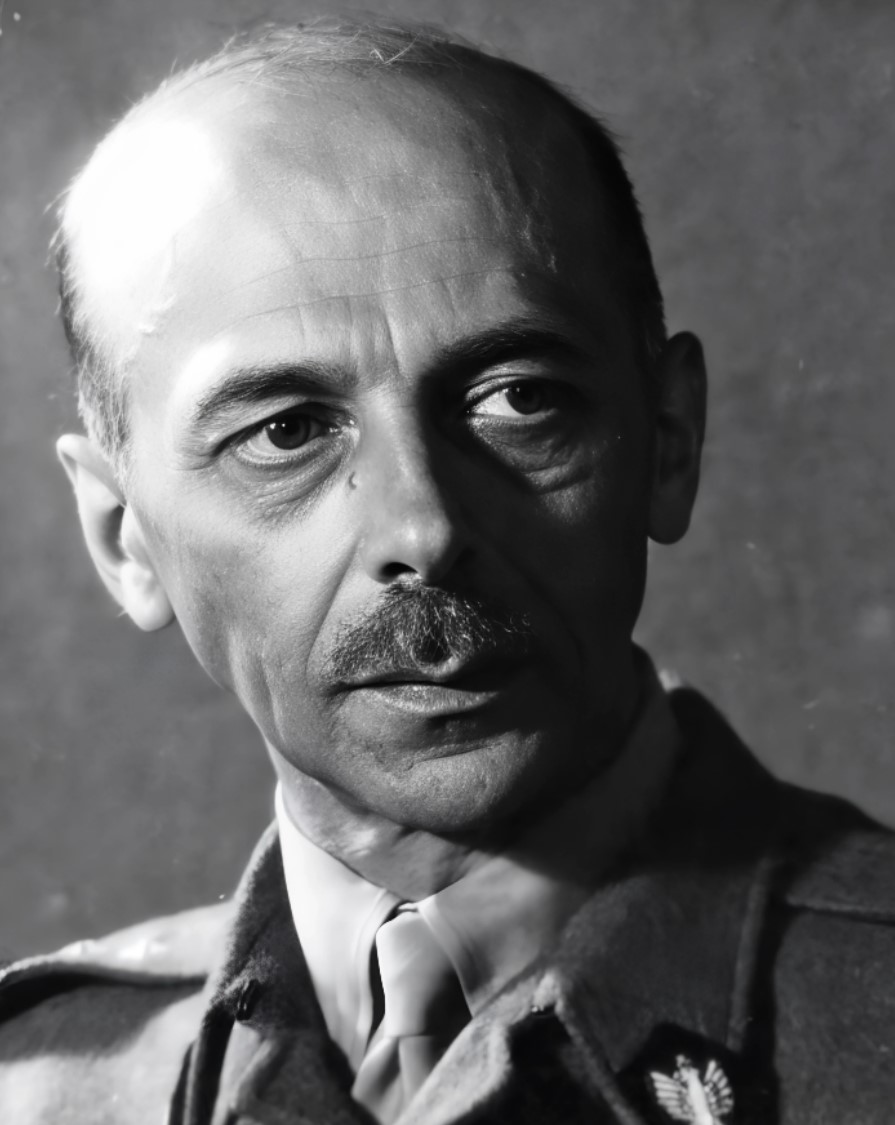
24 août 1968 : premier essai de la bombe H française « Canopus » (Fangataufa).
Canopus, ou opération Canopus, est le nom de code pour le premier test par la France d’une arme à fusion nucléaire, dite bombe H. Ce trentième essai nucléaire français fut effectué le au-dessus de l’atoll de Fangataufa, en Polynésie française.
En 1966, la France a été en mesure d’utiliser la fusion d’isotopes de l’hydrogène pour doper la fission du plutonium. Robert Dautray, physicien nucléaire, est choisi par le CEA pour mener l’effort de développement visant à construire une arme à deux étages (fission-fusion). La France n’a pas alors la capacité de produire les matériaux nécessaires pour les deux étapes du dispositif thermonucléaire. L’achat de 151 tonnes d’eau lourde à la Norvège et de 168 tonnes supplémentaires provenant des États-Unis est nécessaire. Cette eau lourde est mise dans les réacteurs nucléaires Celestins I et II de l’usine de Marcoule en 1967 pour produire le tritium nécessaire pour le dispositif.
La France teste le nouveau dispositif dans le cadre d’une série de cinq tirs effectués en Polynésie française entre juillet et . Fangataufa est choisi comme l’emplacement de l’explosion en raison de son isolement, à l’écart de la base principale se situant à Moruroa.
Le général de Gaulle doit assister à ce premier tir d’une bombe H, mais à la suite des évènements politiques de Mai 68, il est remplacé par Robert Galley, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales du gouvernement Maurice Couve de Murville, qui commande le tir Canopus depuis la passerelle du navire amiral, le croiseur antiaérien De Grasse.
C’est également le seul essai français où les autorités font évacuer un territoire : tous les habitants de l’atoll de Tureia, situé à une centaine de kilomètres au nord de Fangataufa, sont invités à rejoindre Papeete sans que soient officiellement évoqués les risques de retombées radioactives. Les îles concernées sont Mangareva, Pukarua, Reao, Tuamotu-Gambier et Tureia.
La bombe, d’une masse d’environ trois tonnes, est suspendue à partir d’un grand ballon rempli d’hydrogène. Elle explose à 18 h 30 min 00.5 s GMT à une altitude de 550 mètres, avec un rendement de 2,6 mégatonnes, ce qui en fait l’essai le plus puissant jamais réalisé par la France.
Par la réussite de sa détonation, la France devient la cinquième nation thermonucléaire, après les États-Unis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni et la République populaire de Chine. Charles de Gaulle déclare « C’est un magnifique succès pour l’indépendance et la sécurité de la France ».
En 1964-1966, la Marine nationale française mobilise plus de 100 bâtiments pour la construction des installations du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) en Polynésie française, comprenant un quartier-général à Papeete, la BA 185 avancée à Hao (460 KM au nord-ouest de Moruroa), le polygone de tir atomique de Moruroa et le polygone de tir atomique de Fangataufa. À l’été 1965, la Marine nationale française crée le Groupe aéronaval du Pacifique (dit groupe Alfa puis force Alfa) de plus de 3 500 hommes, comprenant le porte-avions Foch et six autres bâtiments (les escorteurs d’escadre Forbin, La Bourdonnais et Jauréguiberry, les pétroliers La Seine et Aberwrach, le bâtiment de soutien Rhin). La force Alfa appareille le de Toulon et aborde la Polynésie française le afin de superviser les essais atmosphériques n° 18 « Aldébaran », n° 19 « Tamouré », n° 20 « Ganymède » et n° 21 « Bételgeuse ». Durant la traversée, la France quitte le commandement intégré de l’OTAN.
Le groupe aérien embarqué du Foch comprend 24 avions (12 avions de sûreté Alizé, 8 avions d’assaut Étendard IV-M et 4 avions de reconnaissance Étendard IV-P) et 22 hélicoptères (10 HSS-1, 6 Alouette II et 6 Alouette III) et est chargé de surveiller et sécuriser la zone dite « dangereuse » (dispositif Phoebus). Après que sont repérés à plusieurs reprises dans la zone d’exclusion le bâtiment de recherches scientifiques USS Belmont (en) et le navire de contrôle de missiles et d’engins spatiaux USS Richfield, un sous-marin de nationalité inconnue et un avion ravitailleur (vraisemblablement d’observation et de recueil de prélèvements atomiques) KC-135 de l’USAF n° 9164, le à 5 h 5, un Mirage IV n° 9 largue sa bombe A AN-21 à chute libre n° 2070 au large de Moruroa. Après deux autres tirs le et le , la force Alfa quitte la Polynésie française le .
La seconde Force Alfa quitte Toulon le pour arriver en Polynésie française le . Elle comprend le porte-avions Clemenceau et les mêmes autres bâtiments que lors de la campagne de 1966 (les trois escorteurs d’escadre, les deux pétroliers et le bâtiment de soutien). Ce groupe est complété, sur zone, par la Division des avisos du Pacifique, composée des Protet, Commandant Rivière, Amiral Charner, Doudart de Lagrée et Enseigne de vaisseau Henry. Quant au groupe aérien, il est composé d’Alizé, d’Étendard IV-M et d’hélicoptères HSS-1, Alouette II, Alouette III et Super Frelon. Le , l’essai n° 30 « Canopus » d’une bombe H, exécuté à Fangataufa, libère 2,6 mégatonnes. Plusieurs bâtiments américains et quelques chalutiers soviétiques sont aperçus lors de la campagne de tir. Avec la venue de la Force Alfa, l’ensemble du dispositif naval présent autour des deux atolls a représenté plus de 40 % du tonnage de la flotte française, soit 120 000 tonnes.
24 août 1974 : mort du général Henry Farret, compagnon de la Libération.

Henry Farret, né le 10 août 1908 à Toulon et mort dans la même ville le 24 août 1974.
Petit-fils d’un officier de marine, fils d’un saint-cyrien mort pour la France en 1918, il intègre Saint-Cyr en 1928 dans la promotion « Maréchal Foch » où il a pour camarade Jacques Massu, il en sort en 1930 avec le grade de Sous-lieutenant. Affecté dans un premier temps au 54e régiment de tirailleurs indochinois, il est muté en 12/30 au 4e RTS. En 09/1931, il rejoint le 2e RTS au Soudan français. Promu Lieutenant en 1932, il quitte le 2e RTS en 09/1933 pour retrouver le 4e RTS. Il y reste jusqu’en 07/1938 avec une parenthèse au 1er BTS entre 04/1935 et 06/1937. En 07/1938, il est muté au Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad.
Promu capitaine en 06/1940 et n’admettant pas la défaite, il apprend que le Tchad se joint à la France libre sous l’influence de Félix Éboué auquel il se rallie. Déplacé dans la région du Borkou, il est d’abord chargé de la défense du territoire tchadien puis, en 12/1942, il rejoint la colonne Leclerc. Affecté à la 1re compagnie de découverte et de combat du groupement Dio, il participe à partir de 12/1942 à l’opération Gratuity destinée à chasser les troupes de l’axe de la région libyenne du Fezzan. Engagé dans la campagne de Tunisie à partir de 02/1943, il s’illustre lors de la bataille de Ksar Ghilane après laquelle il est promu chef de bataillon le 25/03/1943. Le 25/06/1943, il reçoit la croix de la libération.
La colonne Leclerc étant devenue la Force L puis la 2e division blindée, celle-ci par pour l’Angleterre en vue de débarquer en France. En 08/1944, à la tête d’un bataillon du régiment de marche du Tchad, il débarque sur Utah Beach et prend part à la bataille de Normandie au cours de laquelle il se distingue pendant les prises d’Alençon et de Carrouges. Suivant la progression de la 2e DB, il participe ensuite à la Libération de Paris où il repousse une contre-attaque allemande dans le secteur du Bourget. Transféré à la 10e division d’infanterie du général Billote en 09/1944, il est chargé de former et encadrer des troupes issues des FFI. À la fin de la guerre, il est promu lieutenant-colonel.
Après avoir suivi une formation d’officier d’état-major, il est envoyé à Madagascar où, en 02/1947, il prend le commandement du détachement motorisé autonome de Madagascar. De retour en métropole en 08/1949, il devient en 12/1949 sous-chef d’état-major à la 5e région militaire à Toulouse. Il est promu colonel en 04/1951 et part pour l’Indochine où il commande un régiment dans la région de Sontay. Tombé malade, il est rapatrié en 1953 et, après une affectation en Allemagne, commande les troupes d’une subdivision militaire française. En 08/1965, alors qu’il vient d’être nommé général de brigade, il prend sa retraite.
• Commandeur de la Légion d’Honneur
• Compagnon de la Libération
• Grand Officier de l’Ordre National du Mérite
• Croix de Guerre 39/45 (5 citations)
• Croix de Guerre des TOE (2 citations)
24 août 1974 : mort à 80 ans du pionnier militaire russe (puis américain) Alexander Prokofieff de Seversky, défenseur du bombardement stratégique.
De filiation noble russe, Seversky est né à Tbilissi, faisant alors partie de l’Empire russe et appelé Tiflis (aujourd’hui en Géorgie). Il est entré dans une école militaire à 10 ans. Le père Nikoloz Gedevanishvili Seversky était l’un des premiers aviateurs russes à posséder un avion (une version modifiée du Blériot XI construits par Mikheil Grigorashvili) et à 14 ans, quand Seversky est entré à l’École navale de la Russie impériale, son père lui avait déjà appris à voler. Ingénieur diplômé en 1914, le lieutenant Seversky servait en mer dans une flottille de destroyers quand la Première Guerre mondiale a débuté.
Seversky, sélectionné pour servir en tant que pilote dans l’aéronavale, a été transféré à l’École militaire d’aéronautique de Sébastopol, en Crimée. Après avoir terminé un programme de troisième cycle sur l’aéronautique en 1914-1915, il a été affecté en tant que pilote l’été 1915 dans une unité d’aviation de la flotte de la Baltique. Stationné dans le golfe de Riga, pour sa première mission, il a attaqué un destroyer allemand, mais fut touché par l’ennemi, l’avion prit feu avant d’avoir pu larguer ses bombes. Les bombes ont explosé dans le crash, tuant son navigateur et blessant grièvement Seversky.
Les médecins ont dû amputer sa jambe au-dessous du genou et bien qu’il ait été équipé d’une jambe artificielle et malgré ses protestations, les autorités l’on jugé inapte à retourner au combat. Pour prouver à ses supérieurs qu’il pouvait encore voler, Seversky est apparu à l’improviste dans un spectacle aérien, mais a été arrêté à la suite de sa performance aérienne téméraire.
Le tsar Nicolas II est intervenu pour lui et en , Seversky est retourné en mission de combat, abattant son premier avion ennemi le troisième jour. Le , il est forcé d’atterrir en territoire ennemi, mais réussit à revenir en sécurité dans ses propres lignes. Il a ensuite volé 57 missions de combat, abattant six avions allemands (ses revendications de 13 victoires feraient de lui le troisième as russe de la Première Guerre mondiale, ces victoires sont contestées). En , il assure le commandement du détachement du 2nd Naval Fighter, jusqu’à ce qu’il soit grièvement blessé dans un accident ; un wagon tiré par des chevaux a cassé sa jambe valide. Après avoir servi à Moscou, en tant que chef de l’aviation de poursuite, Seversky retourne au combat.
Seversky est le premier as de la marine russe dans le conflit. Pour ses faits de guerre, il a reçu l’ordre impérial et militaire de Saint-Georges (4e classe), l’ordre de Saint-Vladimir (4e classe), l’ordre de Saint-Stanislas (2e et 3e classe) et l’ordre de Sainte-Anne (2e, 3e et 4e classe).
Pendant la révolution de 1917, Seversky, stationné à Saint-Pétersbourg, est resté sous l’uniforme, à la demande du commandant en chef de la Flotte de la Baltique. En , il est nommé assistant à l’attaché naval de la mission de l’aviation navale russe aux États-Unis. Seversky quitte la Russie via la Sibérie et tandis qu’il est aux États-Unis, il décide d’y rester plutôt que de revenir vers une Russie déchirée par la Révolution. Il s’installe à Manhattan où il a brièvement tenu un restaurant.
En 1918, Seversky offre ses services au ministère de la Guerre en tant que pilote, le général Kenly, chef du Signal Corps, le nommant ingénieur-conseil et pilote d’essai assigné à la production d’avion du district de Buffalo.
Après l’armistice, Seversky devient l’assistant du général Billy Mitchell défenseur de l’aviation, l’aidant dans ses efforts pour prouver que la force aérienne peut couler des cuirassés.
Seversky a déposé et obtenu le premier brevet de ravitaillement en vol en 1921. Au cours des années suivantes, 364 demandes de brevets seront déposées, parmi lesquelles le premier viseur de bombardement gyrostabilisé, que Seversky a développé avec la Sperry Gyroscope Company en 1923.
Utilisant les 50 000 dollars provenant de la vente de son viseur de bombardement au gouvernement américain, Seversky crée la Seversky Aero Corporation en 1923. Spécialisée dans la fabrication de pièces et d’instruments d’avion, la petite entreprise a été incapable de survivre à l’effondrement boursier de 1929.
Le , avec le soutien du milliardaire de Wall Street, Edward Moore, et d’autres investisseurs, il ressuscite l’entreprise en tant que New Seversky Aircraft Corporation à Long Island, New York. S’installer dans l’ancienne usine d’hydravions de EDO Corporation à College Point, Long Island et les brevets de Seversky étaient les principaux atouts de la nouvelle société, résolu à investir dans la recherche et la conception plutôt que de compter sur la fabrication sous licence. Nombre des ingénieurs de Seversky Aircraft étaient des russes ou géorgiens que Seversky avait sauvés des purges de Staline en les amenant aux États-Unis, y compris les ingénieurs en chef Michael Gregor et Alexander Kartveli. Avec Seversky, les concepteurs ont commencé un hydravion monoplan tout métal multiplace : le SEV-3. Cette conception révolutionnaire allait permettre de battre de nombreux records de vitesse dans les National Air Races de 1933 à 1939, souvent piloté par Seversky lui-même qui était le plus grand « porte parole » de l’entreprise. Le , volant à une vitesse d’un peu plus de 370 km/h, Seversky a établi le record mondial de vitesse pour les hydravions à moteur à pistons. Seversky a également établi un record de vitesse transcontinental en 1938.
Le SEV-3 a finalement été l’ancêtre d’une famille d’avions de combat avancés comprenant le SEV-3XLR, le 2-XP (expérimental à deux places), le BT-8 de formation et le chasseur SEV-1P (monoplace).
La modification la plus radicale s’est produite lorsque le train fixe du SEV-1P est remplacé par un train se rétractant en arrière sous le fuselage qui a donné le prototype de la série de chasseurs P-35 A.
Le bureau d’études de Seversky Aircraft dirigé par Seversky était chargé de 25 différents projets innovants, beaucoup d’entre eux sont « mort-né », y compris le Seversky Super-Clipper, un octomoteur de 76,2 m d’envergure, destiné au transport transocéaniques, doté d’un train tricycle et à haute vitesse. Le SEV-S2, pratiquement identique au P-35, qui a été l’objet d’essais en 1937, a dominé les trois dernières courses du Trophée Bendix, en commençant par 1937, lorsque Frank Fuller l’a remporté à une vitesse moyenne de 415,51 km/h.
La Seversky Aircraft Company acquiert de nouvelles installations à Long Island en 1936, achetant trois usines, un terrain d’aviation avec un hangar avec une base de montage d’hydravion à Famingdale et Amityville.
Malgré l’attribution de plusieurs contrats gouvernementaux, Seversky Aircraft Company n’a jamais été capable de faire des profits sous la gestion de Seversky et en , la société a dû être renflouée à nouveau par Paul Moore (le frère et héritier d’Edward). Il accepta de financer le sauvetage de la société à condition que Seversky, en tant que président, effectue des coupes dans son personnel, tandis que le conseil d’administration donnait plus de pouvoirs au directeur-général Wallace Kellett. Un contrat controversé que Seversky négocia en secret avec les Japonais concernant 20 chausseurs SEV-2PA-B3 créa un antagonisme avec le ministère de la Guerre, conduisant inévitablement à la pression du gouvernement américain sur l’USAAC pour limiter le P-35 au premier lot de 76 appareils.

Tandis que Seversky est en Europe pour une tournée de ventes durant l’hiver 1938-1939, le conseil réorganise la compagnie le , rebaptisée Republic Aviation Corporation avec Kellett comme nouveau président. Seversky attaque en justice pour réparation, mais tandis que les actions juridiques traînaient en longueur, le conseil d’administration vote son éviction de la société qu’il avait créée. Republic Aviation allait devenir un mastodonte industriel pendant la Seconde Guerre mondiale avec la conception et la production du P-47 Thunderbolt et dans les années d’après-guerre, une lignée réussie d’avions de chasse, avant d’être rachetée par Fairchild en 1965.
Comme la Seconde Guerre mondiale approchait, Seversky s’absorba dans la formulation de ses théories de la guerre aérienne. Peu après le , jour de l’attaque de Pearl Harbor, il a écrit Victory Through Air Power (Victoire dans les airs), publié en , préconisant l’utilisation stratégique des bombardements aériens. Le livre est un best-seller, (n° 1 sur la liste des best-seller du New York Times), dont la première édition parait à la mi- et reste à la première place pendant quatre semaines), avec cinq millions d’exemplaires vendus. La popularité du livre et son message percutant conduit Walt Disney à l’adapter en un film d’animation du même nom (1943), où Seversky (qui a également servi de conseiller technique) et le Général Mitchell – grâce à des images d’archives – font le commentaire.
Le film d’animation de Disney a reçu un accueil mitigé du box-office et des critiques qui pensaient que c’était contraire à la vocation des studios Disney que l’envoi d’un message de propagande puissant basé sur un argument politique abstrait. L’influence à la fois du livre et du film, en temps de guerre, a été significative, stimulant la conscience populaire et conduisant à un débat national sur la puissance aérienne stratégique.
Seversky a été un des nombreux défenseurs de la stratégie aérienne dont la vision a été réalisée en 1946 par la création du Strategic Air Command et le développement d’avions tels que le Convair B-36 et le B-47 Stratojet. Seversky continue à faire connaître ses idées sur les avions et les armes innovantes, notamment le Ionocraft en 1964 qui devait être un aéronef monoplace, propulsé par le vent ionique issu d’une décharge à haute tension. Une démonstration en laboratoire établit qu’il fallait 90 watts pour soulever un modèle de 60 g et aucune version pilotée n’a jamais été construite.
Dans les années d’après-guerre, Seversky a continué à tenir des conférences et à écrire sur l’aviation et l’utilisation stratégique de la force aérienne. il a ainsi écrit : Air Power: Key to Survival (1950) et America: Too Young to Die! (1961).
Il a reçu en 1939 le trophée Harmon pour les progrès de l’aviation. Pour son travail sur la force aérienne Seversky a reçu la Medal of Merit en 1945 par le président Harry Truman et le Exceptional Service Medallion en 1969 en reconnaissance de son service en tant que consultant spécial pour les chefs d’état-major de l’USAF. En 1970, Seversky a été inscrit dans le National Aviation Hall of Fame.
Avant la création de la Republic Aircraft Corporation, la Seversky Aircraft Corporation a produit les avions suivants, qui étaient tous des variantes du même thème :
- Seversky AT-12 (en)
- Seversky BT-8 (en)
- Seversky FN (en)
- Seversky P-35
- Seversky XP-41
- Seversky 2PA (en)
- Seversky A8V (en)
- Seversky SEV-1XP (en)
- Seversky SEV-3 (en)
- Seversky EP-106 (Export Intercepteur)
- Seversky Navy Type S Chasseur biplace

24 août 1979 : mort à 67 ans de l’aviatrice allemande Hanna Reitsch, titulaire de plus de 40 records. Première femme à piloter un hélicoptère, un avion-fusée et un avion de chasse.
Hanna Reitsch naît en Silésie prussienne dans une famille de la haute bourgeoisie prussienne luthérienne par son père et d’une famille de la basse noblesse autrichienne catholique par sa mère, les Helff Hibler von Alpenheim. Dès son enfance, elle est passionnée d’aviation et rêve de devenir une « missionnaire volante ». Lorsqu’elle n’a pas classe, elle se rend à vélo à l’aérodrome de vol à voile près de Grünau. Elle obtient son baccalauréat (Abitur) en 1931 puis suit des cours à l’École coloniale pour femmes de Rendsburg. À partir de 1932, elle étudie la médecine à Berlin et à Kiel. Parallèlement à ses études, elle obtient son brevet de pilote de planeur et d’avion à moteur en 1932 à Berlin. Elle enregistre son premier record la même année : le record féminin de vol en planeur avec une durée de 5 h 30.

En 1933, Wolf Hirth demande à Hanna Reitsch de travailler comme monitrice dans sa nouvelle école de vol à voile située à Hornberg, près de Schwäbisch Gmünd. De 1933 à 1934, elle participe à une expédition d’exploration au Brésil et en Argentine. Elle arrête également ses études au profit de l’aviation. À partir de , elle travaille comme pilote d’essai à l’Institut allemand de recherche sur les planeurs (Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug) de Darmstadt. En 1936, elle « pulvérise » le record de distance parcourue en planeur en volant 305 km.
En 1937, Hanna Reitsch est détachée, à la demande de l’inspecteur de la Luftwaffe Ernst Udet, au centre d’essais en vol de la Luftwaffe, situé à Rechlin. Elle a alors l’occasion de tester des avions militaires, des Stukas, des bombardiers et des avions de chasse. La même année, elle obtient d’Udet, en tant que première femme au monde, le titre honorifique de Flugkapitän, l’équivalent de commandant de bord. Melitta von Stauffenberg, est également la première femme-pilote de la Lufthansa, obtenant le même titre quelques mois plus tard. Toujours en 1937, Hanna Reitsch est la première femme au monde à survoler les Alpes en planeur.
Elle est également la première femme à piloter l’hélicoptère Focke-Wulf Fw 61, construit en secret par Henrich Focke, dont elle fait une présentation notoire, en 1938 : il s’agit en l’occurrence du premier vol en salle d’un hélicoptère, dans la Deutschlandhalle (palais des fêtes) à Berlin. Placé à l’avant de l’appareil, un moteur en étoile de 160 chevaux entraîne deux hélices sustentatrices disposées symétriquement par rapport à l’axe longitudinal. À l’arrière de l’appareil, une gouverne de profondeur est placée en T au sommet du gouvernail de direction. À l’avant, une petite hélice refroidit le moteur. Cet appareil est connu par ses records : vitesse dépassant 120 km/h, distance parcourue en ligne droite de 230 km, vol vers l’arrière à 30 km/h, descente placée-moteur arrêté, sous le seul freinage des hélices sustentatrices débrayées en autorotation, montée à 2 439 mètres.
En parallèle, Hanna Reitsch remporte la course de planeurs entre l’île de Sylt et Breslau (Silésie).
En 1939, elle effectue les vols de mise au point pour le planeur géant Me 321 destiné aux troupes aéroportées allemandes. Elle effectue également des essais avec le Dornier Do 17 et le Heinkel He 111 pour vérifier si les câbles d’acier des ballons de barrage britanniques peuvent être sectionnés à l’aide d’un dispositif fixé sur les appareils, en l’occurrence une lame montée sur un filin reliant les extrémités des ailes. Ces essais sont interrompus lorsque les câbles d’un ballon se prennent dans l’hélice de son avion. Elle ne doit la vie qu’à la chance de sortir indemne d’un atterrissage en catastrophe.
En 1942, Reitsch vole à Augsbourg sur le premier avion-fusée au monde, le Messerschmitt Me 163 Komet. Les essais effectués sur cet avion avaient déjà coûté la vie à plusieurs pilotes et elle aussi est grièvement blessée lors d’un accident qui lui vaut cinq mois d’hospitalisation et la mise en place d’un nez artificiel. À la suite de cet essai, elle est décorée pour son engagement de la croix de fer de 1re classe, dont elle a d’ailleurs été l’unique récipiendaire féminine. Dès l’été 1943 elle reprend les commandes du Komet. Elle participe ensuite activement aux essais effectués sur le missile V1, dans sa version de test pilotée.
Dès 1943, face à la situation catastrophique de l’Allemagne nazie, elle tente de mettre sur pied un groupe de pilotes quasi-suicides qui doivent utiliser des Messerschmitt Me 328 fixés sur le dos d’un bombardier Dornier Do 217. Devant l’opposition de plusieurs responsables de la Luftwaffe, le projet est abandonné. Au début du mois de , elle obtient cependant l’aide d’Otto Skorzeny dont la détermination permet de transformer une fusée V1 en version pilotée (projet Reichenberg), le Fi 103R-IV, pouvant accueillir un passager. L’appareil est fixé sous l’aile d’un bombardier Heinkel He 111 et largué à 1 000 mètres d’altitude. Les deux premiers pilotes d’essais s’écrasent et sont grièvement blessés. Hanna s’envole pour le troisième essai et réussit à poser le V1 sans problème. Elle avait détecté que le système gyroscopique d’autoguidage était défectueux.
Le , elle rejoint Berlin, totalement encerclée par les troupes russes, en compagnie de son amant Generaloberst von Greim à bord d’un petit monomoteur biplace Fieseler Fi 156 Storch. Greim à l’avant est atteint au pied par un tir russe et s’évanouit aux commandes, Hanna est assise derrière lui. Elle parvient cependant à poser l’avion près de la porte de Brandebourg en pilotant par-dessus l’épaule du général. Greim est nommé Generalfeldmarschall et successeur de Göring à la tête de la Luftwaffe par Hitler. Reitsch veut persuader Hitler de se faire évacuer par elle en utilisant la voie des airs, mais celui-ci refuse et lui remet une capsule de cyanure afin qu’elle puisse se suicider pour le cas où elle ne parviendrait pas à quitter la capitale encerclée. Reitsch parvient avec peine à quitter Berlin, mais elle est capturée par les Américains en qui la gardent en détention pendant 18 mois, en tant que prisonnière de guerre.
Après la Seconde Guerre mondiale, les citoyens allemands n’ont plus le droit de voler, hormis sur des planeurs, ce « après quelques années ».
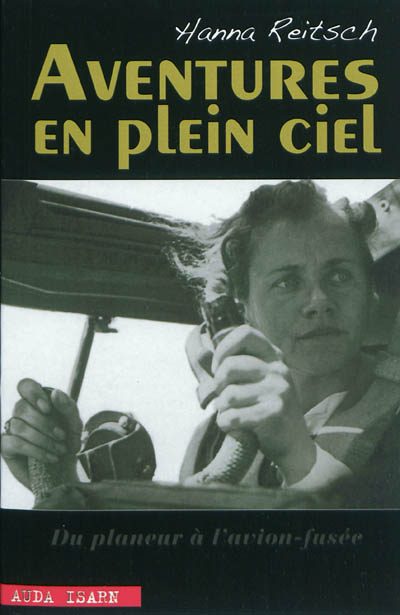 En 1948, elle rencontre Yvonne Pagniez, une ancienne résistante française et déportée. Les deux femmes nouent une amitié. Yvonne Pagniez traduira par la suite et signera la préface de son ouvrage Aventures en plein ciel.
En 1948, elle rencontre Yvonne Pagniez, une ancienne résistante française et déportée. Les deux femmes nouent une amitié. Yvonne Pagniez traduira par la suite et signera la préface de son ouvrage Aventures en plein ciel.
En 1952, Hanna Reitsch obtient en Espagne une médaille de bronze lors des championnats du monde de vol à voile, alors qu’elle est la seule femme à participer aux épreuves. À partir de 1954, elle travaille à nouveau comme pilote d’essai, cette fois-ci pour le compte de l’institut de recherche en aéronautique allemand (le DVL, Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt), situé à Darmstadt.
En 1959, elle se rend en Inde, sur invitation du Premier ministre Jawaharlal Nehru, pour y constituer un réseau de planeurs performant. En 1961, elle est invitée à la Maison-Blanche par le président Kennedy.
De 1962 à 1966, Reitsch réside au Ghana, où elle crée une école de vol à voile qu’elle dirige ensuite. Dans les années 1970, elle détient encore plusieurs records dans différentes catégories.
Elle vole jusqu’à la fin de sa vie. Elle meurt en 1979 des suites d’une défaillance cardiaque. Elle est enterrée dans la tombe familiale du cimetière communal de Salzbourg.
RECORDS :
- 1932 : record de durée de vol en planeur féminin (5 h 30)
- 1936 : record de distance de vol en planeur féminin (305 km)
- 1937 : premier survol des Alpes en planeur par une femme
- 1938 : première personne à faire voler un hélicoptère dans une salle
- 1939 : record du monde de vol à voile de précision féminin
- 1952 : troisième place lors des championnats du monde de vol à voile en Espagne
- 1955 : championne d’Allemagne en vol à voile
- 1956 : record de distance allemand de vol en planeur féminin (370 km)
- 1957 : record d’altitude allemand de vol en planeur féminin (6 848 m)
- 1960 : 300 km de vol sur un parcours en triangle
- 1970 : record allemand de vol en planeur féminin sur 500 km ainsi que championne d’Allemagne du concours allemand de vol à voile (classe féminine)
- 1971 : vainqueur aux championnats du monde de vol en hélicoptère (classe féminine)
- 1972 : record allemand de vol à voile de vitesse sur 300 km sur un parcours triangulaire
- 1977 : record allemand féminin en vol à voile aller-retour sur 644 km
- 1978 : record du monde féminin en vol à voile
24 août 1980 : mort à 82 ans du pilote et as Jean Pezon.
Jean André Pezon ( à Saint-Pierre-le-Moûtier – à Vallauris) est un militaire et as de l’aviation français de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il remporte dix victoires aériennes homologuées. Il servira la France pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Pezon s’engage pour faire son service militaire comme volontaire, le , alors qu’il n’a que 17 ans. Il est engagé dans différentes unités d’artillerie, jusqu’à ce qu’il soit envoyé suivre une formation de pilote militaire, à Dijon, le . Le , il est envoyé à Étampes. Le , il reçoit le brevet de pilote militaire n° 6485. Le , il est promu au grade de brigadier et envoyé à Avord et à Pau pour y suivre une formation complémentaire.
Pezon s’engage pour faire son service militaire comme volontaire, le , alors qu’il n’a que 17 ans. Il est engagé dans différentes unités d’artillerie, jusqu’à ce qu’il soit envoyé suivre une formation de pilote militaire, à Dijon, le . Le , il est envoyé à Étampes. Le , il reçoit le brevet de pilote militaire n° 6485. Le , il est promu au grade de brigadier et envoyé à Avord et à Pau pour y suivre une formation complémentaire.
Le 1er , Pezon intègre l’Escadrille 90 comme pilote de SPAD. Le , il est promu au grade de maréchal-des-logis. Le , il remporte sa première victoire aérienne en abattant un ballon d’observation allemand, faisant équipe avec Jean-Paul Ambrogi, au-dessus de Juville. Sa coopération avec Ambrogi, Maurice Bizot, Charles Macé, et d’autres pilotes français permet à Pezon de porter son nombre de victoires sur des ballons d’observation à neuf, le . Il remporte également un combat sur un biplace de reconnaissance allemand.
En récompense de ses succès, Pezon est promu adjudant le . Il reçoit la Médaille militaire le , en plus de la Croix de Guerre avec cinq palmes et deux étoiles de bronze.
Jean Pezon, en tant qu’engagé volontaire, va rester quelque temps dans l’armée d’active après l’armistice. Le , ayant été cité à l’ordre de l’armée britannique, il est fait Chevalier de la Légion d’honneur. Le , il est promu au grade de sous-lieutenant. Deux ans plus tard, il sera promu lieutenant.
Il quitte l’armée d’active en 1922 pour s’installer à Conakry en Guinée où il devient directeur d’une plantation.
En 1936, il est fait Officier de la Légion d’honneur, et le , il est promu au grade de capitaine, au sein de la réserve.
Quand survient la Seconde Guerre mondiale, Jean Pezon est mobilisé avec son grade de capitaine de réserve et va se retrouver affecté à Thiès, près de Dakar, où le colonel Georges Pelletier-Doisy, chef de l’aviation de l’Afrique Orientale Française, va lui confier le commandement de l’escadrille coloniale n° 2 sur Potez 25 à bord desquels il va faire des vols de patrouille maritime pour surveiller la présence de sous-marins ennemis. Le , il est envoyé sur ordre en métropole mais se trouve bloqué au Maroc par l’armistice, où il est démobilisé. Il va alors sur place prendre contact avec les premiers cercles gaullistes qu’il va animer en Guinée. Après que l’AOF se soit ralliée aux alliés, il obtient d’être rappelé dans l’armée de l’air en et sert d’abord en AOF comme officier de liaison auprès des armées anglo-américaines, puis au mois de mai passe au Maroc où, promu commandant de réserve, il va servir à un poste administratif en étant nommé commandant adjoint de la base d’Alger en septembre. Au mois de , il est nommé à la tête de la Compagnie de Révision et de Réparation (CRR) n° 86, une petite unité technique qui est envoyée participer à la campagne d’Alsace à partir du .
Démobilisé peu après la fin des combats, il va retourner dans sa plantation en Guinée. Le 1er, il reçoit sa dernière promotion et accède au grade de lieutenant-colonel. Le , il est fait Commandeur de la Légion d’honneur. Il est également Officier de l’ordre du Nichan-Iftikhar tunisien.
Expulsé de Guinée à l’indépendance, il s’installe en France sur la côte d’Azur à Vallauris Golfe Juan (près d’Antibes), où il est décédé le .
24 août 1991 : déclaration d’indépendance de l’Ukraine.
Le texte est adopté au lendemain de la tentative de coup d’État en Union soviétique le , lorsque des dirigeants communistes conservateurs tentent de rétablir le contrôle central du parti communiste sur l’URSS. En réponse, au cours d’une session extraordinaire de 11 heures, le Soviet suprême de la RSS d’Ukraine approuve à une écrasante majorité l’Acte de déclaration adopté avec 321 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions (sur 360 participants). Le texte a été composé en grande partie dans la nuit du 23 au 24 août 1991, principalement par Levko Loukianenko, Serhiy Holovatyi, Mykhailo Horyn, Ivan Zayets et Viatcheslav Tchornovil.
Le Parti communiste d’Ukraine (PCU), persuadé dans les coulisses par Leonid Kravtchouk, membre du Parti et président du Soviet suprême, se sent obligé de soutenir la loi afin de se distancer du coup d’État. Le premier secrétaire du PCU, Stanislav Hourenko, a de même fait valoir que « ce serait un désastre » si le PCU ne parvenait pas à soutenir l’indépendance et les membres du PCU avaient été troublés par la nouvelle de l’arrestation de l’ancien chef du parti Volodymyr Ivachko à Moscou, de la resubordination de l’armée soviétique aux dirigeants de la RSFS de Russie et de la mise sous scellés des locaux du Comité central du Parti communiste.
Le jour même (24 août), le parlement demande un référendum pour approuver cette déclaration d’indépendance, avec l’appui des leaders de l’opposition Ihor Ioukhnovsky et Dmytro Pavlytchko. Le parlement vote également la création d’une garde nationale de l’Ukraine et un nouveau statut pour les forces armées soviétiques situées sur le territoire ukrainien.
Dans les jours qui ont suivi, un certain nombre de résolutions et de décrets sont adoptés : nationalisation des biens du PCU, remis dès lors au Soviet suprême et aux conseils locaux ; amnistie pour tous les prisonniers politiques ; suspension de toutes les activités du PCU et gel de ses actifs et de ses comptes bancaires dans l’attente d’enquêtes officielles sur une éventuelle collaboration avec les putschistes de Moscou ; création d’une commission d’enquête sur les soutiens au coup d’État ; et création d’un comité sur les questions militaires liées à la création d’un ministère de la Défense de l’Ukraine.
Le 26 août 1991, le représentant permanent de la RSS d’Ukraine auprès des Nations unies (la RSS d’Ukraine était l’un des membres fondateurs des Nations unies), Hennadiy Udovenko, informe le bureau du Secrétaire général des Nations unies qu’il est désormais représentant de l’Ukraine. Le même jour, le comité exécutif de Kiev vote également le retrait de tous les monuments des héros communistes des lieux publics, y compris le monument de Lénine sur la place centrale de la Révolution d’Octobre. Le comité décide de même que la place serait rebaptisée Maidan Nezalezhnosti (Place de l’Indépendance) tout comme la station de métro sous cette place.
Lors du référendum sur l’indépendance du 1er, le peuple ukrainien exprime un soutien franc et massif à l’Acte de déclaration d’indépendance, avec plus de 90 % de votes en faveur et une participation de 82 % des électeurs. Le référendum a lieu le même jour que la première élection présidentielle directe en Ukraine ; les six candidats à la présidence soutiennent tous l’indépendance et font campagne pour le « oui ». L’approbation du référendum met fin à toute chance réaliste d’un maintien de l’Union soviétique, même à une échelle limitée car l’Ukraine était le deuxième État membre de l’URSS le plus puissant, économiquement et politiquement.
Une semaine après les élections, le président nouvellement élu Leonid Kravtchouk se joint à ses homologues russe et biélorusse Boris Eltsine et Stanislaw Chouchkievitch pour signer, le , les accords de Minsk, qui actent la fin de l’Union soviétique. L’Union soviétique est officiellement dissoute le 26 décembre 1991.
Depuis 1992, le 24 août est célébré en Ukraine comme le Jour de l’Indépendance.
La Pologne et le Canada sont les premiers pays à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine, tous deux le 2 décembre 1991. Le même jour, l’émission de fin de soirée du journal télévisé Vesti annonce que Boris Eltsine a reconnu l’indépendance de l’Ukraine.
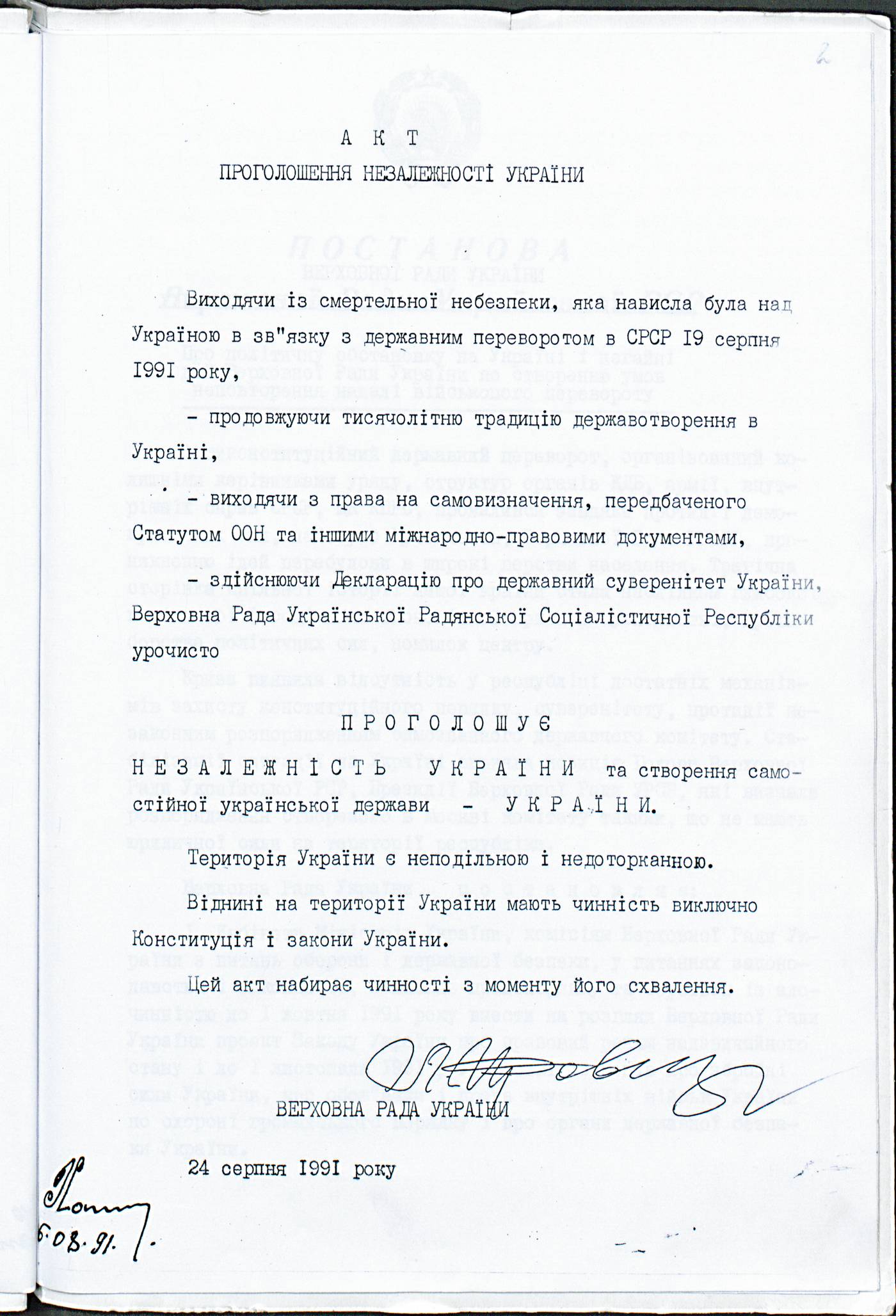
24 août 1991 : Mikhaïl Gorbatchev démissionne de ses fonctions de secrétaire général du PCUS.
En , Gorbatchev entreprend une réforme constitutionnelle : il crée un poste de Président de l’URSS et diminue le rôle dirigeant du chef du Parti communiste de l’Union soviétique. Le , le Congrès des députés du peuple élit Gorbatchev pour un mandat de cinq ans. L’élection suivante (1995) était prévue au suffrage universel. Pourtant, le 1er de la même année, il est hué par certains de ses concitoyens. En effet, il est très impopulaire aux yeux des conservateurs du Parti qui le considèrent comme le fossoyeur du régime soviétique.
Les événements qui ont suivi, tels que la proclamation de souveraineté de la Russie au cours du 1er Congrès des députés du peuple de la république socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) le et l’élection à la présidence de la RSFSR de Boris Eltsine (élu dès le 1er tour au suffrage universel direct), un an plus tard, diminuent le pouvoir de Gorbatchev et la souveraineté de l’URSS. Le , un référendum portant sur la question du maintien de l’Union soviétique donne 76 % de réponses favorables au maintien. Il n’en sera pas tenu compte.
Le , parti en vacances dans sa villa de Foros en Crimée, il est un temps écarté du pouvoir par un quarteron d’apparatchiks du Parti communiste soviétique qui l’enferment dans sa résidence d’été. La date de ce putsch de Moscou ne fut pas choisie au hasard, car c’est le que Gorbatchev devait signer un traité instaurant une nouvelle Union, appelée Union des républiques souveraines soviétiques (puis Union des républiques souveraines), réduisant notamment le rôle du KGB et de l’État centralisé, qui avaient tout à y perdre, au profit des républiques. Le soutien d’Helmut Kohl s’avère insuffisant alors que le président François Mitterrand déclare vouloir attendre les intentions des « nouveaux dirigeants » soviétiques, reconnaissant de facto le gouvernement issu du putsch et n’hésitant pas alors à lire en direct à la télévision une lettre envoyée par Guennadi Ianaïev, l’auteur du coup d’État. Finalement, le putsch échoue et Boris Eltsine, alors président de la RSFSR, devient le grand bénéficiaire de cet échec après avoir reçu dès les premières heures le soutien du président américain George H. W. Bush et du Premier ministre britannique John Major. Gorbatchev quitte la direction du Parti communiste de l’Union soviétique le et les activités du Parti communiste de Russie — le plus important d’URSS — sont suspendues par décret du président russe Eltsine le lors d’une séance du Soviet suprême. Le parti est purement dissous le .
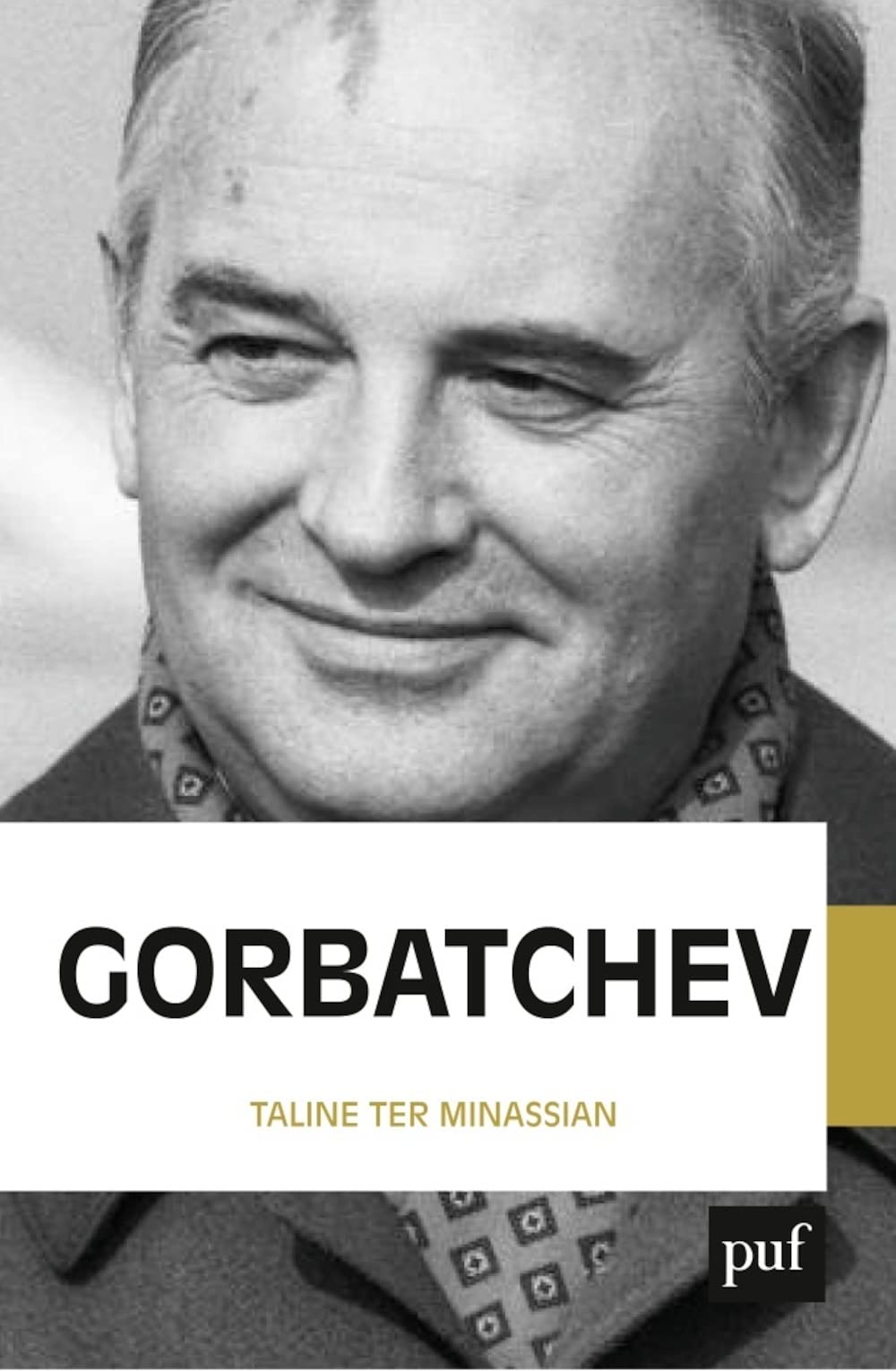
24 août 2014 : prise de la base aérienne de Tagba (Syrie) par les terroristes de l’État islamique.
Durant la guerre civile syrienne, la base aérienne de Tabqa est prise par l’État islamique le , après une bataille de six jours. Environ 160 à 200 soldats du régime syrien sont faits prisonniers et exécutés les 27 et .
Le , l’armée syrienne, appuyée par l’aviation russe, déclenche une offensive en pénétrant dans le gouvernorat de Raqqa pour tenter de reprendre la ville par le sud. Le , l’armée régulière n’est plus qu’à 24 km du lac el-Assad et à 30 km de l’aéroport de la ville. Mais les djihadistes contre-attaquent le et repoussent l’offensive.
La nuit du 21 au , des soldats américains et près de 500 membres des FDS sont héliportés au sud du lac el-Assad, dans une zone située à 15 kilomètres à l’ouest de la ville, coupant ainsi la route reliant Alep à Raqqa en prenant le contrôle de plusieurs localités situées sur cet axe. Ces forces attaquent ensuite au barrage de Tabqa par le sud, tandis que le reste de FDS lance l’assaut par le nord. Les Américains appuient l’offensive avec des hélicoptères et de l’artillerie. Le , elles prennent le contrôle de l’aéroport de Tabqa situé à 10 km au sud de la ville. Le , les FDS encerclent Tabqa par l’est en coupant la dernière route y menant et s’emparent du village de Safsafah, situé à six kilomètres. Tabqa et son barrage sont entièrement conquis par les FDS le .







