5 juillet 1044 : bataille de Ménfő.
La bataille de Ménfő fut une importante bataille de l’histoire primitive du royaume de Hongrie. Elle se déroula le à Ménfő, près de Győr, et opposa une armée du Saint-Empire conduite par Henri III, roi des Romains, et les forces hongroises (Magyars) conduite par le roi Samuel Aba. Le combat se solda par une victoire du souverain germanique et ainsi de l’influence occidentale en Hongrie.
Trois ans plus tôt, Pierre Orseolo, le deuxième roi de Hongrie succédant à son oncle Étienne Ier, avait été déposé par Samuel Aba à la suite d’un fort mécontentement provoqué par le favoritisme de Pierre envers les étrangers, en particulier les Allemands et les Italiens. Pierre avait d’abord trouvé refuge en Autriche, recherchant la protection de son beau-frère, le margrave Adalbert. Il s’est également présenté à la cour du roi Henri III afin d’obtenir de l’aide contre Samuel Aba.
Répondant à une attaque de Samuel sur l’Autriche et la Carinthie, Henri III lança une première expédition contre la Hongrie début 1042. Il retourna pour rétablir Pierre au début de l’été 1044 et fut rejoint durant son avancée par de nombreux seigneurs hongrois. Ce fut alors que se déroula la bataille de Ménfő. Les forces de Henri étaient inférieures en nombre aux forces hongroises. Toutefois, il y eut beaucoup de désaffection dans les rangs magyars et l’armée de Samuel Aba se désagrégea rapidement face à la cavalerie impériale. La bataille se termina par la défaite des forces hongroises. Bien que Samuel ait réussi à s’échapper du champ de bataille, les partisans de Pierre le capturèrent et le tuèrent peu après. Le soir de ce jour, Henri III, en habit de pénitent, rend grâce à Dieu pour sa victoire.
Pierre fut restauré roi à Székesfehérvár et accepta de rendre hommage à Henri III. Les magnats et nobles hongrois firent de même et la Hongrie devint ainsi vassale du Saint-Empire. Cette suzeraineté prit cependant fin deux ans plus tard lorsque Pierre fut à nouveau renversé par la révolte païenne de Vata.
![]()
5 juillet 1194 : bataille de Fréteval entre le roi anglo-« angevin » Richard 1er dit « Cœur de Lion » et le roi français Philippe II dit « Auguste ».
La bataille de Fréteval est un affrontement survenu le 5 juillet 1194 près du château de Fréteval en Loir-et-Cher, durant lequel les troupes anglo-normandes et angevines de Richard Cœur de Lion tendirent une embuscade à l’armée française commandée par Philippe Auguste. La bataille se solde par une déroute de l’armée française. Ayant perdu une bonne partie de son trésor au cours de sa fuite, Philippe Auguste décide de conserver ses archives en lieu sûr à Paris, d’où la création du Trésor des Chartes.
Alors que Richard Cœur de Lion est emprisonné en Allemagne, Philippe Auguste en profite pour s’attaquer aux possessions territoriales des Plantagenêt au nord de la France. Voyant une occasion de s’affirmer en l’absence de son frère, Jean sans Terre lui propose une trêve. Par un traité signé en janvier 1194, Jean cède à Philippe Auguste le sud-est de la Normandie (le Vexin normand), Le Vaudreuil, Verneuil et Évreux.
Richard est finalement libéré le 2 février 1194 grâce au soutien de sa mère, Aliénor d’Aquitaine, qui paye les deux tiers de la rançon demandée, le reste devant être versé plus tard. Après un court passage en Angleterre, Richard débarque à Barfleur le 13 mai 1194. Décidé à reconquérir ses terres, il part immédiatement en campagne. À la fin du mois de mai, il pousse Philippe Auguste à lever le siège de Verneuil-sur-Avre, puis marche sur l’Anjou. Son but est de reprendre le contrôle des forteresses qui ont fait l’objet du traité signé en janvier entre Philippe et Jean sans Terre, ou d’en empêcher la conquête par les Français, tous les gouverneurs n’ayant pas accepté les clauses du traité. Le 13 juin, il prend Loches. Pendant que Philippe continue sa route vers le sud, Richard renforce les garnisons de Châtillon, Buzençon et Amboise. Il en profite également pour consolider les fortifications de Loches. À la fin du mois de juin, Philippe prend la citadelle de Fréteval puis assiège celle de Vendôme. Au même moment, Richard installe son camp dans la plaine de Courtiras, à une lieue de la place de Vendôme. Il envoie un message au roi de France pour l’informer qu’il l’attend pour livrer bataille. Après avoir consulté ses conseillers, Philippe choisit de ne pas affronter Richard directement. Il décide de se replier sur Fréteval, en profitant de l’obscurité de la nuit. Richard le poursuit jusqu’à la plaine de Lignières.
Emportant avec lui des fantassins légers, des archers et des arbalétriers, Richard remonte la rive droite du Loir. Vêtus légèrement, ses hommes sont plus rapides que l’armée française qui remonte la rivière sur la rive gauche en direction de Fréteval. Par ailleurs, l’armée française est ralentie par la file de chariots qui contient les archives du roi. En effet, la monarchie française est alors itinérante, les archives servant à prouver les droits du roi de France au cours de sa campagne4. Les gués et zones marécageuses entravent également la progression de l’armée. Certains chariots s’embourbent, obligeant les Français à s’employer pour les dégager. Face à ces contre-temps, l’avant-garde française ralentit pour attendre l’arrière-garde.
Pendant ce temps, Richard franchit le Loir afin de se placer du même côté que les Français puis il déploie sa cavalerie dans la forêt au-dessus de la plaine de Lignières. Les archers et arbalétriers anglo-normands sont cachés dans les marécages.
Tandis que Philippe est parti prendre un court repos au village de Beaufour, l’armée française débouche dans la plaine de Lignières. Vers 7 h du matin, alors que l’avant-garde approche de la sortie de la plaine, Richard passe à l’attaque. Guillaume Le Breton, qui fut le chapelain et biographe de Philippe Auguste, raconte la scène : « Entre Fréteval et le château de Blois, est un lieu peu célèbre nommé Beaufour, perdu en quelque sorte au milieu des bois, et enfoncé dans de noires vallées. Le roi était par hasard en ce lieu avec ses barons ; et vers le milieu de la matinée, il prenait son repas, tandis que les troupes cheminaient avec les chariots et les chevaux chargés d’armes, de vases et de toutes les autres choses nécessaires pour l’usage d’un camp. Tout à coup, le roi des Anglais s’élance du sein de sa retraite, et disperse facilement ce peuple désarmé et tout chargé de vivres et d’effets : il tue, emmène, enlève les chariots, les bagages, les chevaux, les corbeilles et les vases des cuisines et des tables, vases que l’or et l’argent rendaient éclatants et plus précieux que tous les autres. »
Décontenancés et attaqués de toute part, les Français tentent de riposter et font charger les chevaliers, mais ceux-ci doivent se replier face à la contre-attaque de la cavalerie anglo-normande. Les hommes sont massacrés et les chariots pillés. « Le même roi s’empara des bagages du roi avec l’argent et les différents meubles […] Le ravisseur n’épargna pas davantage les petits tonneaux tout remplis d’écus, pas plus que les sacs qui renfermaient les ornements, les registres des impôts et effets. »
Alors que Richard Cœur de Lion détruit les archives que Philippe Auguste a abandonnées, celui-ci parvient à s’enfuir par le bois de l’Épau.
Marqué par la perte de son trésor, de ses sceaux et de ses chartes, Philippe Auguste décide que ses archives et documents juridiques seront désormais gardés en lieu sûr à Paris. Il crée la fonction de Garde des Sceaux et les Archives nationales. Il charge également son conseiller Guérin6 de créer le Trésor des Chartes. Établi au Louvre puis à la Sainte-Chapelle, celui-ci constituera le fondement des futures archives du Royaume.
Après cette bataille, Richard finalise la reconquête de la Normandie. Après une première trêve qui n’est pas respectée, la guerre continue et se déplace dans le Berry. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion signent finalement un traité de paix à Gaillon le 15 janvier 1196 : Richard cède Gisors et le Vexin normand à Philippe, qui lui abandonne les différentes conquêtes qu’il a faites en Normandie et ses prétentions sur le Berry et l’Auvergne de Guy II.
5 juillet 1594 : début au Sri Lanka de la campagne de Danture des Portugais contre le Royaume de Kandy.
La campagne de Danture est une série d’affrontements entre les Portugais et le royaume de Kandy en 1594, lors de la guerre cinghalo-portugaise. Elle est considérée comme un tournant de la résistance indigène à l’expansion portugaise. Pour la première fois au Sri Lanka, une armée portugaise a été complètement anéantie, alors qu’elle était sur le point de conquérir la totalité de l’île. Forte de 20 000 hommes commandés par le gouverneur Pedro Lopes de Sousa, elle a envahi Kandy le 5 juillet 1594. Après trois mois, sévèrement diminuée par la guérilla et des désertions massives, ce qui restait de l’armée portugaise a été écrasé à Danture par les Kandyens du roi Vimaladharmasuriya 1er.
Cette victoire a fait du royaume de Kandy une puissance militaire majeure : il a réussi à rester indépendant jusqu’en 1815, malgré les attaques successives des colonisateurs portugais, néerlandais et britanniques.
Les tactiques employées lors de cette campagne ont servi de modèle aux Kandyens pour leurs succès futurs contre les trois puissances européennes ayant tenté de conquérir l’île. Ils ont saisi une grosse quantité d’armes portugaises et le trésor de Jayavira, ce qui a renforcé à la fois leur arsenal et leurs finances.
C’était la première fois qu’une armée portugaise était complètement détruite au Sri Lanka. Les Portugais étaient décidés à se venger et en 1602, après des années de préparation, une autre armée allait tenter d’envahir Kandy, sous Dom Jerónimo de Azevedo. Mais elle serait vaincue à Balana, conduisant à une retraite désespérée connue sous le nom de Famosa Retirada.

5 juillet 1770 : bataille navale de Tchesmé entre les flottes de la Russie de Catherine II et de l’Empire ottoman.
La bataille de Tchesmé est un affrontement entre les flottes de la Russie de Catherine II et de l’Empire ottoman lors de la guerre russo-turque de 1768-1774. Elle se déroula lors de l’épisode dit de la révolution d’Orloff dans le chenal entre l’île de Chios et la ville d’Asie mineure de Tchesmé.
La flotte ottomane avait évité la flotte russe tout le printemps 1770. Le capoudan-pacha espérait que la contre-attaque terrestre affamerait les troupes russes qui privées de ressources et de vivres seraient vaincues sans combat. Après avoir mouillé à Nauplie, la flotte s’était réfugiée à Chios. Rejointe par la flotte russe, elle ne put refuser plus longtemps l’affrontement.
Le capoudan-pacha plaça sa flotte en croissant le long du rivage et gagna la terre ferme. Il laissa le navire amiral, la Capoudana à son second Hassan-Bey.
Au bout de quatre heures de combat, la capoudana était abordée par le navire amiral russe. Le combat se déroula au corps à corps jusqu’à ce que la capoudana explosât, faisant couler en même temps les deux navires. Les navires ottomans survivants se réfugièrent dans la baie de Tchesmé. Ils y furent coulés par des brûlots. Un seul vaisseau turc ne fut pas coulé : il fut pris par les Russes.
C’est la plus grande défaite subie par l’empire ottoman depuis la bataille de Lépante. La marine russe est désormais maîtresse de la mer Égée, où elle reste pendant cinq ans. Cette victoire russe, le même jour que celle de Larga et deux semaines avant celle de Kagul, met Catherine II en position de force pour les négociations de paix mettant fin à la guerre russo-turque.


5 juillet 1793 (calendrier grégorien) : naissance de l’officier russe décembriste Pavel Ivanovitch Pestel.
Comme plus d’une vingtaine de décembristes, Pavel Pestel est issu d’une famille noble d’origine germanique. Il reçoit une éducation soignée et fait partie de cette catégorie de jeunes officiers russes auxquels les campagnes contre Napoléon 1er révèlent le retard des conditions sociales et politiques dans l’Empire russe.
À partir de 1816, il est à la tête d’une des premières sociétés secrètes russes, la Société du Sud qui, avec la Société du Nord de Nikita Mouraviov et Ryleïev, centrée à Saint-Pétersbourg, agite des projets de révolution, de république, d’émancipation paysanne. À la mort d’Alexandre 1er en 1825, ces sociétés profitent de la situation incertaine créée par la renonciation au trône du duc Constantin, qui entraîne l’avènement de Nicolas 1er, pour entreprendre un soulèvement contre le régime autocratique. Tous les décembristes sont d’accord sur un même but, qui est d’instituer un système plus représentatif et de supprimer le servage.
Mais tandis que la Société du Nord, plus modérée sous l’influence de Nikita Mouraviov et du prince Serge Troubetzkoï, défend une monarchie constitutionnelle fédérative avec un droit de vote limité, la Société du Sud, plus radicale, réclame une république unitaire, centraliste, égalitaire et une profonde réforme agraire avec la distribution gratuite des terres aux paysans. Les bases de ces réclamations se trouvent dans sa thèse politique, la Vérité russe (Rouskaïa Pravda, 1822), élaborée par Pestel.
Le , Pavel Pestel est arrêté à Toultchyn. Il est pendu, en même temps que quatre autres décabristes, à la forteresse Pierre-et-Paul quelques mois plus tard.

5 juillet 1801 : naissance de David Farragut, premier amiral de la flotte américaine.
 David Glasgow Farragut est né le 5 juillet 1801 à Campbell Station (l’actuelle ville de Farragut), près de Knoxville (Tennessee). Fils de Jordi Ferragut, né le 28 septembre 1755 à Ciutadella sur l’île de Minorque, mort le 4 juin 1817 à Pascagoula États-Unis, marin espagnol immigré aux États-Unis en 1776. Son père servira la marine de son nouveau pays et c’est tout naturellement que le jeune Farragut suivra les pas de son père.
David Glasgow Farragut est né le 5 juillet 1801 à Campbell Station (l’actuelle ville de Farragut), près de Knoxville (Tennessee). Fils de Jordi Ferragut, né le 28 septembre 1755 à Ciutadella sur l’île de Minorque, mort le 4 juin 1817 à Pascagoula États-Unis, marin espagnol immigré aux États-Unis en 1776. Son père servira la marine de son nouveau pays et c’est tout naturellement que le jeune Farragut suivra les pas de son père.
L’un des amis de sa famille était David Porter, officier de renom de l’US Navy. On raconte que Porter avait été sauvé d’un naufrage par Jordi. Quoi qu’il en soit, David Porter offrit de prendre soin de l’éducation de James et d’en faire un officier de marine. Ce que l’enfant dû apprécier puisqu’il décida de porter désormais le prénom de David.
À 8 ans, il se retrouve mousse ; à 9 ans, appointé comme midshipman. À 11 ans, il assiste à son premier combat et à 12 ans reçoit son premier commandement, celui d’une prise faite par l’Essex, qu’il ramène à bon port.
Son parcours est classique jusqu’au début de la guerre de Sécession.
Bien que né dans le Tennessee, élevé en Louisiane, vivant en Virginie (trois États qui font sécession), il reste fidèle à l’Union. En janvier 1862, il reçoit les étoiles de contre-amiral2 et prend le commandement de l’escadre du blocus de l’Ouest du golfe du Mexique (West Gulf Blockade squadron).
En avril 1862, il force le passage et s’empare de La Nouvelle-Orléans, privant la Confédération du débouché du Mississippi.
En juin 1862, il est au siège de Vicksburg mais sans grand succès, ses navires n’étant que de peu d’utilité.
En 1864, il reçoit la mission de s’emparer de Mobile. Il s’empare des accès de la baie de Mobile le 5 août 1864. Mais la ville sera prise plus tard, par l’Armée de terre. Il sera nommé vice-amiral à la suite de cette bataille.
En 1866, le Congrès des États-Unis lui accorde le grade d’amiral qu’il est le premier à obtenir.
En 1867-1868, il commande l’escadre d’Europe (« European squadron »).
En 1868, il est pressenti pour se présenter comme candidat à la présidence, mais décline la proposition.
Il meurt le 14 août 1870, à l’âge de 69 ans, à Portsmouth, (New Hampshire). Le convoi funéraire est conduit par le président Ulysses S. Grant et suivi, entre autres, par 10 000 marins et soldats.
On se souvient de lui dans la culture populaire pour son ordre donné lors de la bataille de Mobile : « Au diable les torpilles, en avant toute ! »
5 juillet 1802 : naissance de l’amiral russe Pavel Stepanovitch Nakhimov.
Il est un des amiraux les plus célèbres de l’histoire navale russe. Il est connu pour avoir commandé les forces navales et terrestres lors du siège de Sébastopol, pendant la guerre de Crimée.
 Né dans le village de Gorodok, aujourd’hui dans le raïon de Viazma de l’oblast de Smolensk, il est le fils d’un major de l’armée russe à la retraite. Nakhimov entra à l’Académie navale pour la noblesse (Morskoï Dvoriansky Korpous) à Saint-Pétersbourg en 1815. Il sortit en mer pour la première fois en 1817, à bord de la frégate Phénix, au large des côtes suédoises et danoises. Peu après il fut promu au rang d’officier sans-brevet. En février 1818, il passa des examens pour devenir aspirant et fut immédiatement intégré dans la Seconde Flotte (Flotskiy Ekipaj) de la Flotte de la Baltique de la marine impériale russe.
Né dans le village de Gorodok, aujourd’hui dans le raïon de Viazma de l’oblast de Smolensk, il est le fils d’un major de l’armée russe à la retraite. Nakhimov entra à l’Académie navale pour la noblesse (Morskoï Dvoriansky Korpous) à Saint-Pétersbourg en 1815. Il sortit en mer pour la première fois en 1817, à bord de la frégate Phénix, au large des côtes suédoises et danoises. Peu après il fut promu au rang d’officier sans-brevet. En février 1818, il passa des examens pour devenir aspirant et fut immédiatement intégré dans la Seconde Flotte (Flotskiy Ekipaj) de la Flotte de la Baltique de la marine impériale russe.
Au début de sa carrière navale, l’expérience de Nakhimov était limitée aux sorties qu’il avait effectuées dans la mer Baltique et à un voyage plus long depuis le port d’Arkhangelsk sur la mer Blanche jusqu’à la base navale de Kronstadt, près de Saint-Pétersbourg. Il eut la chance, en mars 1822, d’être assigné à la frégate Croiseur, vaisseau qui se lançait dans un voyage autour du monde, commandé par l’explorateur Mikhaïl Lazarev qui avait déjà entrepris des voyages similaires.
Durant ce voyage de trois ans, Nakhimov fut promu au rang de lieutenant. À la fin de cette aventure, il reçut sa première médaille, l’Ordre de Saint-Vladimir de IVe classe. Il fut ensuite assigné au navire de guerre de 74-canons, l’Azov, qui fit son voyage inaugural d’Arkhangelsk à Kronstadt à l’automne 1826.
À l’été 1827, l’Azov appareilla pour la Méditerranée en tant que vaisseau amiral de l’escadre russe, commandée par le contre-amiral Geiden pour une expédition conjointe avec les marines française et britannique contre les Ottomans. Juste avant le départ, l’Azov fut visité par le Tsar Nicolas 1er, qui ordonna, en cas d’hostilités, de combattre « comme les Russes font ».
L’Azov, sous les ordres du capitaine de premier rang M.P. Lazarev, se distingua en 1827 à la bataille de Navarin, lors de laquelle la flotte alliée détruisit la flotte Ottomane. Pour son rôle exemplaire lors de la bataille, Nakhimov fut promu à la capitainerie d’un navire capturé1 et décoré par les gouvernements alliés.
Pendant la guerre de Crimée, Nakhimov se distingua à nouveau par la destruction de la flotte ottomane à la bataille de Sinop, en 1853. Il eut son heure de gloire pendant le siège de Sébastopol, lorsque lui et l’amiral Vladimir Kornilov organisèrent depuis le début la défense de la ville et de son port qui était la base de la Flotte de la mer Noire russe. En tant que commandant du port et gouverneur militaire de la ville, Nakhimov était de facto à la tête des forces de défense de Sébastopol. Le 28 juin 1855, alors qu’il inspectait les positions avancées à Malakoff il fut mortellement blessé par un tireur embusqué.
Nakhimov fut enterré dans la cathédrale Saint-Vladimir de Sébastopol aux côtés de Mikhaïl Lazarev, Vladimir Kornilov et Vladimir Istomine. Aujourd’hui encore, on peut admirer un monument érigé en leur mémoire.
5 juillet 1809 : début de la bataille de Wagram entre Napoléon 1er et archiduc Charles.
La bataille de Wagram est une bataille de la guerre de la Cinquième Coalition, qui fut décisive pour son issue. Elle a eu lieu du 5 au dans les plaines Marchfeld, sur la rive nord du Danube, la principale zone de combats se localisant aux environs du village de Deutsch-Wagram, à 10 km au nord-est de Vienne. Les deux jours de lutte ont vu s’imposer l’armée impériale française, sous le commandement de Napoléon 1er face à l’armée impériale autrichienne commandée par l’archiduc Charles d’Autriche-Teschen.
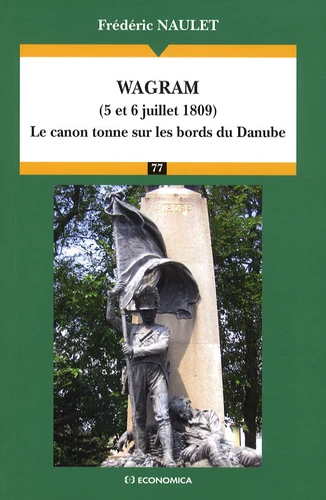 La bataille de Wagram fut la plus meurtrière des batailles qui avaient eu lieu jusqu’alors, et ne sera égalée ou dépassée que par les batailles de la Moskova et Leipzig. Après le combat, épuisées et ayant subi de très lourdes pertes, les forces françaises ne peuvent poursuivre leur ennemi. Quant aux Autrichiens, leur situation, déjà très difficile avant le combat, devient désespérée après la défaite.
La bataille de Wagram fut la plus meurtrière des batailles qui avaient eu lieu jusqu’alors, et ne sera égalée ou dépassée que par les batailles de la Moskova et Leipzig. Après le combat, épuisées et ayant subi de très lourdes pertes, les forces françaises ne peuvent poursuivre leur ennemi. Quant aux Autrichiens, leur situation, déjà très difficile avant le combat, devient désespérée après la défaite.
Wagram fut la première bataille à l’issue de laquelle Napoléon échoua à obtenir une victoire décisive sans éprouver beaucoup de pertes. En effet, les Français perdirent près de 34 000 hommes à Wagram, auxquels se rajoutent les 20 000 perdus à Aspern-Essling. Contrairement à la campagne de 1807 où la victoire difficile et marginale d’Eylau avait été suivie d’un succès écrasant à Friedland, la campagne de 1809 s’est finalement achevée par une victoire coûteuse en hommes et peu convaincante.
Ceci pourrait être interprété comme étant la manifestation du déclin progressif de la qualité des troupes napoléoniennes, et de l’amélioration de celles de ses adversaires, qui ont désormais compris leurs erreurs passées et ont globalement appréhendé les stratégies de Napoléon. Ces lourdes pertes, qui incluaient des troupes expérimentées et une trentaine de généraux dont Lasalle et Lannes à Aspern-Essling, ne purent être compensées par la suite. La mise à l’écart du commandement de Bernadotte, conséquence de son échec à la bataille de Wagram, entraîna des conséquences inattendues : élu à la surprise générale héritier au trône de Suède l’année suivante, l’ancien maréchal s’avérera être par la suite un soutien décisif pour les Alliés.
Selon I. Castle, les pertes autrichiennes sont de 41 250 hommes, dont 23 750 tués ou blessés, 10 000 disparus et 7 500 capturés, alors que les pertes françaises se chiffrent à 37 500 hommes, dont 27 500 tués ou blessés et 10 000 disparus ou capturés. Quatre généraux autrichiens furent tués ou mortellement blessés : Armand von Nordmann, Josef Philipp Vukassovich, Peter von Vécsey et Konstantin Ghilian Karl d’Aspré.
—
Les artilleurs, à l’école d’application de l’artillerie de Draguignan, fêtent chaque année cette victoire depuis 1996.

5 juillet 1814 : bataille de Chippewa (guerre anglo-américaine).
La bataille de Chippewa est une bataille de la guerre anglo-américaine de 1812 qui eut lieu le dans le cadre de la campagne du Niagara. Elle se conclut par une victoire de l’armée américaine sur les troupes britanniques.
La campagne du Niagara était la campagne finale lancée par les États-Unis pour envahir le Canada pendant la guerre anglo-américaine de 1812.
Sous le commandement du général Jacob Jennings Brown et du général Winfield Scott, les forces américaines commencèrent la campagne par la capture du Fort Érié sur la péninsule du Niagara. La bataille de Chippewa fut une victoire décisive pour les Américains.
À la bataille de Lundy’s Lane, les deux côtés réclamèrent la victoire, mais les forces américaines avaient eu tellement de blessés qu’elles se retirèrent à Fort Érié. Après quoi, les Britanniques sous le commandement de Gordon Drummond essayèrent de capturer le Fort. Ils l’assiégèrent. Les Américains tinrent bon et les Britanniques levèrent le siège après avoir subi de lourdes pertes. Après la bataille de Cook’s Mills, les forces américaines commandé par le général George Izard abandonnèrent Fort Érié et retournèrent sur la rive des États-Unis.
Batailles de la campagne :
- Bataille de Queenston Heights :
- Bataille de Frenchman’s Creek :
- Bataille de Fort George : 25-
- Bataille de Stoney Creek :
- Bataille de Beaver Dams :
- Bataille de Fort Niagara :
- Bataille de Buffalo :
- Raid sur Port Dover : –
- Capture de Fort Érié :
- Bataille de Chippewa :
- Bataille de Lundy’s Lane :
- Siège de Fort Érié : 4 août-
- Bataille de Cook’s Mills :

5 juillet 1830 : prise d’Alger.
La flotte française entreprend de bombarder la ville d’Alger en soutien des troupes débarquées, le 1er juillet, et à nouveau le 3 juillet. La flotte échange avec les batteries côtières de vives canonnades, mais à peu près hors de portée. Quelques jours plus tard, le général Valazé, commandant le génie, qui visitait les forts, ironisait, disant « qu’il se chargeait de réparer, pour 7 francs 50 centimes, toutes les avaries causées par la marine aux fortifications ».

Le 29 juin, les troupes françaises arrivent en vue du fort l’Empereur, une forteresse ottomane qui couvre Alger au sud.
Le creusement des tranchées pour le siège du fort est commencé dès le 30, et le 3 juillet dans la journée, toutes les batteries de l’artillerie de siège sont mises en place.
Le 4 juillet vers 4 h du matin, le général de La Hitte, commandant l’artillerie, donne l’ordre d’ouvrir le feu à toutes les batteries la fois ; la riposte turque dure aussi vivement que l’attaque pendant 4 heures, mais à 10 h, les feux du château s’éteignent, tous ses merlons détruits n’offrant plus d’abri aux canonniers, presque toutes les pièces étant démontées, l’intérieur dévasté par les bombes et les obus.
Au moment où l’ordre est donné de battre la forteresse en brèche, une énorme explosion pulvérise la grosse tour au centre du fort de l’Empereur : les Turcs, abandonnant le fort, avaient mis le feu aux poudres.
Devant la kasbah, les troupes françaises découvrent une pyramide de têtes de soldats coupées, conformément aux instructions du dey qui payait une somme à qui en rapportait une.
Les Français s’emparent du fort et tiennent désormais à leur merci la kasbah et la ville d’Alger.
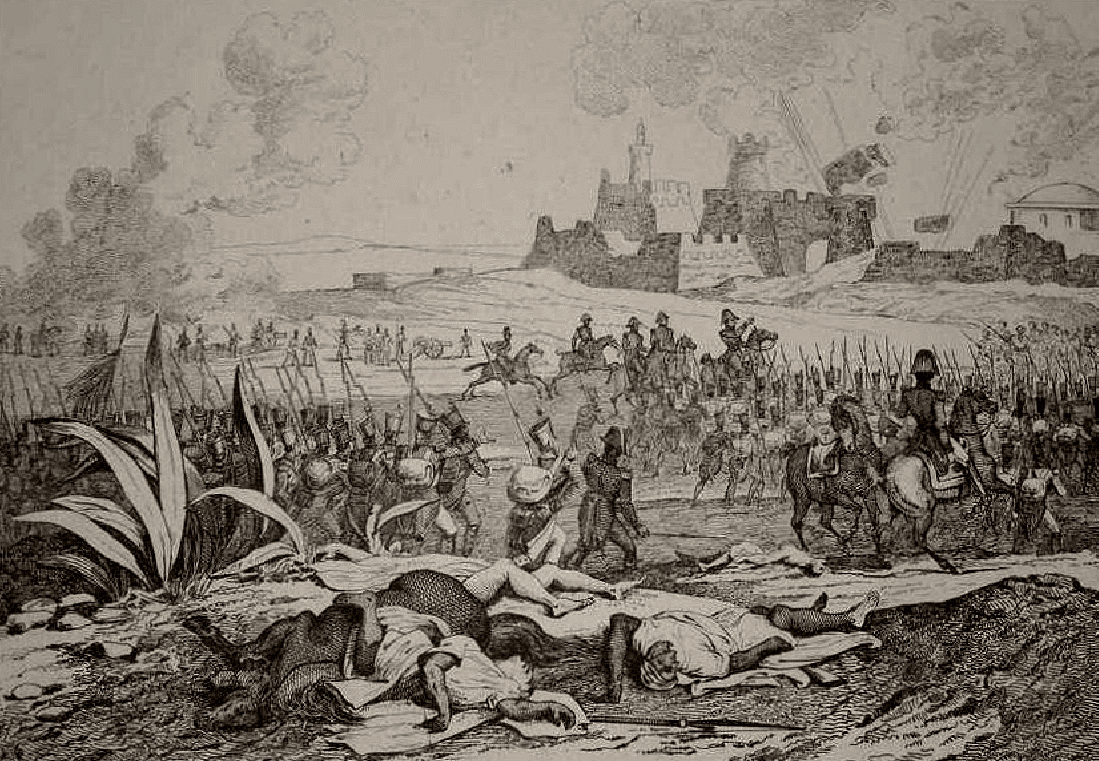
Le 4 juillet 1830, la bataille de Staoueli suivie de la prise du fort de l’Empereur livrait à une armée française, Alger, l’antique métropole des pirates barbaresques.
Si la première pensée avait été uniquement d’infliger au dey d’Alger un châtiment sévère, le succès vint en aide à la réflexion pour conseiller de garder, à titre définitif, une conquête dont l’Europe, et surtout l’Angleterre, souhaitait le délaissement.
La résolution prise, on crut que dans un pays à demi organisé comme l’était la régence d’Alger, on trouverait parmi les anciens tributaires du dey une partie des éléments nécessaires pour maintenir l’ordre dans la population indigène, et surtout pour faire rentrer les impôts dont le gouvernement français entendait hériter.
De cette pensée naquirent les zouaves, les successeurs, en quelque sorte, des troupes algériennes.

5 juillet 1833 : bataille du cap Saint-Vincent.
La bataille du cap Saint-Vincent est un combat naval livré au large des côtes portugaises, pendant la guerre civile portugaise (1828-1834). Une escadre libérale, commandée par l’amiral britannique Charles Napier, y défait la flotte du roi Michel 1er.
Depuis 1828, une guerre civile oppose Michel Ier aux libéraux conduits par Pierre Ier. Ceux-ci ont le soutien du Royaume-Uni et donnent à Charles Napier le commandement de leur flotte comprenant des petits navires, dont certains achetés à l’East Indiamen, en février 1833. Napier utilise alors le nom de Carlos Da Ponza pour échapper à l’amende que l’État britannique inflige à ses ressortissants servant dans une armée étrangère. Ce nom rappelle un des exploits de Napier lors des guerres napoléoniennes lorsqu’en 1813, il captura l’île italienne de Ponza. Charles Napier prend le commandement de la flotte libérale alors que les libéraux sont assiégés à Porto. Le tempérament inflexible de l’amiral britannique permet de restaurer l’ordre dans une flotte proche de la mutinerie. Il installe son pavillon sur le navire Rainha de Portugal 46 commandé par le capitaine F.G. MacDonough avec comme chef d’état-major son propre beau-fils, Charles Napier-Elers. Le 20 juin, il appareille de Porto. Sa flotte transporte le duc de Terceira ainsi que la moitié de l’armée de l’Algarve avec pour but d’ouvrir un second front dans le sud du pays d’où les libéraux pourraient marcher sur Lisbonne. Après le débarquement, il croise sur le chemin du retour la flotte de Michel Ier largement supérieure en nombre au large du cap Saint-Vincent le 3 juillet 1833. Après deux jours de manœuvres par temps calme, Charles Napier passe à l’action.
La flotte de Napier est constituée de six navires (trois frégates, une corvette, un brick et une goélette), le tout transportant 176 canons. Il a aussi sous son commandement quelques navires à vapeur dont il espère se servir comme remorqueurs. Espoir déçu par la fuite des navires le 4 juillet. De son côté, la flotte migueliste compte trois vaisseaux de ligne, une frégate, un xebec, trois corvettes et deux brigs, ce qui fait un total de 372 canons. Le 5 juillet à 4 heures du matin, le vent se lève pour se calmer peu après. Napier attaque alors son adversaire tout en ayant à l’esprit l’impossibilité qu’il a de pouvoir soutenir une longue canonnade. Grâce à une habile navigation, il empêche son adversaire de se servir de ses canons et monte à l’abordage, la décision se fera au corps à corps. Durant ce combat, les libéraux capturent trois vaisseaux de ligne, une frégate et une corvette dont les équipages acceptent de se rallier à Marie II. Un autre navire se joint ensuite aux libéraux. Vaincu, le reste de la flotte de Michel se replie sur Lisbonne. Les pertes des forces de Napier se sont élevées à seulement trente morts dont le commandant du Rainho de Portugal ainsi que deux autres capitaines. Les libéraux eurent aussi 60 blessés dont le beau-fils de Charles Napier. Les miguelistes ont eu entre 200 et 300 morts dont le commandant, Manuel António Marreiros. Le 6 juillet, apprenant la victoire, l’empereur Pierre nomme Napier vicomte du cap Saint-Vincent. Peu de temps après, la flotte libérale est ravagée par le choléra. Napier réussit à mettre le reste en sécurité à Lisbonne récemment reconquise par les libéraux. À la suite de la libération du sud du pays après la bataille d’Almada, Napier rend visite à l’amiral Sir William Parker qui le reçoit comme un amiral (au vu de son grade portugais). Bien que les Français insistent pour que Charles Napier soit radié des listes de la Royal Navy, il sera plus tard rétabli dans son grade et avec lui tous les officiers britanniques ayant combattu aux côtés des Portugais. Ce combat est considéré par la marine britannique comme un haut fait d’armes. Pour les Portugais, la bataille du cap Saint-Vincent permet en partie la capture de Lisbonne et donc le renversement de Michel 1er.

5 juillet 1914 : naissance du général Alain de Boissieu, Compagnon de la Libération.
 Alain Henry Paul Marie Joseph de Boissieu-Déan de Luigné naît le à Chartres. Il est le fils d’Henri de Boissieu, assureur-conseil, et de Marguerite Froger de Mauny. Les Déan de Luigné sont une famille de l’Anjou.
Alain Henry Paul Marie Joseph de Boissieu-Déan de Luigné naît le à Chartres. Il est le fils d’Henri de Boissieu, assureur-conseil, et de Marguerite Froger de Mauny. Les Déan de Luigné sont une famille de l’Anjou.
Il étudie au collège Sainte-Croix au Mans puis au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles. Choisissant la carrière militaire, il intègre en 1936 l’École spéciale militaire de Saint-Cyr dans la promotion « Soldat inconnu ». Sorti avec le grade de sous-lieutenant, il choisit l’arme de la cavalerie et poursuit sa formation militaire à l’École d’application de la cavalerie de Saumur. Parallèlement, il obtient trois licences à l’université de Paris.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Alain de Boissieu est en poste au 15e groupe de reconnaissance de la 10e division d’infanterie. Après la drôle de guerre, il est engagé dans la bataille de France et s’illustre à Époye dans la Marne le en arrêtant une attaque ennemie, détruisant trois blindés allemands avec le peloton de canons antichars qu’il commande. Encerclé dans un bois au nord du village, il s’efforce de sauver ses pièces d’artillerie de la capture et, tandis qu’une unité d’infanterie fait diversion, rassemble ses 35 cavaliers et lance une charge au sabre contre les Allemands surveillant les sorties du bois. Malgré quelques pertes, Boissieu parvient à faire sortir les canons et confie le peloton à son adjoint pour qu’il ramène les pièces au quartier-général de la division. Puis il retourne dans le bois pour prendre le commandement des fantassins qui ont couvert la charge des cavaliers et tente de rejoindre le camp de Mourmelon, plus au sud, où se trouve le reste du 15e GRDI. Mais en chemin, à hauteur du Mont Cornillet, il est fait prisonnier lors d’une embuscade allemande le .
Transféré vers l’Allemagne, Alain de Boissieu se trouve en Belgique lorsque le , il prend indirectement connaissance de l’appel du général de Gaulle lancé la veille sur les ondes de la BBC. Décidé à poursuivre le combat, il tente sans succès de s’évader de son train à Mayence. Emprisonné à l’Oflag II-D en Poméranie, il est promu lieutenant en septembre, pendant sa détention. Le , en compagnie des sous-lieutenants Aloys Klein et Jacques Branet, il parvient à fausser compagnie à ses geôliers et à gagner l’URSS. Cependant, celle-ci étant encore liée avec l’Allemagne par le pacte germano-soviétique, les deux hommes sont à nouveau incarcérés lorsqu’ils demandent à partir en Angleterre pour y rejoindre le général de Gaulle.
Lorsqu’Adolf Hitler lance l’opération Barbarossa, entraînant les Soviétiques à s’allier au Royaume-Uni, les prisonniers français sont rassemblés au sud de Moscou et leur liste transmise à la France libre par l’intermédiaire des autorités britanniques. Avec 185 camarades menés par le capitaine Pierre Billotte, Alain de Boissieu parvient jusqu’à Arkhangelsk où il embarque vers l’île de Spitzberg puis vers la Grande-Bretagne. Il débarque à Camberley le et signe immédiatement son engagement dans les forces françaises libres.
Promu capitaine et affecté à l’état-major particulier du général de Gaulle où il remplace un officier blessé, Alain de Boissieu suit ensuite une formation de parachutiste et participe le à l’opération Myrmidon, tentative ratée de débarquement à Bayonne, puis le suivant à l’opération Jubilee sur Dieppe. Envoyé en Afrique en décembre sous les ordres du général Legentilhomme, il sert dans les rangs du Bataillon de marche n° 2 et participe aux ralliement à la France libre de Madagascar puis de Djibouti. Volontaire pour servir dans la Force « L », future 2e DB, commandée par le général Leclerc, il y est muté en alors qu’elle se trouve en Tunisie. D’abord en poste à l’état-major de la Force « L », Boissieu prend ensuite, en , le commandement de l’escadron de protection du général Leclerc avec sous ses ordres Pierre de La Fouchardière.
Il retrouve le sol français le lorsqu’il débarque sur les côtes normandes pendant la bataille de Normandie. Le , à La Lande-de-Goult dans l’Orne, alors qu’il aide le chef d’un char à sortir de la tourelle le tireur blessé, un obus percute l’engin, tuant tous ses occupants à l’exception d’Alain de Boissieu qui est éjecté et blessé. Quelques jours plus tard il se distingue en forêt d’Écouves en neutralisant une poche de résistance allemande. Continuant la progression au sein de la 2e DB, il parvient à Paris et participe à sa libération le , obtenant notamment la reddition des troupes allemandes regroupées autour du Palais du Luxembourg. En décembre, muté à sa demande au 501e régiment de chars de combat, il y prend le commandement de la 3e compagnie à la place de son camarade de captivité Jacques Branet. À la tête de ses chars pendant la bataille d’Alsace, il se distingue en réalisant des attaques efficaces sur des points où il ne peut être appuyé par l’infanterie du fait de l’épaisseur de la neige et en réalisant une attaque de nuit, en compagnie du capitaine Raymond Dronne, contre des canons antichars qui protégeaient Marckolsheim. En , il est affecté au cabinet militaire du général de Gaulle à Paris, mais obtient de pouvoir retourner à la 2e DB pour quelques jours alors qu’elle se trouve en Allemagne. Il la rejoint au début du mois de mai et entre avec elle à Berchtesgaden où dans les ruines du Berghof, il découvre un livre de Charles de Gaulle annoté de la main d’Hitler. Revenu à Paris, il est promu chef d’escadron en .
Le , le commandant Alain de Boissieu épouse la fille du général de Gaulle, Élisabeth, qu’il avait rencontrée à Londres en 1941. Il suit ensuite les cours de l’École d’état-major puis se porte volontaire pour servir en Indochine, ce qui lui est refusé. Il part alors en Afrique où, de 1947 à 1949, il est affecté au secrétariat de la défense de l’Afrique-Équatoriale française. De retour en France, il retrouve le 501e RCC dont il commande les services techniques, avant de repartir pour l’Afrique où de 1952 à 1953 il sert à l’état-major de la zone stratégique d’Afrique centrale. Promu lieutenant-colonel et rentré à Paris pour y suivre les cours de l’École supérieure de guerre, Alain de Boissieu en sort breveté en 1955 et retourne en Afrique centrale, cette fois à l’état-major du commandant en chef de la zone. En 1956, il est volontaire pour prendre le commandement d’une unité en Algérie ce qui lui est cette fois accordé. Devenant le chef de corps du 4e régiment de chasseurs dans le Constantinois, il se montre efficace dans les opérations contre l’armée de libération nationale et est promu colonel en . Il devient alors directeur du cabinet militaire de Paul Delouvrier, délégué général du gouvernement, et du général Challe, commandant en chef de l’armée en Algérie.
De retour en France en 1959, il est affecté comme chef d’état-major à l’inspection générale de l’Arme blindée et cavalerie puis suit les cours du Centre des hautes études militaires et de l’Institut des hautes études de Défense nationale. En 1962, alors qu’il accompagne Charles et Yvonne de Gaulle vers l’aérodrome de Villacoublay à bord de la Citroën DS-19 présidentielle, celle-ci est la cible de tirs. De Gaulle rapporte que son gendre lui a intimé l’ordre de se mettre à l’abri, lui disant : « À terre, père ! » (« père » ou « mon père » était le qualificatif qu’il employait communément lorsqu’il s’adressait au général).
Nommé général de brigade, il commande successivement la 2e brigade blindée de 1962 à 1964, l’École spéciale militaire de Saint-Cyr de 1964 à 1967 et la 7e division mécanisée de 1967 à 1969. En 1969, nommé inspecteur de l’arme blindée, il est également en parallèle membre du Conseil supérieur de la guerre. Gravissant les échelons du corps des officiers généraux, il devient général d’armée en 1971 et est nommé chef d’état-major de l’Armée de terre.
Grand chancelier de l’Ordre de la Légion d’honneur à partir de 1975, il démissionne de ce poste en 1981 à la suite de l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République française. Reprochant à celui-ci les termes employés contre le général de Gaulle dans son livre Le Coup d’État permanent, Alain de Boissieu quitte ses fonctions pour ne pas avoir à remettre au nouveau président le grand collier de la Légion d’honneur, rôle traditionnellement dévolu au grand chancelier de l’Ordre. Membre du Conseil de l’Ordre de la Libération depuis 1970, le général de Boissieu en devient chancelier en 2002.
Alain de Boissieu meurt à Clamart le . Ses obsèques sont célébrées le dans la cour d’honneur de l’hôtel des Invalides en présence du président de la République Jacques Chirac et des anciens Premiers ministres Pierre Messmer et Édouard Balladur. Il est inhumé au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises dans une tombe voisine de celle de Charles et Yvonne de Gaulle.
5 juillet 1932 : naissance du colonel Philippe Erulin (Légion étrangère).
 Il est fils et petit-fils d’officiers. Son grand-père le colonel Louis-Joseph Erulin comme son père le lieutenant-colonel André Erulin sont officiers, tous deux sortis de Saint-Cyr, ayant chacun servi dans une guerre mondiale. Son père reçoit les Croix de guerre 1939-1945 et TOE, la Médaille de la Résistance avec rosette, la cravate de commandeur de la Légion d’honneur, puis meurt en Indochine en 1951 à la tête du groupe mobile 4 sous les ordres du général de Lattre de Tassigny qui dira lors de son éloge funèbre « il nous laisse aussi un grand exemple. Car il n’était pas seulement de ceux à qui va spontanément la confiance, il était de ces rares hommes totalement vrais – qui donnent confiance en l’homme en sa grandeur, en sa vertu ».
Il est fils et petit-fils d’officiers. Son grand-père le colonel Louis-Joseph Erulin comme son père le lieutenant-colonel André Erulin sont officiers, tous deux sortis de Saint-Cyr, ayant chacun servi dans une guerre mondiale. Son père reçoit les Croix de guerre 1939-1945 et TOE, la Médaille de la Résistance avec rosette, la cravate de commandeur de la Légion d’honneur, puis meurt en Indochine en 1951 à la tête du groupe mobile 4 sous les ordres du général de Lattre de Tassigny qui dira lors de son éloge funèbre « il nous laisse aussi un grand exemple. Car il n’était pas seulement de ceux à qui va spontanément la confiance, il était de ces rares hommes totalement vrais – qui donnent confiance en l’homme en sa grandeur, en sa vertu ».
Son frère Dominique raconte que leurs parents leur donnent une éducation très stricte, et qu’à la mort de son père, Philippe Erulin reprend une partie des responsabilités de la famille.
Sorti de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1954, promotion Union française, Philippe Erulin suit les cours de l’École d’application de l’infanterie jusqu’en . Il est affecté au 1er régiment de chasseurs parachutistes de 1954 à 1959 au grade de lieutenant.
Il participe au sein de ce régiment à la guerre d’Algérie et à l’Opération Mousquetaire. En Algérie, il dirige une section qui combat notamment dans les Aurès et en Kabylie. Il y est blessé deux fois dont une gravement et est cité 4 fois. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur à 26 ans.
Il participe à la bataille d’Alger dans laquelle son régiment est engagé en 1957. Il est avec André Charbonnier l’un des deux officiers qui arrêtent Maurice Audin, militant communiste algérien dont le parti est engagé dans la lutte armée auprès du FLN, à son domicile le .
Il est promu capitaine dans l’infanterie en 1962.
Le , Philippe Erulin prend le commandement du 2e Régiment étranger de parachutistes à Calvi avec le grade de colonel.
Le , le président Valéry Giscard d’Estaing décide d’une opération au Zaïre où les rebelles katangais procèdent à des massacres et des prises d’otages.
Parti avec son régiment de Calvi le , après un transit par Kinshasa, il saute à la tête de 700 parachutistes organisés en deux vagues sur Kolwezi. La ville, qui accueillait alors près de 2 000 civils européens (principalement Belges et Français), est libérée après des combats violents avec les rebelles katangais. Le régiment perd 5 hommes, 20 légionnaires étant blessés.
Le , ils rentrent à Calvi. La semaine suivante, Valéry Giscard d’Estaing leur rend visite pour les féliciter de l’opération lors d’une prise d’armes à Bastia.
Philippe Erulin meurt subitement l’année suivante, le , d’une rupture d’anévrisme lors d’un jogging en forêt de Fontainebleau, laissant une femme et 3 enfants.
Philippe Erulin est cité à l’ordre de l’Armée, le : « Commandant du 2e Régiment étranger de parachutistes, a conduit du 19 au avec une réussite totale les opérations aéroportées de protection de sauvetage des populations de Kolwezi (République du Zaïre). Largué dans des conditions difficiles, il a entraîné son régiment à l’assaut avec vigueur et enlevé tous ses objectifs en moins d’une heure, libérant d’un coup par cette action remarquable les populations européennes prisonnières depuis une semaine et sauvant des centaines de vies humaines. Les jours suivants, il a poursuivi avec une maîtrise et un sang-froid exceptionnels les opérations de nettoyage dans la région de Kolwezi, délivrant ainsi de nombreux autres otages. Grâce à sa valeur militaire, il a permis au 2e Régiment étranger de parachutistes d’inscrire une victoire magnifique qui honore la Légion étrangère et les parachutistes. »
5 juillet 1943 : début de la bataille de Koursk (la plus grande bataille de chars de l’histoire).
La bataille de Koursk oppose du au les forces allemandes aux forces soviétiques dans le sud-ouest de la Russie, sur un immense saillant de 23 000 km2 au nord de l’Ukraine (entre Orel au nord et Belgorod au sud). Il s’agit de la plus grande bataille de chars de l’Histoire.
Alors qu’il est communément admis que la bataille de Stalingrad représente le véritable tournant de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le « début de la fin » pour la Wehrmacht et la mise en route de l’avancée irrésistible du « rouleau compresseur » soviétique jusqu’à Berlin, la bataille de Koursk n’est perçue comme un tournant dans le conflit qu’à partir des années 1950, alors que Khrouchtchev, membre du conseil de guerre du front de Voronej pendant la bataille, exerce un certain nombre de responsabilités en URSS. De plus, cette bataille nuance la thèse du rouleau compresseur soviétique jusqu’à Berlin : le premier semestre de l’année 1943 constitue en fait sur le front russe une phase d’équilibre, de récupération et de préparation à l’ultime tentative du Troisième Reich de reprendre l’initiative contre l’Armée rouge après ses échecs successifs devant Moscou et Stalingrad.
Pour l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW), le haut-commandement de la Wehrmacht, son nom de code est opération Citadelle. Elle va se solder par un nouvel échec pour le Reich. Trois armées allemandes regroupant 900 000 hommes soit 50 divisions dont 19 blindées et motorisées (plus 20 divisions de réserve), 10 000 canons et mortiers, plus de 2 000 avions et 2 700 chars se lancent à l’assaut de deux armées blindées soviétiques épaulées de 4 corps blindés comptant 3 300 chars et d’une armée d’infanterie regroupant 1 337 million d’hommes, 19 300 canons et mortiers ; soit au total deux millions de combattants soviétiques sur un front long de 270 km. Le Reich y engage 2 000 avions dont les 1 800 avions des IVe et VIe flottes aériennes et plus de 50 % de ses blindés disponibles. Le général Erfurth ira même jusqu’à déclarer que « tout le potentiel offensif que l’Allemagne avait pu rassembler fut jeté dans l’opération Citadelle ».
Bien qu’y ayant engagé l’essentiel et le meilleur de ses forces disponibles, la Wehrmacht se heurte à une défense soviétique solide, bien organisée et opiniâtre qu’elle ne parvient pas à percer malgré l’ampleur considérable des moyens engagés. C’est essentiellement la profondeur (trois lignes de défense, champs de mines), la longue préparation, réalisée très en avance (tranchées, fossés anti-chars, semi-enterrement de nombreux blindés…) et la mise à disposition d’importantes réserves (qui furent utilisées, par exemple tanks) à l’arrière – et non la simple supériorité numérique en un point donné – qui expliquent l’efficacité de la résistance soviétique. L’armée allemande subit de lourdes pertes. L’Armée rouge, malgré des pertes beaucoup plus importantes (le ratio est d’1 pour 6 en faveur des Allemands), dispose de réserves stratégiques et lance deux contre-offensives de part et d’autre du saillant de Koursk, l’opération Koutouzov et l’opération Rumyantsev. Ces contre-attaques rejettent la Wehrmacht sur ses lignes de départ et permettent la libération de deux villes stratégiquement importantes, Orel et Kharkov.
L’issue de cet affrontement gigantesque fut, par la suite, exagérée par la propagande soviétique et minorée par la propagande nazie.
Après cette bataille, à laquelle s’ajoute l’ouverture au même moment d’un second front en Italie, la défaite de l’Allemagne dans le conflit semble inéluctable.
La suite confirme cette impression : après cette défaite, la Wehrmacht ne parvint plus à reprendre l’offensive sur le front de l’Est. Elle subit dès lors une poussée continue, ralentie par des succès partiels et temporaires, qui aboutit à la reconquête du territoire soviétique sous occupation nazie, à la traversée de la Pologne par l’Armée rouge et enfin à la prise de Berlin.
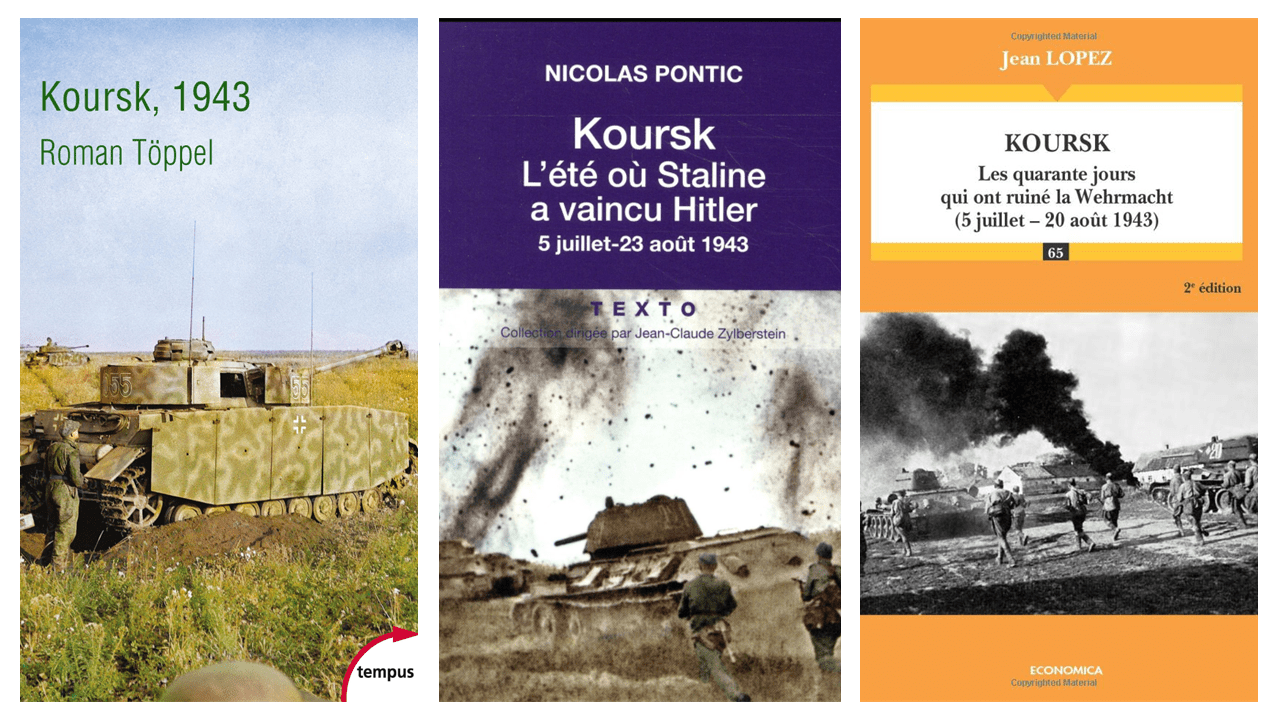
5 juillet 2017 : fin de la bataille de Benghazi (Libye).
La bataille de Benghazi est lancée le , lors de la Deuxième Guerre civile libyenne. Après plusieurs escarmouches au cours des années 2012, 2013 et 2014, l’« Armée nationale libyenne » (ANL) du gouvernement de Tobrouk, commandée par le général Khalifa Haftar, lance une offensive pour tenter de prendre le contrôle total de la ville de Benghazi, occupée en partie par divers groupes islamistes et djihadistes affiliés aux Conseil de la Choura des révolutionnaires de Benghazi et à l’État islamique. Au bout de près de trois années de combats, la ville passe entièrement sous le contrôle de l’ANL le .
***
Les combats opposent l’Armée nationale libyenne (ANL) du gouvernement de Tobrouk, commandée par le général Khalifa Haftar, à des groupes islamistes rassemblés au sein du Conseil de la Choura des révolutionnaires de Benghazi, formé le . Ce conseil de choura est soutenu par le gouvernement de Tripoli et les brigades de Misrata. Il est composé principalement d’Ansar-al-Charia, de la Brigade des martyrs du 17 février et de la Brigade Rafallah al-Sahati. Un autre groupe, les Brigades de défense de Benghazi, apparaît quant à lui en juin 2016. À Benghazi, les groupes du Conseil de choura s’allient également avec l’État islamique.
Le , les troupes du général al-Haftar lancent des attaques aériennes et terrestres contre Ansar-al-Charia et la Brigade des martyrs du 17 février à Benghazi. Haftar affirme qu’il s’agit de la phase finale de l’opération Dignité et qu’il démissionnera de son poste à la fin de l’opération pour nommer un nouveau chef d’État-major. Il existe des rapports contradictoires quant à une éventuelle participation ou soutien de l’Égypte à l’offensive.
Le , une trêve humanitaire de douze heures est décrétée.
Le , Ansar al-Charia confirme la mort de son émir, Mohammad al-Zahawi, tué dans des combats à Benghazi.
Les forces du général Haftar prennent le centre-ville, l’aéroport et plusieurs bases. Le , elles s’emparent de la plus grande base militaire de Benghazi.
Le , les forces pro-Haftar lancent une offensive dans les quartiers djihadistes, baptisée l’opération « Le sang du martyr ». Elles reprennent rapidement le port de Mreisa à l’ouest et l’hôpital de Houari au sud. Le , des combats à Benghazi, dans le quartier de Boatni, à l’ouest de la ville, font 14 morts et 32 blessés selon des sources médicales de l’agence Reuters. Le , les combats font au moins cinq morts chez les loyalistes et huit du côté des groupes islamistes.
Le , les forces du gouvernement de Tobrouk reprennent le quartier de Lithi et annoncent la « libération » du centre-ville. Les pertes des forces loyalistes sont alors d’au moins 20 soldats tués. L’attaque aurait été épaulée par des forces spéciales étrangères, et notamment françaises. L’ANL annonce avoir également avoir pris le camp de la brigade Rafallah al-Sahati, au sud de la ville, plus deux autres camps au sud-est, le petit port d’Almressa à l’ouest, et le port près de la cour suprême, située dans le centre-ville. De leur côté, les djihadistes tiennent toujours les quartiers de Sabri et Souq al-Hout, dans le centre-ville, et al-Quarsha et Si Faraj au sud. Le , Khalifa al-Ghowel, Premier ministre du gouvernement de Tripoli, déclare que des forces spéciales françaises « dirigeaient les combats » à Benghazi. De son côté, Wanis Boukhamada, commandant des forces spéciales libyennes, affirme que des conseillers militaires français sont présents à Benghazi, mais pas des unités combattantes. Des forces spéciales américaines sont également présentes à Benghazi et Haftar bénéficie aussi d’un actif soutien militaire de l’Égypte et des Émirats arabes unis.
Sept soldats de l’ANL sont tués le , dont quatre dans une attaque-suicide de l’EI, et sept autres sont blessés.
Le , les djihadistes de l’État islamique reprennent une partie du terrain perdu en février. Un attentat-suicide frappe le quartier général des forces d’Haftar, faisant 12 morts et 35 blessés. Six autres militaires sont tués dans les combats.
Le , trois sous-officiers français du Service Action de la DGSE sont tués dans le crash de leur hélicoptère. L’attaque est revendiquée par les Brigades de défense de Benghazi, qui affirment avoir visé l’appareil avec un missile sol-air SA-7 et des armes automatiques. Leur mort est confirmée par le gouvernement français le , qui parle cependant d’un « accident d’hélicoptère ». Par cette annonce, la France reconnaît officiellement sa présence en Libye, le Gouvernement d’union nationale (GNA) dénonce alors une « violation » de territoire et se dit « mécontent de l’annonce du gouvernement français concernant la présence française dans l’Est de la Libye ».
Le , dans le quartier d’al-Gawarcha dans l’ouest de Benghazi, une attaque-suicide au véhicule piégé fait 23 morts et 27 blessés dans les rangs des forces du gouvernement de Tobrouk[30],[31],[32].
Les 15 et , des combats ont lieu dans les secteurs de Qanfouda et Qawarcha, faisant 12 morts dans les rangs des troupes de Haftar.
Le quartier de Abou Sneib est repris par l’Armée nationale libyenne (ANL) le , après plusieurs jours de combats contre les milices du Conseil de la Choura des révolutionnaires de Benghazi. Ce dernier affirme également que les troupes pro-Haftar encerclent la zone de Qanfouda. Selon les déclarations anonymes d’un commandant de l’ALN à l’AFP, 52 soldats des forces pro-Haftar ont été tués entre le 1er et le 16 janvier. Les islamistes ne contrôlent alors plus que la zone de Qanfouda à l’ouest, et les quartiers d’Al-Saberi et Soug al-Hout dans le centre. Le , les forces de l’ANL lancent un assaut sur le quartier de Chaabiat Al-Tira, dans la zone de Qanfouda.
Le , l’Armée nationale libyenne affirme s’être emparée du secteur des immeubles n° 12, le dernier bastion des djihadistes dans le secteur ouest. Selon un porte-parole des forces spéciales de l’ANL, les combats ont fait 23 morts dans les rangs des islamistes et cinq du côté de l’ANL. Un MiG-21 des forces de Haftar est cependant abattu. Selon Human Rights Watch, les forces de l’ANL pourraient également avoir commis des « crimes de guerre » au cours de cette offensive, « dont des actes de tortures contre des civils et des exécutions sommaires ». D’après des vidéos et des photos reçues par l’ONG, des cadavres de djihadistes auraient été « profanés et mutilés » et trois hommes exécutés sommairement.
Le , l’ANL lance une offensive pour reprendre les derniers bastions des djihadistes à Benghazi : les quartiers d’al-Sabri et de Soug al-Hout, situés dans le centre-ville. Le 9, le colonel Miloud Zouai, porte-parole des Forces spéciales de l’ANL, annonce la mort de 11 soldats durant les combats ainsi que 55 autres blessés. Par ailleurs, il affirme avoir pris le contrôle du port.
Le , Ansar al-Charia annonce sa dissolution en raison de lourdes pertes subies parmi ses combattants et ses commandants.
Au cours du mois de juin, les forces de l’Armée nationale libyenne continuent leur progression les quartiers d’al-Sabri et Soug al-Hout au prix de la mort de 44 soldats selon des sources médicales de l’AFP. Un porte-parole de l’ALN, Khalifa al-Abid, affirme le 1er que les djihadistes ne tiennent alors plus que 2 kilomètres carrés de territoire. Le , selon des sources médicales, les combats font 16 morts et au moins 36 blessés dans les rangs de l’ALN, tandis que les forces d’Haftar revendiquent la mort de 19 djihadistes. Le , les deux dernières poches de résistance djihadistes tombent : les forces de l’ANL s’emparent de Soug al-Hout, puis prennent l’hôpital al-Joumhouria et le marché d’al-Jarid, dans les quartiers d’al-Sabri, où s’étaient retranchés les derniers combattants islamistes.
Le soir du 5 juillet, le maréchal Khalifa Haftar annonce la « libération totale » de Benghazi. Cette annonce est accueillie par des manifestations de joie par plusieurs milliers d’habitants qui descendent dans la rue dans la nuit du 5 au .
Cependant, malgré l’annonce de la victoire, des combats se poursuivent. Ainsi le , dans le quartier d’al-Sabri, les forces spéciales attaquent une vingtaine de combattants qui gardaient une prison secrète : dix prisonniers sont délivrés, mais les forces de l’ANL déplorent 12 morts et 35 blessés, tandis que cinq islamistes sont tués et onze capturés. Selon le porte-parole de l’ANL, le colonel Miloud al-Zwei, 23 soldats sont tués au total dans des opérations de ratissage dans les quartiers d’al-Sabri et Soug al-Hout entre le 5 et le , tandis que plusieurs « terroristes » sont tués et 17 autres arrêtés. Les derniers islamistes sont retranchés dans un petit périmètre de 150 m2 au marché Al-Jarid et près de l’hôtel municipal. Au moins 80 civils et militaires sont tués dans les quinze jours qui suivent l’annonce de la « libération » de la ville.
Les opérations se terminent définitivement le , avec la prise de la zone de Sidi Ekhrebish dans le centre de la ville de Benghazi.
Le , selon le bilan de l’AFP qui s’appuie sur des sources médicales, les affrontements à Benghazi ont fait au moins 365 morts, dont plus de 200 soldats, depuis le 15 octobre. Le bilan prend également en compte les civils tués pour certains en combattant côtés des forces du général Haftar, ainsi que les combattants des milices islamistes dont les corps ont été déposés dans des hôpitaux de Benghazi.
Le , Ahmad Mismari, un porte-parole de l’Armée nationale libyenne, annonce que plus de 5 000 soldats ont été tués pendant la bataille de Benghazi, longue de trois années. Selon RFI, environ 5 200 hommes de l’ANL ont été tués à Benghazi au cours des trois années de combats.






