La rubrique CHRONICORUM BELLI réalisée en grande partie avec le contenu de l’encyclopédie libre en ligne WIKIPEDIA (licence CC BY-SA 4.0) avec des éléments de recherche sur le NET ajoutés par TB. Si vous souhaitez ajouter des éléments (documents PDF, références à des livres, des vidéos, des documents audio, etc.) vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante : contact[@]theatrum-belli.com. Bonne lecture.
7 septembre 1191 : bataille d’Arsouf (troisième croisade).
La bataille d’Arsouf eut lieu le , à Arsouf, en Terre sainte, dans le cadre de la troisième croisade. Elle opposa une armée croisée forte de 20 000 hommes commandée par Richard Cœur de Lion, renforcée par des contingents de chevaliers de l’ordre du Temple dirigés par Robert de Sablé et des chevaliers de l’ordre de L’Hôpital menés par Garnier de Naplouse, à une armée ayyoubide forte de 20 000 hommes (dont une majorité montée), commandée par Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb. Il s’agit de la première victoire croisée depuis 14 ans, la dernière datant de 1177, quand Baudouin IV de Jérusalem à la bataille de Montgisard réussit à repousser une force ayyoubide également dirigée par Saladin.
Après une série de raids et d’escarmouches menées par les forces de Saladin, les deux armées se rencontrèrent dans la plaine d’Arsouf, au matin du . Les forces de Richard résistèrent aux nombreuses charges de cavalerie sarrasines ayant tenté de détruire la cohésion de l’armée croisée. Les Sarrasins continuèrent à avancer, jusqu’à ce que Richard rallie ses forces avant de victorieusement contre-attaquer.
***
Après la chute de Jérusalem, une troisième croisade avait été lancée à partir de l’Europe. L’entreprise semblait aisée pour les croisés, mais des querelles entre les rois de France et d’Angleterre retardent leur départ. À elle seule, l’armée allemande de l’empereur Frédéric Barberousse pouvait inquiéter Saladin, mais la noyade accidentelle de ce dernier entraîne la dispersion de son armée. Les rois français et anglais Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion ainsi que le grand-maître de l’ordre du Temple, Robert de Sablé, arrivent enfin en Terre sainte au et permettent la prise de Saint-Jean d’Acre assiégée depuis deux ans.
Philippe Auguste retourne alors en France, en laissant sur place une partie des troupes françaises (10 000 hommes sous le commandement du duc Hugues III de Bourgogne). Des négociations sont entamées entre Saladin et Richard Cœur de Lion, à propos de la libération des défenseurs d’Acre en échange de la restitution de la Vraie Croix et du versement d’indemnités mais, trouvant que Saladin fait traîner les choses, Richard ordonne le massacre des prisonniers musulmans, commettant ainsi une faute politique qui révolte les populations musulmanes.
Ayant détruit l’option diplomatique, il s’engage avec son allié le grand-maître templier, Robert de Sablé, dans la reconquête du littoral palestinien et quittent Saint-Jean-d’Acre le 1191 en direction de Caïffa. Dès la sortie de la ville, l’armée croisée est assaillie par les cavaliers musulmans qui sont repoussés, et l’armée se regroupe en une masse compacte et protégée par les armures que les musulmans ne parviennent à entamer. Le ravitaillement est assuré par la flotte qui suit l’armée, laquelle ne s’éloigne pas des côtes. Après avoir pris sans encombre Caïffa, évacuée la veille par sa garnison, les Francs continuent leur route et arrivent en vue d’Arsouf le . Richard envoie un émissaire à Saladin pour des pourparlers et ce dernier, désirant gagner du temps délègue son frère Al-Adel. Onfroy IV de Toron sert d’interprète, mais les négociations n’aboutissent pas, et l’armée repart vers Arsouf le
Le poète Ambroise fait une description précise de l’ordre de marche de l’armée : d’abord les Templiers menés par Robert de Sablé, suivis des troupes angevines et bretonnes, puis Guy de Lusignan avec les chevaliers poitevins, les Normands, les Anglais, les Français avec le chevalier flamand Jacques d’Avesnes et les barons capétiens avec le comte Robert II de Dreux, son frère Philippe, évêque de Beauvais, et Guillaume des Barres, et à l’arrière-garde les Hospitaliers mené par Garnier de Naplouse. Henri II, comte de Champagne, garde le flanc gauche de l’armée, face à la plaine, et Richard Cœur de Lion et Hugues III de Bourgogne patrouillent en permanence le long de la colonne, prêts à faire face au danger qui peut venir de n’importe où.
Quand l’armée croisée atteint les abords d’Arsouf, Saladin donne le signal de l’attaque et les cavaliers turcs, au nombre de trente mille selon les dires d’Ambroise, encerclent les croisés et les criblent de flèches. Les soldats, protégés par leurs armures n’ont que peu de perte, mais de nombreux chevaux sont tués. Un moment les croisés sont au bord du désastre rappelant celui de la bataille de Hattin. Mais Richard, bien que piètre politique, met en œuvre ses qualités de stratège. Il ordonne aux Hospitaliers de l’arrière-garde de tenir coûte que coûte, et adopte dans un premier temps une attitude défensive, et interdit aux chevaliers de poursuivre les Turcs, qui tentent leur technique de la fuite simulée. La discipline est telle que les chrétiens obéissent. Faisant preuve d’adresse, les archers et les arbalétriers de Richard infligèrent des pertes notables aux cavaliers turcs.
Mais comme les troupes ne peuvent tenir indéfiniment et que les pertes s’accumulent, il commence à mettre en place une charge destinée à entourer les cavaliers turcs pour les anéantir. Au moment où les chevaliers chrétiens entourent les cavaliers ayyoubides, les sons des trompettes devaient indiquer aux croisés d’infléchir leur charge vers l’intérieur afin de tailler en pièces les soldats musulmans et d’anéantir l’armée de Saladin. Mais l’impatience d’un Hospitalier et du chevalier anglais Thomas Carrew déstabilise la manœuvre qui devient une charge directe, qui balaye l’armée de Saladin, mais ne peut pas l’empêcher de se replier. Les archers musulmans, qui étaient descendus de leur monture et qui se trouvent en première ligne sont décapités ou renversés, et achevés par les sergents. La charge croisée enfonce ensuite les cavaliers turcs qui prennent la fuite. Craignant un piège, Richard interdit la poursuite et leur ordonne de faire demi-tour, tandis que Saladin regroupe ses troupes, au nombre de vingt mille soldats, sur une colline voisine. Ils attaquent la cavalerie franque qui revient vers Arsouf et tuent un certain nombre de chevaliers dont Jacques d’Avesnes, mais les Francs font volte-face et chargent à nouveau, dispersant encore les troupes sarrasines, lesquelles fuient une nouvelle fois et se réfugient dans des collines boisées. Conscient qu’il est dangereux de continuer dans ce terrain couvert, Richard ordonne de nouveau la fin de la poursuite.
La supériorité militaire, qui appartenait aux musulmans depuis les années 1170, revient de nouveau aux Francs pour une longue période, selon l’historien René Grousset qui parle de soixante ans, mais il convient de nuancer cette durée, car il y a la défaite du comte de Bar à Gaza, la croisade des barons (1239), et la bataille de Forbie (1244) qui contredisent cet avis. À vrai dire, il n’y a eu pratiquement aucune véritable bataille en rase campagne dans les décennies qui suivent. L’avenir montre même que, sans le soutien d’une armée croisée venue d’Europe, les Francs d’Orient n’ont pas vraiment les moyens militaires de se lancer dans des campagnes : on verra notamment le roi Amaury II de Lusignan y renoncer lorsque la quatrième croisade est détournée sur Constantinople.
Saladin, qui n’a pas réussi à vaincre les croisés, ni par le harcèlement, ni par la bataille, voit son prestige diminué auprès de ses troupes. Il tente de défendre Ascalon, mais ses émirs refusent de le suivre et il doit se résoudre à pratiquer la tactique de la terre brulée, en ordonnant la destruction de Jaffa, d’Ascalon et de Ramla.
Richard Cœur de Lion n’exploite pas son succès. Il entreprend la reconstruction de Jaffa, alors qu’il aurait pu surprendre l’armée de Saladin à Ascalon, ou reprendre Jérusalem, mal défendue par une garnison trop faible et des fortifications qui n’ont pas encore été réparées depuis le siège de Jérusalem en 1187.
Source : WIKIPEDIA
7 septembre 1757 : bataille de Moys (guerre de Sept Ans).
La bataille de Moys a eu lieu pendant la guerre de Sept Ans. Une armée prussienne de 13 000 hommes affronta une armée autrichienne deux fois plus nombreuse. Le corps prussien dans son entier capitula à l’issue de la bataille.
Après leur victoire de Kolin le , les Autrichiens, commandés par Charles-Alexandre de Lorraine, entreprennent la reconquête de la Silésie. Un corps prussien de 13 000 hommes commandé par Hans Karl von Winterfeldt cherche à leur barrer la route de Görlitz, à la frontière de la Silésie et de la Saxe.
Le , un corps autrichien de plus de 20 000 hommes avec 24 canons lourds, commandé par le général Franz Leopold von Nádasdy, attaque les lignes prussiennes près du village de Moys, à un demi-mille de Görlitz. Les Prussiens, nettement inférieurs en nombre, sont encerclés et doivent capituler : leur général Winterfeldt, mortellement blessé, mourra le lendemain.
Dans les semaines suivantes, les armées autrichiennes, fortes au total de 90 000 hommes, enlèvent aux Prussiens une grande partie de la Silésie. Le , elles s’emparent de la forteresse de Schweidnitz (Świdnica), et le 22 novembre, elles remportent la bataille de Breslau. La Prusse est alors dans une situation critique dont elle ne se dégagera que par la bataille de Leuthen en décembre.
7 septembre 1812 : bataille de la Moskowa (ou de Borodino) – Campagne de Russie.
La bataille de la Moskova, bataille de la Moskowa ou bataille de Borodino est une bataille opposant la Grande Armée commandée par Napoléon 1er à l’armée impériale russe menée par le Feldmarschall Mikhaïl Koutouzov. Elle a lieu le (26 août a.s.) à proximité du village de Borodino, à 125 kilomètres de Moscou. Le nom de Moskova, plus évocateur que celui de Borodino, est choisi par Napoléon pour désigner cette bataille, et fait référence à la rivière qui coule à plusieurs kilomètres du champ de bataille et non au lieu où se déroulèrent les combats.
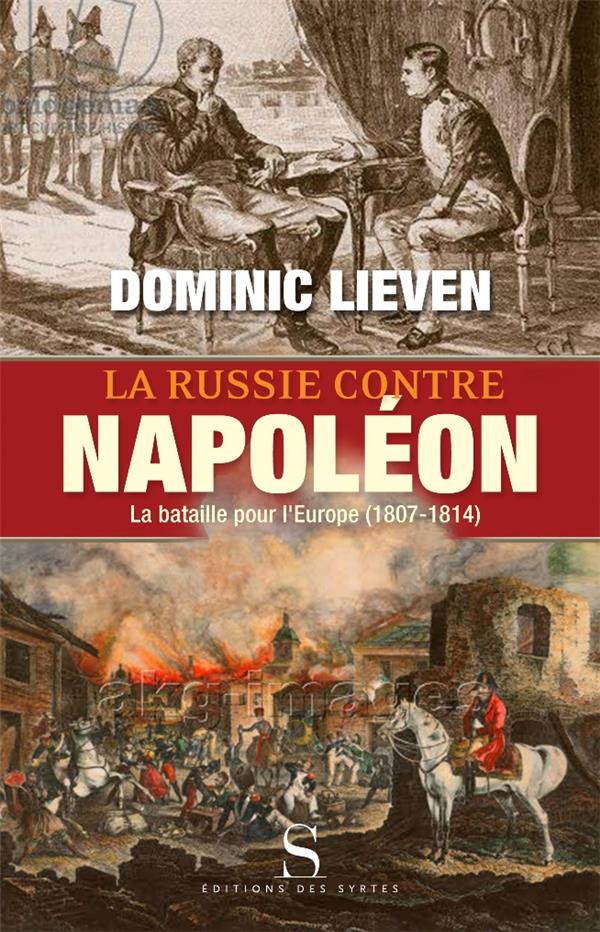 Qualifiée de « bataille des géants », elle est la plus importante et la plus sanglante bataille de la campagne de Russie, impliquant plus de 250 000 hommes pour des pertes estimées à 70 000 hommes.
Qualifiée de « bataille des géants », elle est la plus importante et la plus sanglante bataille de la campagne de Russie, impliquant plus de 250 000 hommes pour des pertes estimées à 70 000 hommes.
Depuis son entrée sur le territoire russe, Napoléon souhaite engager une bataille décisive face à un ennemi qui ne cesse de se dérober. Cette campagne qu’il entreprend comme une guerre purement politique nécessite une victoire éclatante afin d’obliger le tsar Alexandre 1er à demander la paix et à conclure un nouveau traité d’alliance favorable à la France et à sa stratégie de blocus continental. Côté russe, le tsar, faisant face à des dissensions entre ses généraux quant à la stratégie à adopter, nomme Koutouzov commandant en chef de ses armées le 18 août. Ce dernier, après avoir laissé la Grande Armée s’approcher de Moscou sous les harcèlements incessants des cosaques, se décide enfin, aux portes de celle-ci, à fortifier ses positions et à livrer bataille.
Au cours de cette confrontation, les Français réussissent à s’emparer des principales fortifications russes, dont la redoute Raïevski et les « flèches » défendues par le général Piotr Bagration, qui est blessé mortellement lors de l’assaut (il décèdera le ). La victoire est française dans la mesure où Napoléon contraint les forces russes à battre en retraite et s’ouvre la voie vers Moscou. Cependant, cette victoire est une victoire à la Pyrrhus : les pertes de chaque côté sont immenses (environ 30 000 soldats français tués ou blessés pour 45 000 côté russe) et bien que fortement réduite, l’armée russe qui dispose de réserves peut encore représenter une menace. Ainsi, Koutouzov, de manière controversée (il n’a pas réussi à bloquer la route de Moscou et a perdu plus d’hommes que Napoléon en évitant cependant l’enveloppement de son armée), affirme qu’il a triomphé de l’ennemi à Borodino, le nom russe de la bataille.
Les Français font leur entrée dans Moscou une semaine plus tard, le 14 septembre, et y resteront jusqu’au 19 octobre, jour où commence le retour, bientôt désastreux, de la Grande Armée.
***

La Grande Armée commence l’invasion de la Russie en juin 1812. Les forces russes, initialement massées le long de la frontière polonaise, reculent devant les Français en appliquant la politique de la terre brûlée selon la tactique de Michel Barclay de Tolly, le commandant en chef de l’armée russe. Ce dernier a bien tenté d’établir une ligne défensive solide face à la Grande Armée, mais ses efforts sont à chaque fois ruinés par la rapidité de l’avance française.
Napoléon marche sur Moscou à partir de Vitebsk. La Grande Armée est cependant mal préparée pour une campagne terrestre prolongée. En effet, sa base logistique la plus proche est Kovno, située à 925 kilomètres de Moscou, et le dépôt de ravitaillement de Smolensk est situé à 430 km de la capitale russe. Les lignes d’approvisionnement françaises sont donc particulièrement vulnérables aux attaques des partisans russes. Néanmoins, l’envie d’une bataille décisive pousse Napoléon à passer à l’action.
Pendant ce temps, les conflits entre les subordonnés de Barclay empêchent les Russes d’établir une stratégie commune. La politique de terre brûlée de Barclay est perçue comme une réticence à combattre. Alexandre 1er, lassé de cette stratégie, nomme un nouveau commandant en chef russe le 29 août : le prince Mikhaïl Koutouzov. Ce dernier n’est pas considéré par ses contemporains comme l’égal de Napoléon, mais il est cependant préféré à Barclay car il est ethniquement russe (contrairement à Barclay qui a des origines écossaises), et est très populaire dans l’entourage du tsar.

Koutouzov attend cependant que les Français, dont les forces comptent aussi d’importants contingents étrangers, soient à 125 km de Moscou pour accepter la bataille. Le 30 août, il ordonne une nouvelle retraite à Gjatsk. Le rapport de force reste à l’avantage des Français, mais il est désormais de cinq contre quatre au lieu de trois contre un auparavant. Koutouzov établit alors sa ligne défensive dans une zone facile à défendre, près du village de Borodino. À partir du 3 septembre, Koutouzov renforce la position avec des travaux de terrassements, notamment la redoute Raïevski dans le centre droit russe et les « flèches » de Bagration sur la gauche.
L’armée russe est disposée au sud de la route de Smolensk, sur laquelle la Grande Armée progresse. Érigée sur une butte, la redoute de Chevardino, située près du village du même nom, constitue la gauche russe. Voulant percer la ligne défensive russe, les Français prennent position au sud et à l’ouest du village après un bref mais sanglant prélude à la bataille principale.
L’affrontement proprement dit débute le 5 septembre, quand la cavalerie française du maréchal Joachim Murat rencontre celle du comte russe Konovnitsyne. La furieuse mêlée qui s’ensuit tourne à l’avantage des Français et les Russes battent en retraite lorsque leur flanc gauche est menacé. Le 6 septembre, les hostilités reprennent, mais Konovnitsyne doit retraiter à nouveau lorsque le 4e corps d’armée du prince Eugène de Beauharnais renforce Murat et menace le flanc russe. Les Russes se replient sur la redoute de Chevardino à proximité de laquelle se trouve le général Gortchakov avec 11 000 hommes et 46 pièces d’artillerie.
Murat donne l’ordre aux 1er et 2e corps de cavalerie, respectivement commandés par les généraux Nansouty et Montbrun, d’attaquer la redoute. Ils sont soutenus par la division Compans et le premier corps d’infanterie du maréchal Davout. Au même moment, l’infanterie de Poniatowski attaque la redoute par le sud. Les Français, repoussés à deux reprises par les fantassins de Neverovski, finissent par s’emparer de la redoute en perdant 4 000 hommes, contre 7 000 Russes. L’avance inattendue des Français plonge les Russes dans le désarroi. L’effondrement de leur flanc gauche les contraint à ériger une position défensive de fortune autour du village d’Outitsa.
- L’armée russe aligne, de gauche à droite, les corps de Toutchkov, de Borozdine, de Raïevski, de Dokhtourov, d’Ostermann, et de Baggovout. Le corps du grand-duc Constantin forme la réserve russe. Les éléments de cavalerie russes sont commandés par Silvers, Pahlen, Kork, Platov et Ouvarov. L’aile gauche est commandée par Bagration, l’aile droite par Barclay de Tolly, qui appuient leurs lignes défensives sur un système de redoutes. La plus importante, la redoute Raïevski, au centre avec dix-huit canons, est prolongée au sud par trois autres retranchements : les « flèches » de Bagration. Les forces russes présentes le jour de la bataille comprennent au total 180 bataillons d’infanterie, 164 escadrons de cavalerie, 20 régiments de cosaques et 55 batteries d’artillerie, soit 640 canons. Au total, les Russes ont engagé 103 800 hommes. Toutefois, 7 000 cosaques, ainsi que 10 000 miliciens russes présents ce jour-là n’ont pas servi dans la bataille. L’armée russe bénéficie d’un avantage important, étant donné qu’elle est retranchée dans diverses redoutes.
- Positionnée près de Chevardino, à 2,5 km des lignes russes, la Grande Armée dispose, de gauche à droite, des corps d’Eugène de Beauharnais, de Ney et de Davout, appuyés au sud par l’infanterie de Poniatowski et les forces de cavalerie de Nansouty, de Montbrun et de La Tour-Maubourg. La Garde impériale et les corps de Junot, de Grouchy et de Murat constituent la réserve. La Grande Armée comprend 214 bataillons d’infanterie, 317 escadrons de cavalerie et 587 pièces d’artillerie pour un total de 124 000 soldats. Cependant, la Garde impériale, qui dispose de 109 canons et qui comprend trente bataillons d’infanterie et vingt-sept escadrons de cavalerie pour un total de 18 500 hommes, n’a pas été engagée dans la bataille.
La veille au soir, la 2e division générale de grenadiers commandée par le général Vorontsov prend position dans les flèches. La bataille commence à 6 h du matin par une préparation d’artillerie contre le centre russe, menée par 102 canons. Mais les Français perdent ensuite un temps précieux à les déplacer, car ils sont trop loin des lignes russes. Davout donne l’ordre aux divisions Compans et Dessaix d’attaquer la flèche située la plus au sud. Canonnés par l’artillerie russe, Compans et Dessaix sont blessés, mais les Français parviennent à avancer. Voyant la confusion, Davout dirige alors personnellement la 57e brigade, jusqu’au moment où son cheval est abattu. Davout tombe si lourdement qu’il est signalé mort au général Sorbier. Le général Rapp est envoyé sur place pour le remplacer, mais Davout est vivant et toujours à la tête de la 57e brigade. Rapp prend alors la tête de la 61e brigade avant d’être blessé pour la vingt-deuxième fois de sa carrière. À 7 h, Napoléon engage les corps de Ney puis de Junot pour venir en aide à Davout ; ce dernier conquiert enfin les trois flèches vers 7 h 30. Mais les Français sont repoussés par une contre-attaque russe menée par Bagration avec la 27e division d’infanterie de Neverovski, les hussards d’Akhtyrski et les dragons de Novorossiisk. Ney relance un assaut contre les flèches, et parvient à les reprendre vers 10 h. Barclay envoie alors trois régiments de la Garde, huit bataillons de grenadiers et vingt-quatre canons sous le commandement de Baggovout pour renforcer le village de Semionovskoïe, au nord des flèches. Le retour offensif de Baggovout déloge les Français des flèches, mais Ney les reprend à nouveau à 11 h. Le maréchal en est de nouveau chassé, mais il conquiert définitivement la position vers 11 h 30. Napoléon hésite à engager la Garde impériale qui constitue sa dernière réserve, si loin de France.
Pendant ce temps, Eugène de Beauharnais pénètre dans Borodino après de durs combats contre la Garde russe, et progresse vers la redoute principale. Cependant ses troupes perdent leur cohésion, et Eugène doit reculer sous les contre-attaques russes. Le général Delzons se place alors devant Borodino pour protéger le village. Au même moment, la division Morand progresse au nord de Semionovskoïe, tandis que les forces d’Eugène franchissent la Kalatcha en direction du sud. Eugène déploie alors une partie de son artillerie et commence à faire refluer les Russes derrière la redoute. Appuyés par l’artillerie d’Eugène, les divisions Morand et Broussier progressent et prennent le contrôle de la redoute. Barclay lui-même doit rallier le régiment Paskevitch en déroute. Koutouzov ordonne alors au général Iermolov de reprendre la redoute ; disposant de trois batteries d’artillerie, ce dernier ouvre le feu contre la redoute tandis que deux régiments de la Garde russe chargent la position. La redoute repasse alors aux mains des Russes.
L’artillerie d’Eugène continue à pilonner les Russes alors qu’au même moment, Ney et Davout canonnent les hauteurs de Semionovskoïe. Barclay envoie des renforts à Miloradovitch, qui défend la redoute tandis qu’au plus fort de la bataille, les subordonnés de Koutouzov prennent toutes les décisions pour lui : selon les écrits du colonel Clausewitz, le général russe semble être « en transe ». Avec la mort du général Koutaïsov, qui commandait l’artillerie russe, une partie des canons, situées à l’arrière des lignes russes, sont inutilisés, tandis que l’artillerie française fait des ravages dans les rangs russes.
À 14 heures, Napoléon ordonne un nouvel assaut contre la redoute. Les divisions Broussier, Morand et Gérard doivent charger la redoute, appuyés par la cavalerie légère de Chastel à droite et par le second corps de cavalerie de réserve à gauche. Le général Auguste de Caulaincourt ordonne aux cuirassiers de Wathier de mener l’attaque contre la redoute. Observant les préparatifs français, Barclay déplace alors ses troupes pour renforcer la position, mais elles sont canonnées par l’artillerie française. Caulaincourt mène personnellement la charge et parvient à enlever la redoute, mais il est tué par un boulet. La charge de Caulaincourt fait refluer la cavalerie russe qui tente de s’opposer à elle, tandis que la gauche, où Bagration a été mortellement blessé, et le centre russe, sévèrement mis à mal, donnent des signes de faiblesse. À ce moment, Murat, Davout et Ney pressent l’Empereur, qui dispose de la Garde impériale en réserve, de l’engager pour porter l’estocade finale à l’armée russe, mais celui-ci refuse. Quand ils lui demandent pourquoi il leur repond : « Ils vont me la démolir ».
Barclay demande alors à Koutouzov de nouvelles instructions, mais ce dernier se trouve sur la route de Moscou, entouré de jeunes nobles et leur promettant de chasser Napoléon. Toutefois, le général russe se doute bien que son armée est trop diminuée pour combattre les Français. Les Russes se retirent alors sur la ligne de crête située plus à l’est. Napoléon estime que la bataille reprendra le lendemain matin, mais Koutouzov, après avoir entendu l’avis de ses généraux, ordonne la retraite vers Moscou. La route de la « Ville sainte » est ouverte à la Grande Armée.
Les pertes sont très élevées dans les deux camps. La Grande Armée perd environ 30 000 hommes : selon P. Denniee, inspecteur aux revues de la Grande Armée, il y aurait eu 6 562 morts, dont 269 officiers, et 21 450 blessés. En revanche, selon l’historien Aristide Martinien, les Français perdent au total 1 928 officiers morts ou blessés, incluant 49 généraux. Les Russes perdent environ 44 000 hommes, morts ou blessés, dont 211 officiers morts et 1 180 blessés. 24 généraux russes furent blessés ou tués, dont Bagration qui meurt de ses blessures le 24 septembre et Toutchkov. Du côté français, le manque de ravitaillement, causé par l’allongement des lignes d’approvisionnement, pour les soldats valides fait que certains blessés meurent de faim ou de négligences dans les jours qui suivent la bataille.
Les Français prirent Moscou (à 125 km) le 14 septembre. Le soir même, d’immenses incendies ravagent la ville. Les derniers feux seront éteints le 20 septembre au soir. Moscou, essentiellement construite en bois, est presque entièrement détruite. Privés de quartiers d’hiver et sans avoir reçu la capitulation russe, les Français sont obligés de quitter la ville le 18 octobre pour entamer une retraite catastrophique.
La bataille de la Moskova est considérée comme une victoire tactique française. Elle ouvre la voie de Moscou à Napoléon. Les pertes françaises, quoique très importantes, restent inférieures au nombre de morts et blessés russes.
Bien que la bataille ait été vue comme une victoire pour Napoléon, des historiens contemporains considèrent Borodino comme une victoire à la Pyrrhus. Murat et le vice-roi Eugène de Beauharnais, cités par Philippe de Ségur dans son Histoire de la Grande-Armée pendant l’année 1812, font état de l’inertie et de l’indécision de Napoléon pendant cette bataille, comme si son génie en avait été absent. En fait, l’Empereur aurait souffert d’une fièvre et de douleurs qui, en affectant sa santé, l’auraient privé de ses facultés habituelles de stratège extraordinaire. D’autres auteurs ont toutefois vivement contesté cette présentation, en particulier Gaspard Gourgaud, officier d’ordonnance de l’Empereur, et qui servit auprès de ce dernier durant toute la campagne de Russie.
L’Empire russe a aussi revendiqué la victoire, les troupes s’étant repliées en bon ordre. La Russie affirma sa revendication sur la victoire en nommant une classe de cuirassé classe Borodino à la fin du XIXe siècle. En 1949, l’URSS fonda la ville de Borodino dans le kraï de Krasnoïarsk, à la mémoire du village, fondé par les soldats du régiment Semyonovsky, participants à la guerre patriotique de 1812, qui ont honoré la mémoire de la guerre et de sa bataille principale, exilés en Sibérie après le soulèvement du régiment en 1820.
Source : WIKIPEDIA


7 septembre 1923 : création d’Interpol.
L’Organisation internationale de police criminelle (OIPC), communément abrégée en Interpol, est une organisation internationale créée dans le but de promouvoir la coopération policière internationale. Son siège est situé à Lyon, en France.
***
Les prémices de la création d’Interpol datent du début du XXe siècle. Cette idée de police internationale avait été émise par Edmond Locard, grand professeur de médecine légale, qui fonda à Lyon (sa ville) en 1910 le premier laboratoire de police scientifique au monde. Celui-ci se trouvait en 1905 au VIe Congrès d’anthropologie criminelle, à Turin. Parmi les personnages importants qui s’y trouvent, il y rencontre le criminologue français Alphonse Bertillon, le professeur italien de médecine légale et psychiatre Cesare Lombroso, ainsi que le criminologue et photographe suisse Rodolphe Archibald Reiss. En voyant ce beau monde, Edmond Locard se rend compte que pour lutter contre le crime international, il faut user d’une police internationale.
L’idée se poursuit en 1914, lors du premier Congrès international de police criminelle : des officiers de police, juristes et magistrats de 14 pays se réunissent à Monaco à l’initiative du prince Albert 1er, pour discuter des procédures d’arrestation et d’extradition, techniques d’identification et centralisation des fichiers. La Première Guerre mondiale suspend cette initiative.
L’organisation est créée le lors du deuxième Congrès à l’initiative de Johann Schober, le directeur de la police de Vienne qui réunit dans sa ville les responsables des forces de polices de vingt pays pour fonder la Commission internationale de police criminelle (CIPC).
Source : WIKIPEDIA

7 septembre 1940 : début du Blitz (bataille d’Angleterre).
Le Blitz (terme allemand signifiant « éclair ») est la campagne de bombardements stratégiques durant la Seconde Guerre mondiale menée par l’aviation allemande contre le Royaume-Uni du au . Il s’agit de l’opération la plus connue de la bataille d’Angleterre. Elle toucha principalement Londres mais également Coventry, Plymouth, Birmingham et Liverpool, et aussi les villes historiques de Canterbury et Exeter et la station balnéaire de Great Yarmouth. 41 000 à 43 000 civils furent tués et 90 000 à 150 000 blessés selon des chiffres officiels. Près de 3,75 millions de Britanniques évacuèrent Londres et les principales villes. Toutefois, ce procédé utilisé par le Troisième Reich qui avait pour but de démoraliser le peuple britannique ne fonctionna pas et n’empêcha pas celui-ci de soutenir l’effort de guerre du pays.
***
Le Blitz commence le 7 septembre quand une armada de 320 bombardiers escortée par 600 chasseurs bombardent Londres, faisant environ 500 morts et 1 137 blessés graves. Le palais de Buckingham est touché le . Le , la cathédrale Saint-Paul est touchée par une bombe. L’église devient alors l’un des symboles de la résistance anglaise. Le 14- : opération Sonate au clair de lune, bombardement de Coventry tue 568 habitants, c’est la première tempête de feu. La Chambre des communes est touchée le . La ville de Manchester est visée lors de l’épisode connu comme le Manchester Blitz les 22, 23 et 24 décembre. Le , des bombes incendiaires ravagent Londres. Le 13 mars a lieu le bombardement de Clydeside, près de Glasgow, qui fait 528 morts. En représailles, la Royal Air Force bombarde Berlin le 9 avril. Il y a ensuite cinq nuits de bombardements consécutifs sur Plymouth du 21 avril au 25 avril, puis une semaine de raid sur Liverpool du 1er au 7 mai. Un important raid sur Londres a lieu le 10 mai. Le dernier raid a lieu le 21 mai et atteint Birmingham, cette attaque marque la fin du Blitz.
L’attaque des centres de production industriels incluant des populations civiles dans un cadre de destruction stratégique est reprise par les Alliés sur une échelle bien supérieure.
En , après la fin de la bataille de France, alors qu’une grande partie de l’Europe est sous occupation allemande, Hitler propose aux Britanniques une paix de compromis avec l’Allemagne et de nouvelles négociations. Churchill refusa, tout en sachant que le Royaume-Uni serait la prochaine cible. La campagne menée par les Britanniques en Norvège avait échoué, tandis que leur force expéditionnaire avait essuyé une cuisante défaite en France. Hitler décide d’envahir le Royaume-Uni, mais il sait que pour ce faire il doit avoir la suprématie du ciel et donc anéantir la Royal Air Force.
Il y avait d’un côté le maréchal de l’Air, Sir Hugh Dowding, commandant les avions de chasse du Fighter Command de la RAF ; et de l’autre Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, l’aviation de combat allemande, et les maréchaux Albert Kesselring et Hugo Sperrle, qui commandaient les 2e et 3e flottes aériennes. Les Britanniques engagèrent 55 escadrons du Fighter Command, soit 850 chasseurs (Spitfire et Hurricane), et 3 080 pilotes. Les Allemands disposaient de 1 000 chasseurs, de 1 200 bombardiers (Junkers Ju 88, Dornier Do 17 et Heinkel He 111), de 280 bombardiers en piqué (Stukas), et de 375 chasseurs-bombardiers (Messerschmitt bf 109 ou 110), soit 10 000 hommes d’équipage. La première bataille de l’histoire entièrement livrée dans les airs se déroula du au .
Le , la grande offensive allemande, qui devait être décisive (le nom de code de l’opération était Adlertag, le Jour de l’aigle), fut lancée dans l’après-midi. La Luftwaffe, commandée par Göring, effectua 1 000 sorties de chasse et 485 sorties de bombardement. Elle perdit 45 bombardiers et chasseurs, tandis que les Britanniques perdaient 13 chasseurs.
Le 14, le temps qui se dégradait (il était déjà mauvais le 13) obligea les Allemands à n’engager que le tiers des flottes de Kesselring et de Sperrle qui avaient été utilisées la veille. Le 15, la 5e flotte du général Stumpff, qui était stationnée au Danemark et en Norvège, vint aider les autres flottes ; il engagea tous ses chasseurs et la moitié de ses bombardiers, soit au total 1 000 appareils. La RAF dut repousser au cours de cette journée 5 attaques successives. 75 appareils allemands furent détruits et 35 chasseurs britanniques abattus.
Le 16 et le 17 les attaques se poursuivirent, mais n’eurent aucun résultat. Du 18 au 23 les opérations durent être suspendues à cause du mauvais temps. En 10 jours une centaine d’appareils britanniques avaient été détruits, contre 100 chasseurs et 450 bombardiers pour les Allemands. De plus, ces derniers avaient dû renoncer à l’emploi des Stukas, trop vulnérables, et des Me‑110, trop lents.
Le 24, Göring lança sa seconde offensive. Les raids furent concentrés sur les pistes d’envol, les hangars, les stations radar, les centres de contrôle aérien et les usines d’aviation britanniques. Pendant 14 jours, c’est-à-dire jusqu’au 6 septembre, la RAF effectua en moyenne plus de 700 sorties quotidiennes, étant constamment en état d’alerte. Les Britanniques perdirent 295 chasseurs et 171 autres furent gravement endommagés, tandis que la Luftwaffe perdait 530 appareils. Début septembre, la RAF commença à manquer de pilotes et d’appareils.
Le se produisit un événement qui changea le cours de la bataille. Un bombardier Heinkel He 111, croyant attaquer la raffinerie de Thameshaven, largua ses bombes par erreur sur Londres, un objectif qui ne devait être attaqué que sur l’ordre personnel de Hitler. En représailles, dans la nuit du , la RAF parvint à lâcher quelques bombes sur Berlin. Hitler se lança dans une diatribe contre les Britanniques : « S’ils bombardent nos villes, nous raserons les leurs, s’ils lâchent des centaines de bombes nous en lâcherons des milliers. » Hitler modifia alors sa stratégie et décida de bombarder les villes britanniques et plus particulièrement Londres en guise de représailles.
Dès le , dans l’espoir d’abattre le moral ennemi, on bombarda les villes britanniques. Ce Blitz frappa en premier lieu les quartiers populaires de l’East End de Londres. Le raid le plus violent frappa Coventry dans la nuit du 14 au 15 novembre. La propagande allemande inventa pour l’occasion le néologisme « coventryser » (coventrisieren) pour exprimer l’idée d’une destruction totale. Le Blitz se poursuivit jusqu’en mai 1941, ce qui permit à la RAF, vu la concentration des objectifs sur les grandes villes, de se « refaire une santé » : les avions et les hommes n’ayant plus qu’à attendre chaque vague sur le chemin des villes, puis au retour, de pourchasser les bombardiers, tandis que la DCA prenait le relais sur la zone.
Du et jusqu’au , pour échapper à la défense britannique, les bombardiers allemands intervinrent systématiquement de nuit, par vagues de 150 à 200 appareils à chaque fois. Les bombardements firent un total de 50 000 morts chez les civils. Constatant leur incapacité à vaincre la chasse adverse et la destruction quotidienne des barges de débarquement dans les ports de la Manche, Adolf Hitler reconnut son échec et renonça le à son projet d’invasion ; il retourna alors ses armes contre l’Europe de l’Est et l’Union soviétique.
La bravoure et la détermination de tous les pilotes britanniques, canadiens, australiens, néo-zélandais, américains, français, belges, polonais et de bien d’autres nationalités, en plus de l’erreur de Hitler de concentrer les attaques sur les villes, permirent d’empêcher l’invasion du Royaume-Uni. De plus, les pilotes alliés pouvaient compter sur l’avantage de combattre sur leur territoire. S’ils devaient se parachuter, ils étaient en quelques heures à nouveau opérationnels tandis qu’un pilote allemand était perdu.
Le réseau de radars disséminés sur toute la côte joua également un rôle déterminant, prévenant à temps les escadrilles d’interception et en les dirigeant de manière efficace. On lui doit notamment le Jeudi noir le qui vit d’énormes pertes allemandes.
Enfin, les chasseurs d’escorte allemands manquaient d’autonomie et devaient souvent abandonner les bombardiers au retour, les laissant ainsi vulnérables.
De juillet à octobre, 415 pilotes britanniques perdirent la vie dans cet affrontement décisif. Le Premier ministre Winston Churchill exprima dès le la reconnaissance des Britanniques à leur égard : « Jamais dans l’histoire des guerres tant de gens n’ont dû autant à si peu. »
Source : WIKIPEDIA

7 septembre 1987 : le dispositif Épervier abat un Tupolev.
Un peu avant 07 h 00 du matin, les radars du dispositif Épervier détectent qu’un Tupolev 22 libyen vient de franchir sans autorisation la frontière entre le Tchad et la Libye et fonce sur N’Djaména. Le 403e Régiment d’artillerie tire un missile Hawk qui atteint le Tupolev de plein fouet. L’analyse de l’épave révèle que les soutes étaient ouvertes au moment de l’impact du missile et pleines de bombes à fragmentation.

Récit du colonel Jean-Pierre PETIT (1943-2018), ancien chef de corps du 403e RA
Lundi 7 septembre 1987, 6h50 du matin. À N’Djaména, capitale du Tchad, en plein cœur de l’Afrique, il fait jour mais le ciel est couvert, le plafond est bas.
Pour les hommes du dispositif de protection Épervier que la France a mis en place au mois de février de l’année précédente, la surveillance du ciel est permanente : la menace aérienne existe. On sait que l’aviation libyenne possède des bombardiers lourds, à long rayon d’action, qui sont capables d’atteindre N’Djaména.
La Défense aérienne de N’Djaména est conduite en temps réel par une Cellule tactique (CETAC) de l’Armée de l’air française. S’y trouvent le Lieutenant DUHAYON, chef-contrôleur, son adjoint, le sergent-chef BOUVIER et un officier de liaison sol-air, l’aspirant ORLANDI. Ils disposent d’un radar de surveillance Centaure, à longue portée, qui est installé sur l’aérodrome de la capitale tchadienne.
À proximité, une batterie sol-air de l’armée de Terre française est déployée depuis la fin-février 1986. Equipée du système d’arme Hawk modernisé, elle est placée en alerte Action permanente, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avec ses deux radars de veille et ses deux pelotons de tir, elle scrute le ciel sans relâche, elle est capable de tirer sans délai. Sur leurs rampes, ses missiles Hawk sont prêts au tir et peuvent aller intercepter tout avion assaillant à plus de 30 kilomètres de distance.
C’est une équipe d’artilleurs sol-air du 403° régiment d’artillerie, venus de Chaumont, qui opère dans le Centre de veille et de conduite de tir de la batterie. Commandée par le lieutenant AZNAR, elle est composée de soldats de métier : ce sont l’adjudant TEDESCO, assistant de l’officier de tir, les maréchaux des logis HAEN et PUNTEL, opérateurs de peloton de tir et le brigadier-chef LAVILLE, exploitant du radar de surveillance à basse altitude. Ils sont à leur poste depuis trois heures du matin, leur relève est prévue dans quelques minutes.
Soudain le radar Centaure de la CETAC détecte une piste inconnue. Située à une centaine de kilomètres au nord-ouest, celle-ci évolue de façon suspecte, volant à très grande vitesse à moyenne altitude. Peu après, son écho radar est aussi observé par la batterie Hawk. Conformément aux procédures, le chef-contrôleur et son adjoint cherchent à identifier cet arrivant inattendu et qui pourrait être dangereux.
À 6h57, le chef-contrôleur autorise la batterie Hawk à pointer ses radars de tir en direction de l’adversaire potentiel : ceux-ci s’accrochent aussitôt sur lui. La batterie sol-air fournit alors des renseignements précis sur cette piste : absence de réponse IFF confirmée, vitesse importante : 1.000 km/heure, altitude : 4.000 mètres, en diminution, route orientée vers N’Djaména, appareil unique, se trouvant à portée de tir du Hawk.
Le doute pèse de moins en moins sur les intentions de cet avion qui se rapproche du Tchad : la CETAC l’interroge de nouveau par l’IFF et sur les fréquences radio aéronautiques : pas de réponse. Selon les critères qui ont été préalablement fixés, l’hostilité de l’appareil devient évidente.
Il est presque 7 heures. Après avoir fait déclencher l’alerte au sol par des sirènes, le lieutenant DUHAYON prévient ses autorités qu’il a décidé de faire tirer l’artillerie sol-air.
Dès que l’assaillant franchit la frontière tchadienne située à une douzaine de kilomètres de la capitale, l’ordre d’interception est donné à la batterie Hawk. Dans son centre de contrôle, le lieutenant AZNAR fait immédiatement procéder au tir. Un missile Hawk est lancé et il détruit peu après l’appareil ennemi. Le bombardement de N’Djaména vient d’être évité de justesse.
En effet, par l’examen de ses débris, l’agresseur est facile à identifier : il s’agissait d’un bombardier de l’armée libyenne, du type Tupolev 22, biréacteur d’origine soviétique. Ses 4 bombes de 1.500 Kg n’ont pas pu exploser. Ses trois membres d’équipage ont péri carbonisés.
Ce fait d’armes est exceptionnel et unique dans les armées françaises depuis 1945. C’est un succès incontestable de la Défense aérienne de l’opération Epervier. Il vient d’être obtenu par l’artillerie sol-air, loin de la métropole, dans des conditions physiques et morales souvent éprouvantes.
Qu’ils appartiennent à l’Armée de l’Air ou à l’Armée de terre, ceux qui y ont contribué ont ainsi fait la preuve de leur motivation, de leur cohésion et de compétences professionnelles éminentes. Ils méritent donc que l’on s’en souvienne.








