Présentation du dossier 32 « Face aux ruptures, être prêt. »
Les lignes qui suivent visent à replacer l’article que vous allez lire dans le cadre général du prochain dossier du Cercle Maréchal Foch, « Face aux ruptures, être prêt ».
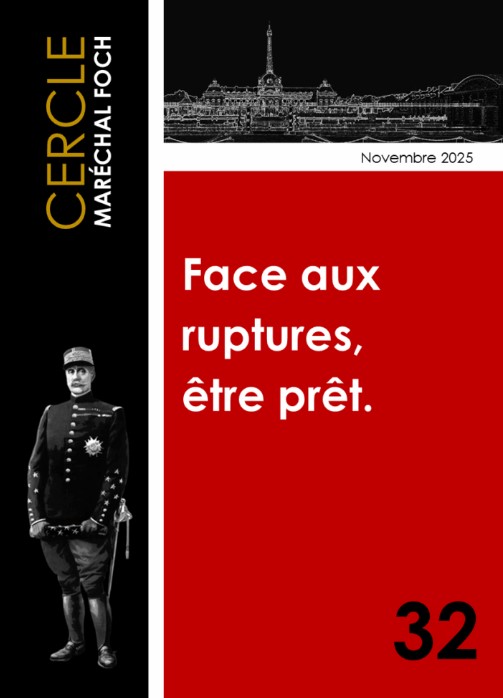 En effet, début 2025, le Cercle Maréchal Foch diffusait via THEATRUM BELLI son dossier de réflexion n° 31 « Le temps des ruptures ». S’appuyant sur le vote récent de la loi de programmation militaire 2024-30, le dossier prenait acte des nouvelles formes de conflictualité, du retour de la force désinhibée comme composante des relations interétatiques, du choc culturel que le retour de la guerre en Europe orientale constituait pour les populations « apaisées » de l’Union européenne, vivant dans un espace sans frontières, sans ennemi, sans idéologie collective…). On y évoquait les enjeux nationaux et internationaux, les défis technologiques et capacitaires, les questionnements éthiques et moraux qui découlaient de ce « changement d’époque ».
En effet, début 2025, le Cercle Maréchal Foch diffusait via THEATRUM BELLI son dossier de réflexion n° 31 « Le temps des ruptures ». S’appuyant sur le vote récent de la loi de programmation militaire 2024-30, le dossier prenait acte des nouvelles formes de conflictualité, du retour de la force désinhibée comme composante des relations interétatiques, du choc culturel que le retour de la guerre en Europe orientale constituait pour les populations « apaisées » de l’Union européenne, vivant dans un espace sans frontières, sans ennemi, sans idéologie collective…). On y évoquait les enjeux nationaux et internationaux, les défis technologiques et capacitaires, les questionnements éthiques et moraux qui découlaient de ce « changement d’époque ».
Un nouveau dossier, n° 32, est en cours de rédaction, intitulé « Face aux ruptures, être prêt ». Sans empiéter sur le rôle des organismes officiels et s’inspirant de la version 2025 de la revue nationale stratégique, il vise à dégager des principes généraux ou des orientations plus techniques qui pourraient soutenir les réflexions de tous ceux que le sujet de la défense nationale, dans le cadre européen, intéresse et, aujourd’hui, préoccupe. Ce dossier se refuse à un pessimisme qui encombre souvent les analyses de la situation actuelle et, en contrepoint de ce pessimisme du chemin à parcourir, entend mettre en avant un optimisme d’action et du but atteignable. Il entend cependant rester lucide et réaliste en s’appuyant sur l’expérience du passé, lointain comme plus récent…
Les allusions à « l’entre-deux guerres » étant nombreuses aujourd’hui, la première partie du dossier regroupera quelques éclairages sur les années 1935-1940. Il ne s’agit pas réécrire « L’étrange défaite » sans le talent de Marc Bloch, mais de choisir dans les prémices de la catastrophe de 1940 quelques instants où, avec le recul, il paraît incompréhensible qu’un voyant rouge ne se soit pas allumé sur le tableau de bord national, ou plutôt, s’étant allumé, pourquoi il fut si difficile de se préparer à l’épreuve qui s’annonçait.
Plus près de nous, la deuxième partie fait appel directement à nos rédacteurs, tous acteurs de la fin de guerre froide et de « la guerre mondiale de la France » pour reprendre le titre d’un livre récent de Michel Goya. À partir de la fin des années 1970, et surtout de 1990, les armées françaises (et l’on s’intéressera plus particulièrement à l’armée de Terre) ont été placées dans des situations opérationnelles imprévues, lointaines et exigeantes, dans un contexte de réduction de leurs moyens. De l’avis général, si les buts politiques furent loin d’être toujours atteints, les buts militaires le furent, avec plus ou moins de publicité, au prix d’efforts, y compris humains, souvent occultés. Cette partie récapitulera certains de ces efforts et permettra, nous l’espérons, de croire au « succès des armes de la France » pour les défis qui s’ouvrent désormais à nos armées.
La troisième partie se lancera dans l’exercice de la prévision dont on sait la difficulté, surtout, pour reprendre la boutade célèbre, lorsqu’elle traite de l’avenir. Il s’agira en fait d’un exercice de conviction de la part de rédacteurs qui, forts de leur expérience passée mais également de leur enracinement dans les réalités du moment, mettront sur la table « de la nourriture pour l’esprit », sans obligation de consommer !
Innovation majeure par rapport aux dossiers précédents, nous avons choisi de ne pas attendre d’avoir réuni l’ensemble des contributions de ce dossier n° 32 pour les mettre à la disposition de nos lecteurs. Elles seront publiées par THEATRUM BELLI au fur et à mesure de leur disponibilité, avant d’être réunies sous une forme complète. Vous trouverez donc ce rappel du but général et de l’articulation du dossier en tête de chaque publication, accompagné de l’indication de la partie à laquelle elle se rattache.
La Revue nationale stratégique, actualisée en juillet 2025, précise que la dissuasion nucléaire française doit être épaulée par des forces conventionnelles robustes, auxquelles est confié un rôle de « fil déclencheur », par allusion aux techniques de piégeage. A l’heure où dans les Pays Baltes, des unités de l’armée de Terre stationnent et s’entraînent à moins d’une centaine de kilomètres des frontières de la Fédération de Russie, il n’est pas inutile de se remémorer ce qu’était, du temps de la Guerre froide la place de l’armée de Terre dans la stratégie nucléaire et notamment… l’adossement de la Première Armée à la dissuasion nucléaire.
Si le concept de guerre de haute intensité refait aujourd’hui son apparition dans le paysage stratégique français, notamment à la lumière de la guerre en Ukraine, il est évident qu’il ne nous ramène pas trente années en arrière en nous incitant à nous calquer sur le modèle d’organisation d’alors, qui répondait à une logique stratégique complètement dépassée de nos jours et qui ne correspond absolument plus à la situation actuelle. Cependant, à la lumière de la menace plus ou moins voilée, mais néanmoins récurrente, de mise en œuvre en Ukraine de frappes nucléaires dites tactiques par la Russie, la question se pose d’une réflexion sur une éventuelle réévaluation de la stratégie nucléaire nationale, en intégrant notamment au concept l’idée de l’épaulement de la dissuasion par la manœuvre conventionnelle. Cette idée correspond en tout point au rôle qui était dédié à la Première Armée durant la Guerre froide. Par ailleurs, quittant le domaine concret des concepts opérationnels pour celui de la théorie abstraite, force est de constater que cette idée avait, en son temps, été défendue par le général Beaufre1 lui-même.
Au temps de la Guerre froide, la Première Armée française…
La Première Armée regroupait l’ensemble des forces terrestres françaises appelées à être engagées sur le théâtre Centre Europe, en cas de conflit majeur entre les deux Blocs Est et Ouest, c’est-à-dire entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie (PAVA). Son engagement était couplé à celui de la Force Aérienne Tactique (FATAC) dont le PC pouvait d’ailleurs lui servir de PC de rechange, en cas de destruction du sien. Il s’agissait bien d’un engagement aéroterrestre, et nullement d’un engagement uniquement terrestre. En plus de sa casquette de FATAC, le général aviateur concerné portait le titre, donc le képi, d’adjoint au général commandant la Première Armée.
Celle-ci se composait de trois corps d’armée (CA), stationnés en temps de paix dans le quart Nord Est de la France pour deux d’entre eux, et en Allemagne fédérale pour un autre. Ces trois CA alignaient au total six divisions blindées (DB), deux divisions d’infanterie motorisées (DI), et deux divisions légères blindées mises sur pied par les Écoles (DLBE). A cet ensemble, il convient d’ajouter les éléments organiques, peu nombreux au niveau de l’Armée (des systèmes de communication, la totalité des moyens de défense sol air haute altitude et un régiment de recherche profonde), mais beaucoup plus étoffés au niveau des CA, ainsi que trois brigades logistiques. Ces moyens n’avaient pas d’autre hypothèse d’emploi que l’engagement majeur en Centre Europe.
La Force d’Action Rapide (FAR), mise sur pied en 1984, comprenait, quant à elle, cinq divisions qui, à côté d’autres hypothèses d’emploi, notamment outre-mer, pouvaient se trouver placées sous le commandement de la Première Armée, en cas d’engagement majeur. Dans cette hypothèse, la 11e Division Parachutiste recevait un rôle très particulier consistant à « assurer la liberté d’action des liaisons gouvernementales2 à Paris et en région parisienne ».
Dès lors que la Première Armée s’engageait « tous moyens réunis », cet ensemble représentait une force de l’ordre de plus de 200 000 hommes, 1 500 chars, 400 hélicoptères et 500 pièces d’artillerie, c’est-à-dire, aux moyens feux près, une force analogue à celle déployée aujourd’hui par chacun des deux adversaires en Ukraine.
Les missions de la Première Armée.
Plutôt que de missions au pluriel, il conviendrait mieux de parler d’une seule mission à deux volets, puisqu’il ne s’agissait pas d’exécuter soit l’une, soit l’autre, mais bien, les deux simultanément, à savoir s’opposer à une agression dans le cadre de l’Alliance, tout en participant à la dissuasion nationale.
Avant de poursuivre, il convient de s’arrêter sur une donnée peu connue de ce cadre général d’emploi, l’estimation de la menace soviétique par l’Alliance. Manifestement, elle a fait l’objet d’une réelle surévaluation. Un indice, en 1980, aurait pu permettre une meilleure estimation de la menace, lorsqu’en août, le Kremlin n’a pas utilisé ses moyens militaires pour réprimer l’éclosion du syndicat catholique Solidarnosc en Pologne. Il est apparu plus tard, qu’engagée en Afghanistan, l’armée soviétique ne disposait pas de moyens suffisamment solides pour ouvrir un second théâtre. Or, cet engagement afghan ne concernait qu’un effectif de 100 000 hommes, certes, relevables. Par ailleurs, il n’est pas du tout impensable que le Pentagone ait sciemment « grossi » l’ampleur de la menace pour obtenir du Congrès le vote des budgets qu’il demandait.
S’opposer à une agression.
Le premier volet de la mission de la Première Armée se place dans le cadre de la mission des forces de l’Alliance atlantique en Centre Europe : s’opposer à une agression du Pacte de Varsovie.
En 1966, le général de Gaulle décidait de retirer les armées françaises du commandement intégré de l’OTAN. La France demeurait évidemment membre de l’Alliance, mais ses moyens militaires n’étaient plus déployés en premier échelon, à hauteur du Rideau de Fer dans un « créneau » spécifique. Cependant, si l’engagement des armées françaises n’était plus automatique, il était néanmoins régi par l’application d’accords d’état-major. En 1967, les accords Ailleret-Lemnitzer, passés entre le chef d’état-major des armées français et le commandant allié suprême en Europe (SACEUR), systématiquement américain, en arrêtaient les principes. Ils étaient complétés par deux accords de portée générale, passés entre le commandant de la Première Armée et le CINCENT3 (accords Valentin-Lemnitzer en 1972 et Biard-Schulz en 1980) qui en fixaient les modalités.
Ces accords prévoyaient en outre la mise en place permanente par la France d’une forte mission militaire permanente à Brunssum (poste de commandement de l’OTAN), mission sous les ordres d’un général de corps d’armée, relevant du CEMA, mais ayant également une liaison fonctionnelle avec Strasbourg, où l’état-major de la Première Armée était implanté en temps de paix. La liaison avec les groupes d’armées avait été déconcentrée auprès des EM de CA. Que ce soit au niveau de la Première Armée ou à l’échelon subordonné des CA, la liaison interalliée était quasi hebdomadaire.
C’est ainsi que, sur décision nationale, la Première Armée, comme la FATAC, pouvaient être placées sous le contrôle opérationnel (OPCON) du CINCENT, pour exécuter des missions fixées par ce dernier4, et agréées par les autorités nationales, c’est-à-dire le CEMA, devenu CEMGA qui conservait le « commandement », l’OPCOM (commandement opérationnel), sur l’ensemble des moyens militaires français.
La Première Armée devenait ainsi une réserve du théâtre Centre Europe. En fait, elle constituait la seule réserve crédible, car la seconde force de réserve était constituée par le 3e CA américain, stationné aux États-Unis et dont l’acheminement en Europe nécessitait un délai d’un mois, une durée peu compatible avec la notion d’attaque brusquée du Pacte, qui avait cours à l’époque.
Il faut préciser que les commandements alliés subordonnés à CINCENT, Groupes d’armées ou Corps d’armée5, ne disposaient eux-mêmes que de peu de réserves. Celles-ci leur étaient pourtant nécessaires pour pouvoir, le cas échéant, conduire des contre-attaques d’ampleur limitée et rétablir ainsi la cohérence de leur dispositif sans attendre que la situation soit compromise au point de justifier l’engagement d’une force telle que la Première Armée. Ils étaient donc enclins à vouloir disposer d’un « droit de tirage » sur les forces françaises et engager une division ou un corps d’armée, en fonction des besoins liés au déroulement de la bataille et de ses aléas. Mais cette possibilité ne leur fut jamais accordée, compte tenu du second volet de la mission de la Première Armée.
La participation à la dissuasion nationale.
Ce second volet de la mission de la Première Armée prenait place dans le cadre de la stratégie nationale de dissuasion. Plus précisément, dans celui du rétablissement du processus de dissuasion, puisque, dès lors qu’une offensive des forces du PAVA aurait menacé notre territoire, cette situation aurait signifié un échec – provisoire – de cette stratégie et, partant, de la dissuasion.
L’engagement de la Première Armée constituait le premier acte de ce processus. Acte majeur signifiant la volonté française de « ne pas subir », il était primordial qu’il fût bien compris en ce sens par l’adversaire.
Si la contre-attaque de la Première Armée réussissait, si l’offensive ennemie se trouvait bloquée au moins temporairement, le résultat militaire attendu pour la manœuvre de l’Alliance était atteint. Pour les autorités nationales (et également pour les Alliés), ce succès signifiait un gain de délais et le retour à l’action politique.
Vient alors le facteur fondamental : qu’il y ait réussite ou échec, l’adversaire devait être convaincu que, s’il poursuivait ou relançait son offensive, la France n’aurait pas d’autre recours que de passer au deuxième stade du processus, à savoir, la décision du chef de l’État de la mise en œuvre du feu nucléaire préstratégique (initialement très mal nommé « tactique »). Pour qu’il n’y ait aucun doute à ce sujet, il était essentiel que l’ensemble des moyens militaires classiques dont disposait la France aient été engagés, et que l’accès au territoire national se trouve ainsi libre et ouvert.
Il ne faut cependant jamais perdre de vue l’aspect fondamental de ce processus. En aucun cas, il ne pouvait s’agir pour le pouvoir politique national d’asseoir sa décision d’emploi sur des critères opérationnels, comme par exemple, le rétablissement d’une situation tactique compromise sur le théâtre Centre Europe. Le seul critère devant et pouvant motiver la décision d’emploi du feu nucléaire préstratégique par le seul président de la République, résidait dans son appréciation personnelle relative au degré de mise en cause ou non des intérêts vitaux de la Nation.
C’est pour cet ensemble de raisons que l’engagement de l’ensemble Première Armée/ FATAC devait être massif, et ne pas s’effectuer à grande distance des frontières nationales. En planification, il avait été arrêté deux lignes au-delà desquelles la Première Armée ne pouvait « s’aventurer » : la ligne RDM (Rotterdam–Dortmund–Munich) dans un cadre interallié ou, de manière plus restrictive, la ligne ARN (Anvers–Rhin–Nuremberg) dans un cadre national.
Même aujourd’hui, il est essentiel d’insister sur un point qui n’a pas toujours été bien compris à l’époque : l’engagement isolé de telle ou telle grande unité française, loin de nos frontières, n’aurait revêtu strictement aucun sens au regard de notre stratégie nationale de dissuasion, et c’est pourquoi, cette option n’a jamais été envisagée … au grand dam des Alliés, d’ailleurs.
Ce concept d’emploi des forces françaises ne correspondait pas exactement aux souhaits des commandements de nos Alliés, qui se trouvaient engagés dans une autre logique, celle de la « Bataille de l’avant ». Ils l’avaient cependant bien compris, et intégré dans leurs raisonnements, en dépit des apparences.
C’est sur ces bases que les commandants successifs de la Première Armée ont toujours conduit leur action, de façon à satisfaire tout à la fois, les attentes de l’Alliance, et les impératifs de notre stratégie de dissuasion nationale.
Les réticences militaires
Il relève de l’euphémisme que d’affirmer que le commandement des armées françaises n’ait pas souscrit « d’amitié » à ce concept d’emploi des forces aéroterrestres. Pour plusieurs raisons, plus ou moins recevables, d’ailleurs. Indiscutablement, la première est que ce concept s’adressait pour son exécution à une génération d’officiers généraux parvenus aux postes sommitaux au terme d’une carrière qui les avait vu engagés dans des conflits incessants durant plus de 20 ans. La génération des généraux de corps d’armée en activité durant les années 60 était en totalité sortie de Saint-Cyr avant 1939 et avait connu une période ininterrompue de conflits jusqu’en 1962. Un exemple anecdotique illustre bien l’état d’esprit qui régnait à l’époque. En prenant connaissance des travaux du général Poirier (qui n’était pas encore général), un des généraux de l’apocalypse dont les réflexions ont notamment porté sur le concept d’ultime avertissement, le général Hublot, premier commandant de la Première Armée de 1969 à 1972, s’est exclamé « Cet homme est un fou dangereux. Il faut l’interner ». On a connu des appropriations de concepts nouveaux plus enflammées !
Par ailleurs, au sein même de l’institution militaire, l’amalgame a rapidement été effectué entre la décision du chef de l’État de recourir à la dissuasion nucléaire pour asseoir la défense de la France6 et les sentiments assez mitigés dont la même institution faisait preuve à son égard. Son fidèle ministre des Armées, Pierre Messmer, n’a jamais usé de beaucoup de souplesse pour convertir le commandement au nouveau concept7. Ceci peut expliquer, sans les justifier, certaines dérives d’exécution. La principale s’est manifestée lorsque les moyens nucléaires dits « tactiques » (système d’armes Pluton) sont arrivés en dotation au sein du corps de bataille. Comme ils relevaient de l’autorité des commandants de corps d’armée, puisque placés au sein de leurs éléments organiques, un certain nombre d’entre eux ont subordonné le déroulement de leur manœuvre conventionnelle à l’existence de cette capacité nucléaire, même s’ils avaient parfaitement intégré le fait qu’ils ne possédaient aucune responsabilité relative à leur décision d’emploi.
Alors qu’il n’existait rigoureusement aucune relation de cause à effet entre la frappe préstratégique, unique, massive et non répétitive, il n’était pas rare, lors des exercices des CA, de constater que la manœuvre en cours consistait en un « façonnage » de l’ennemi, de manière à le concentrer pour qu’il constitue un objectif de choix pour la « séquence nucléaire » qui clôturait ce type d’exercice. Or le but réel de cette « séquence nucléaire » visait simplement à vérifier le bon fonctionnement et l’absolue discrétion de la chaîne de commandement spécifique nucléaire, depuis les plus hautes instances, jusqu’aux échelons d’exécution. Le général Vanbremeersch qui a exercé le commandement de la Première Armée après avoir tenu les fonctions de chef d’état-major particulier du président de la République, donc au cœur du système nucléaire français, a bien tenté de ramener ses subordonnés directs à une meilleure appréciation de leur rôle ; il s’est heurté à un mur d’incompréhension.
Tant et si bien que, lorsque le système d’armes devant relever le Pluton a été conçu (système Hadès), il a été décidé d’en retirer la mise en œuvre à la Première Armées, et d’en regrouper les moyens en une grande unité spécifique, la division Hadès, directement subordonnée au CEMA. Mais le paysage stratégique international avait radicalement évolué avec la disparition de l’Union soviétique et la dissolution du Pacte de Varsovie. Aussi ce nouveau système d’armes n’a jamais été opérationnel. Avec sa disparition, concomitante avec la dissolution de la Première Armée, l’armée de terre perdait sa capacité nucléaire et, avec elle, toute raison d’être de la notion d’épaulement de la dissuasion à la manœuvre conventionnelle.
Jusqu’à quand ?
En effet, on lit au paragraphe 124 de la Revue nationale stratégique, version 2025 : « Les fondamentaux de la doctrine de dissuasion française restent parfaitement adaptés. L’évolution de l’environnement stratégique appelle toutefois à s’assurer de la pertinence des choix capacitaires qui sont faits pour armer les forces stratégiques ainsi que le bon dimensionnement de leur épaulement conventionnel ».
C’est dans cette perspective que le rappel historique qui précède constitue une référence en ce sens que « l’épaulement du nucléaire au conventionnel » ne valait, au niveau politique, que par le caractère inéluctable de l’enchaînement conduisant au paroxysme nucléaire, symbolisé par la fameuse réplique du Général de Gaulle à l’ambassadeur d’URSS qui lui faisait remarquer que Paris était à portée des missiles soviétiques : « Eh bien, Monsieur l’Ambassadeur, nous mourrons ensemble ! ». L’idée n’était pas de gagner une bataille en Allemagne ou d’y contribuer, mais de dissuader l’URSS de l’engager en entraînant ses alliés du pacte de Varsovie avec elle.
Même liée à l’OTAN par les accords précités, la Première Armée française restait sous commandement national. Elle était positionnée à moins d’une étape du Tour de France de Strasbourg (pour reprendre une métrique gaullienne) avec, selon la vox populi interne aux armées, une capacité de combat « de haute intensité » qui ne dépassait pas quelques jours ; sa destruction probable8 ouvrait quasi immédiatement l’accès au territoire national et la boite de Pandore des « intérêts vitaux de la Nation », entraînant « l’ultime avertissement préstratégique », avant la seconde et dernière marche de l’escalade nucléaire.
Nul ne sait si cette « expérience de pensée » produisit des effets dans l’esprit des dirigeants soviétiques, et même de nos Alliés occidentaux…
L’enjeu de la réévaluation annoncée en 2025 par la Revue nationale stratégique est bien de rétablir cet enchaînement, alors que les armées françaises sont désormais intégrées intimement dans le commandement et le dispositif de l’OTAN, et, pour leurs détachements les plus avancés, déployées à proximité des forces russes, à une « quinzaine d’étapes du Tour de France ».
NOTES :
- Le général Beaufre possédait une riche expérience opérationnelle, depuis la guerre du Rif où il a été grièvement blessé comme chef de section, jusqu’à Suez, trente ans plus tard, où il commandait la composante terrestre française. Il s’est également affirmé comme le penseur militaire qui a pu être considéré comme le « père » de la stratégie française. Dans le domaine de la stratégie nucléaire, il s’est nettement démarqué de la doxa du concept officiel français, en posant et explicitant un double postulat : il n’existe aucune contre-indication pour un État doté de faire partie d’un ensemble intégré de sécurité collective, et la stratégie de dissuasion n’est aucunement exclusive d’une stratégie d’action ; au contraire, même, leur adossement réciproque les gratifie. Les contempteurs du concept de dissuasion français, en interne même des armées, se sont parfois référé à ses écrits, … surtout d’ailleurs après sa disparition, survenue précocement, en 1975.
- Selon les termes du Plan Général d’Opérations (PGO) de la Première Armée.
- Commandant en chef du secteur Centre Europe, AFCENT (dont le PC se situait à Brunssum coiffait deux « groupes d’armées », en réalité des groupes de corps d’armée, CENTAG dont le PC était implanté à Heidelberg et NORTAG colocalisé avec le PC de la BAOR (British Army of the Rhine). Il y eut deux accords de portée générale, car si le premier planifiait l’engagement de la Première Armée tous moyens réunis sous l’OPCON (contrôle opérationnel), le second planifiait celui du 3e C.A, mis sur pied par la volonté du général Lagarde en 1979 sous OPCON de NORTAG.
- La planification retenait plusieurs hypothèses, soit le Première Armée tous moyens réunis, soit un des trois CA agissant sur une direction secondaire de la Première Armée sous OPCON d’un des deux groupes d’armées (soit le 3e CA US sous OPCON de NORTAG, soit le 2e C.A. sous OPCON de CENTAG.
- NORTAG engerbait les Ier et IIIe C A allemands ainsi que la BAOR correspondant à un CA. CENTAG regroupait le IIe CA allemand et les Ve et VIIe CA US ; soit un ensemble de six corps d’armée. Autant dire que la réserve fournie par la Première Armée à 3 CA était loin d’être négligeable.
- En réalité, les décisions relatives à l’accession par la France à la capacité nucléaire avaient été arrêtées par la Quatrième République, avant le retour « aux affaires » du général de Gaulle. Les décisions décisives ont été arrêtées par Pierre Mendès France en 1954, après Diên Biên Phu, et Guy Mollet, à l’issue de l’humiliation subie à Suez, en 1956. Même la date du premier tir expérimental avait été fixée par Félix Gaillard, en avril 1958. Au général de Gaulle, il revient le mérite d’avoir constitué les Force nucléaires stratégiques, de les avoir dotées de moyens et d’en avoir fait établir une doctrine sur la base du concept de la dissuasion du faible au fort.
- La Marine a connu les mêmes affres que l’armée de Terre. En 1972, le chef d’état-major de la Marine, l’amiral Patou, pourtant « Français Libre » a démissionné avec éclat, car l’inscription de la réalisation du programme des SNLE dans la troisième Loi de programmation militaire devait porter un coup fatal au « Plan Bleu » conçu par l’amiral Nomy pour reconstituer une Flotte de surface extrêmement puissante à l’horizon de la décennie 1980.
- Certaines sources font référence à des documents soviétiques exploités après 1990, selon lesquels les dirigeants de l’URSS prévoyaient une utilisation d’emblée et massive des armes nucléaires « tactiques » pour prendre l’OTAN de vitesse (voir Bruno Tertrais, « Pax Atomica », Odile Jacob, page 67).






