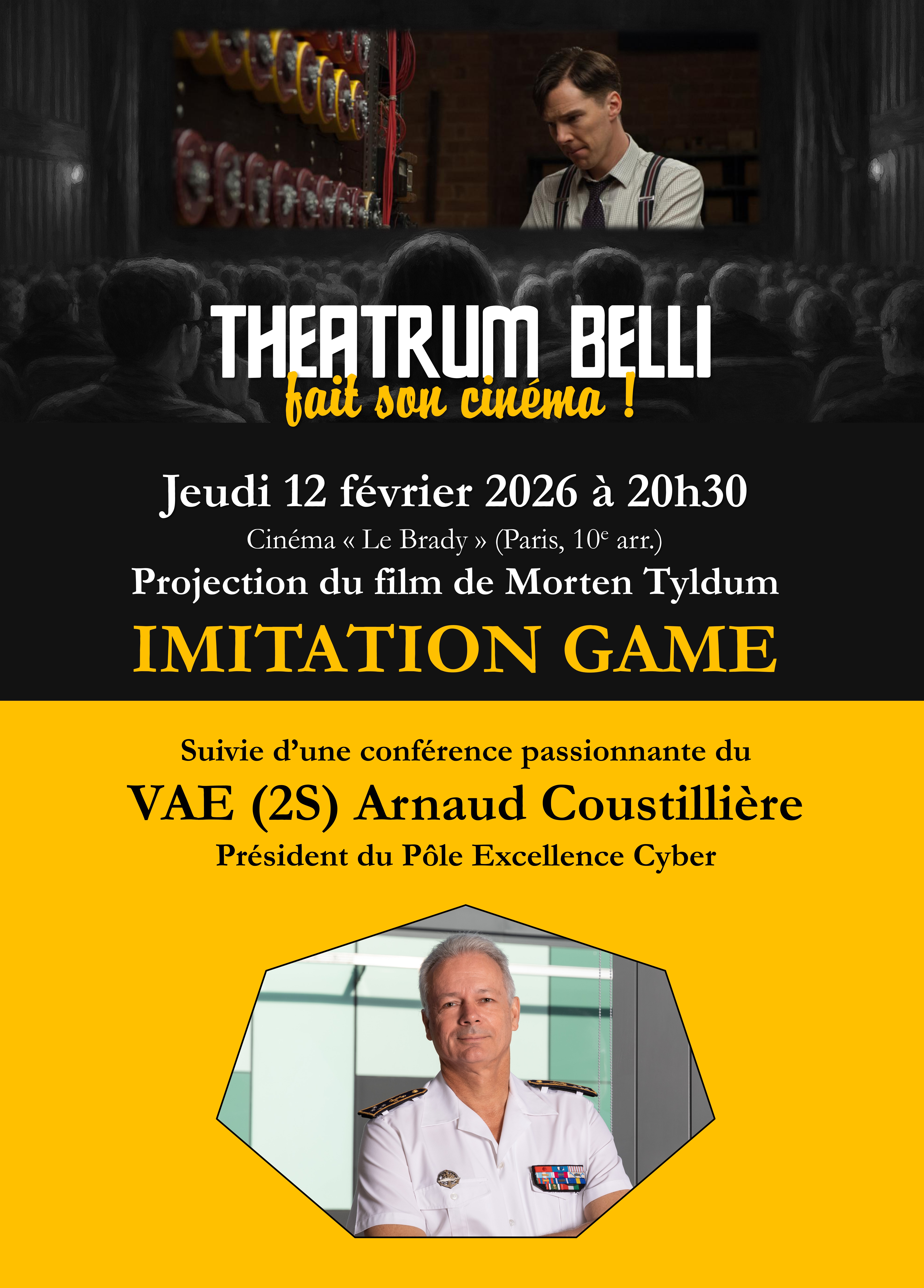Depuis 2022, le « fait nucléaire » s’est rappelé régulièrement tant aux acteurs des relations internationales qu’aux opinions publiques : déclarations et gesticulations russes, poursuite des programmes balistiques nord-coréens, bref affrontement indo-pakistanais « à l’ombre de la bombe », opérations américano-israéliennes en Iran, débat sur l’extension de la dissuasion française à l’ensemble de l’Europe, en lien avec le Royaume Uni…
Les 170 pages de « Pax atomica ? », hors notes et annexes, de Bruno Tertrais, édité en 2024 chez Odile Jacob, viennent à point pour faire un bilan des « Théorie, pratique et limites de la dissuasion », au moment où la Revue nationale stratégique actualisée en juillet 2025 vient réaffirmer la place centrale de la dissuasion (les éléments de la RNS 2025 en traitant figurent en annexe ci-dessous).
On ne présente plus Bruno Tertrais, acteur diplomatique et chercheur dont la réflexion porte depuis plus de trente ans sur le fait nucléaire et la dissuasion française.
* * *
Le monde est-il entré aujourd’hui dans un nouvel âge nucléaire ? Telle est la question posée d’emblée, qui souligne à quel point l’expansion du cyberespace, l’avènement de l’intelligence artificielle et l’informatique quantique pourraient entraîner des répercussions sur la dissuasion.
Pour autant, les fondamentaux en paraissent tout à fait pérennes. À la fin du XXe siècle l’accès de l’Inde et du Pakistan au statut de puissances nucléaires a mis fin à la brève période de stabilisation qui suivit la fin de la guerre froide, et désormais le monde présente de grandes similitudes avec celui des années 1960 : crise avec la Russie, montée en puissance de la Chine, absence quasi totale d’instrument de maîtrise des armements, crainte d’une vague de prolifération, intérêt marqué pour les options nucléaires limités ou les défenses antimissiles balistiques. À cela s’ajoute le « nationalisme nucléaire » qui allie discours et posture politique de certains acteurs valorisant la possession de leur arsenal nucléaire. La dissuasion doit continuer de caractériser les politiques nucléaires et, au fil de dix chapitres très documentées, Bruno Tertrais s’attache à en analyser les théorie, pratique et limites…
Sans qu’elles soient explicites dans la table des matières, trois parties peuvent être distinguées dans cet essai : un rappel de la genèse et de la pratique de la dissuasion depuis les débuts de la guerre froide (chapitres 1 à 4), une interrogation sur son efficacité dans l’établissement de la « longue paix » entre les grandes puissances (chapitres 5 et 6), enfin quelques réflexions prospectives, prudentes comme il se doit (chapitres 7 à 10).
1 – Qu’est-ce que la dissuasion
Art plus qu’une science, la dissuasion est un processus psychologique visant à convaincre un acteur de s’abstenir de faire quelque chose. Ces fondements existent dans tous les domaines de l’activité humaine, au niveau individuel comme collectif et le nucléaire n’en a pas le monopole.
Dans tous les cas, choisir de dissuader suppose un minimum de rationalité de la part de l’adversaire potentiel, notamment sa capacité à évaluer les coûts et avantages de ses éventuelles actions, en lui fixant des limites à ces actions et en visualisant les risques associés au franchissement de ces limites.
Dans le domaine militaire, la dissuasion repose sur deux éléments : des capacités dont la crédibilité doit être démontrée et une volonté manifeste de les utiliser (ainsi certains commentateurs estiment que le recours à la force par la Russie à partir de 2014 trouve son origine dans la décision de Barak Obama de ne pas réagir à d’un franchissement de ligne rouge en Syrie l’année précédente). La dissuasion passe donc avant tout par la communication et son efficacité implique un dosage subtil de clarté et d’ambiguïté calculée.
Cette ambiguïté est d’autant plus nécessaire que la dissuasion est de plus en plus « multi-domaines » ou « inter-domaines », étendue aux nouveaux champs de conflictualité, ce qui renforce l’approche du « faible » au « fort »…
Bruno Tertrais établit une taxonomie détaillée de la dissuasion établie principalement sur la base des travaux théoriques des chercheurs américains de la Guerre froide (lui-même coopéra brièvement avec la Rand Corporation dans les années 1990). Le point à en retenir est qu’aujourd’hui plus aucune doctrine nucléaire déclarée ne prévoit l’utilisation des armes nucléaires en tant qu’instrument de combat.
Il s’étend plus particulièrement sur les dissuasions « centrale » (face-à-face de deux protagonistes majeurs) et « élargie » (jeu à trois protagonistes ou plus). C’est dans le cadre complexe de cette dernière (qui fut l’objet de sa thèse de doctorat) que se pose les questions de la crédibilité de la protection apportée à des Alliés, de la définition des « intérêts vitaux » d’une communauté d’Alliés (OTAN) ou d’un ensemble politique supranational (UE), du concept de « fil déclencheur », de forces conjointes et de réassurance.
La spécificité de la dissuasion nucléaire tient au souvenir de Hiroshima, renforcé par le développement des armes thermonucléaires : l’aura de terreur des radiations vient s’ajouter à l’effet de la puissance destructrice et doit produire dans l’esprit de l’adversaire la peur d’attaquer. Cette dissuasion militaire ne peut cependant jouer qu’entre États et son essence est d’être un dialogue entre chefs d’État et de gouvernement.
Dans ce dialogue, un point crucial est le seuil déclaré de première utilisation, forme de ligne rouge, qui dans la plupart de situations actuelles (OTAN, déclaration de Vilnius en 2023) reste vague, et élargit le seuil au recours par l’adversaire d’attaques chimiques, biologiques ou cybernétiques massives.
Toutefois, la plupart des États dotés ont restreint les circonstances dans lesquelles ils utiliseraient des armes nucléaires, avec à l’extrême la déclaration de doctrine de « non-emploi en premier », et la seule raison de posséder des armes nucléaires devient alors de dissuader de l’utilisation du nucléaire, contenant ainsi les conflits en-dessous du seuil.
2 – Opérationnaliser la dissuasion : la stratégie nucléaire
Après avoir rappelé que la politique nucléaire comporte plusieurs volets : la stratégie nucléaire (mise en œuvre de la dissuasion), la maîtrise des armements et le désarmement, la non-prolifération, c’est sur le domaine stratégique que Bruno Tertrais s’étend.
Pour rendre la dissuasion opérationnelle (doctrine, plans et capacités techniques), il faut élaborer une stratégie nucléaire. D’emblée, il est souligné que bien qu’utiles comme outils de réflexion et de planification, les stratégies nucléaires élaborées pendant la guerre froide ont développé des raffinements excessifs, souvent déconnectés tant des réalités politiques et budgétaires que des effets attendus d’armes de plus en plus puissantes et sophistiquées.
La stratégie nucléaire se décline par les déclarations publiques (comme « le discours nucléaire » que prononce chaque président français pendant son mandat), par la planification militaire des engagements (avec des exercices-démonstrations réguliers) et l’acquisition des forces.
Dans la mesure où l’emploi en premier ne fait pas partie de la doctrine, la stratégie repose sur la menace d’escalade, qui en est alors le concept le plus important.
Qu’il s’agisse de répondre à une attaque non nucléaire sur son territoire ou celui d’un allié, d’éviter l’emploi du nucléaire par l’adversaire au cours d’un conflit ou d’éviter par une frappe préventive une attaque nucléaire contre ses forces nucléaires ou son territoire, c’est la menace crédible d’escalade qui constitue bien le cœur de la dissuasion nucléaire.
Que l’escalade soit délibérée ou involontaire importe relativement peu. Sa menace vise avant tout à maintenir tout conflit entre puissances nucléaires au plus bas niveau possible, car personne n’est capable de dire quelle forme prendrait un affrontement nucléaire effectif, car personne n’a jamais su comment, pendant la guerre froide, l’engagement des armes nucléaires aurait été conduit et poursuivi.
La logique de l’escalade suppose un seuil de son déclenchement. Si le marquant du seuil est évidement physique, visualisable par des effets sur le terrain du conflit, sa concrétisation en déclencheur d’escalade dépendra toujours beaucoup du contexte psychologique des acteurs en présence.
Tout au long de la guerre froide, les théoriciens de la dissuasion, notamment américains, se sont opposés sur la sophistication à donner à la stratégie nucléaire et au volume des forces. Tous se sont cependant rejoint sur l’idée qu’une capacité de frappe en second crédible, grâce aux SNLE, devait assurer la stabilité entre les deux « joueurs » du moment et rendre peu réaliste l’hypothèse d’une escalade contrôlée.
En comparaison avec l’époque de la guerre froide, les planifications nucléaires se sont diversifiées et les possibilités techniques se sont multipliées, offrant des options d’escalade non nucléaires plus importantes. En tout état de cause, l’hypothèse d’une bataille nucléaire graduelle et prolongée semble désormais exclue par les doctrines de la plupart de États dotés (si tant est qu’elle leur soit accessible). L’effet militaire d’un emploi limité de l’arme nucléaire serait plutôt fondamentalement subordonné à la réalisation d’un objectif politique : le rétablissement de la dissuasion et la fin du conflit.
3 – Planification, acquisition, posture des forces
La stratégie nucléaire se décline ensuite en planification sous la forme d’un ciblage, puis de l’organisation des forces en vue d’atteindre ces cibles. Il s’agit de déterminer quels sont les objectifs dont la destruction produiront des dégâts suffisamment significatifs et du nombre d’armes nécessaires.
Contrairement à une idée répandue, le ciblage « anti-démographique » n’a jamais vraiment été retenu par les Occidentaux, tant pour des raisons éthiques que psychologiques. De même, à contre-courant des déclarations diplomatiques, il est techniquement incorrect d’affirmer que « tout emploi » d’armes nucléaires aurait des conséquences humanitaires catastrophiques : une certaine prudence reste de mise quant à la connaissance exacte des effets exacts d’armes nucléaires hors conditions d’essais. Personne ne peut affirmer que ces effets sont totalement prévisibles, même s’ils le sont beaucoup plus qu’au temps de la guerre froide du fait des progrès considérables de la modélisation informatique (Les effets des armes américaines de 1945 sur les villes japonaises, s’ils font partie du contexte psychologique de la décision nucléaire, ne sont plus représentatifs de ce que serait une frappe sur des « cibles militaires » dans les conditions techniques actuelles).
L’évolution du ciblage vers des objectifs autres que démographiques est venue renforcer la notion de « suffisance » dans les politiques d’acquisition (qui portent sur les moyens nucléaires, les systèmes de commandement et de communication, les moyens d’alerte et d’avertissement).
En effet, viser la supériorité quantitative ne présente plus beaucoup de sens sauf à s’inscrire dans une optique de destruction des forces adverses, ou dans la volonté de domination psychologique, ou encore, paradoxalement, comme une incitation à la maîtrise des armements.
4 – Calibrer la dissuasion : dilemmes et débats
Ces rappels de fondamentaux font également référence aux dilemmes, pour reprendre le terme choisi par Bruno Tertrais, que les acteurs de la stratégie nucléaire ont dû affronter, aboutissant souvent à des choix différents dans leur recherche du compromis optimal dans chaque alternative. Il cite successivement les couples : certitude/ambiguïté, transparence/opacité, crédibilité/tentation de l’emploi, vulnérabilité/protection, efficacité/sécurité, alerte/contrôle, concentration/invulnérabilité, réponse rapide/réponse différée, riposte écrasante/réponse limitée.
La brève histoire de l’ère atomique qui conclut cette énumération démontre qu’en fin de compte et en dépit de leur sophistication, ces concepts restaient largement théoriques et n’apportaient aucune certitude sur la façon dont une crise nucléaire pourrait être gérée, notamment en raison des perceptions erronées des différents acteurs. Les postures déclaratoires, qui sont au cœur de la politique nucléaire, ne préjugent en effet en rien de la réalité des actions conduites par tel ou tel acteur. La « menace nucléaire » russe depuis 2022 est l’exemple le plus récent et actuel de cet écart entre déclaration et action.
Bruno Tertrais met également en lumière les débats qui traversent l’ère atomique en posant deux questions :
- La dissuasion est-elle éthique et légale ? Sur l’éthique, force est de constater que la précision et la limitation de la puissance des armes nucléaires donnent des arguments à ceux qui les considèrent comme compatibles avec le droit international de la guerre ; quant à la légalité, aucune instance compétence n’a formulé un avis négatif sur le sujet.
- L’autre question concerne la portée de la dissuasion en réponse à une attaque non nucléaire. Le recours au nucléaire face à une attaque conventionnelle, chimique, biologique ou cybernétique aurait sans doute pour effet d’accentuer le débat précédent tout en constituant une incitation à la prolifération…
5 – La dissuasion a-t-elle fonctionné ?
Bruno Tertrais estime très réducteur le raccourci, souvent employé en France, qui énonce que « l’arme nucléaire empêche la guerre ». Et ce d’autant que la dissuasion, affaire de perception par l’adversaire potentiel, ni ne se décrète, ni ne se démontre…
Toutefois, même souvent contestés, quelques indices existent pour appuyer la thèse d’un fonctionnement effectif de la dissuasion depuis l’entrée dans l’ère atomique : l’absence depuis 1945 de guerre entre grandes puissances, l’absence de conflit majeur entre pays disposant de l’arme nucléaire, la retenue adoptée par les États non nucléaires vis-à-vis des États dotés (l’exemple de la guerre des Malouines étant considéré comme hors du champ de la dissuasion).
Si la thèse de la « longue paix » qui régnerait dans le monde depuis 1945 se heurte à de nombreuses objections, notamment historiques, un certain consensus existe pour accorder un rôle aux armes nucléaires dans la moindre conflictualité entre grands pays, au titre de leur « pouvoir de restriction » dans les calculs stratégiques, et d’aucuns voient dans la dissuasion nucléaire une « forme de bien commun mondial » qui aurait « civilisé » les élites et exclu de leur rang les radicaux et les idéologues.
Si le recours à la guerre, à la conquête territoriale paraissait sorti du champ de la compétition géopolitique, sans doute les armes nucléaires y ont-elles contribué autant que l’effroi collectif né des expériences terribles des guerres de la première moitié du XXe siècle.
Reste maintenant à savoir si le comportement de la Russie en Ukraine ou de la Chine dans son environnement maritime marque la fin d’une époque ou simplement un dernier soubresaut d’une approche périmée des relations de puissance.
6 – À deux doigts de la catastrophe ?
Dressant l’inventaire des crises et incidents majeurs à caractère nucléaire de la période allant des années 1950 au début du XXIe siècle, Bruno Tertrais conteste la lecture pessimiste selon laquelle à plusieurs reprises le monde serait passé à deux doigts de la catastrophe. Dans les faits, les chefs d’État ou de gouvernement ont toujours reculé même si ce fut parfois presque au dernier moment, devant la terrible décision d’avoir recours à l’arme nucléaire.
Lors des crises, c’est une « tradition de non-emploi » qui s’est imposée très tôt, ne serait-ce que du fait que les protagonistes en présence se sont toujours gardés de mettre en cause les intérêt vitaux ou équivalents de leurs adversaires. Même lors de la crise de Cuba en 1962, le respect strict de part et d’autre des procédures et des règles d’engagement, dans des conditions extrêmes de tension, a prévenu tout risque de dérapage incontrôlé.
Quant aux incidents et fausses alertes qui auraient pu déboucher sur des déclenchements de riposte par erreur, force est de constater que les mécanismes de sûreté ont toujours fonctionné, et qu’ils fonctionnent aujourd’hui avec une bien plus grande efficacité qu’il y a une soixantaine d’années : un emploi du nucléaire par erreur ou par défaut de contrôle politique est désormais improbable.
7 – la dissuasion restera-t-telle efficace ?
Après ces rappels théoriques et historiques, Bruno Tertrais aborde la question de l’avenir et de l’efficacité de dissuasion pour maintenir la paix (sous-entendu « entre grandes puissances ») dans le contexte stratégique, politique et technologique de la première moitié du XXIe siècle et au-delà.
Le premier constat est que la dissuasion nucléaire est désormais un concept stratégique robuste et que la tradition de non-utilisation semble solide : les armes nucléaires n’ont plus d’autre fonction stratégique que la dissuasion. En Russie, en Corée du Nord, voire dans l’Amérique de l’administration Trump, les rodomontades nucléaires n’ont jamais eu un début de commencement d’une quelconque mise en œuvre technique, ne serait-ce que du fait que les grands exercices nucléaires des années 1980 ont démontré que la maîtrise d’une escalade nucléaire serait extrêmement difficile.
Même la mise au point, notamment en Asie, d’armes de « faible puissance », abusivement qualifiées de « tactiques », reste dans le domaine de la dissuasion.
Un autre constat est que le fait nucléaire a montré sa capacité d’adaptation. Mis au point face à l’Allemagne nazie, utilisé contre le Japon, l’arsenal nucléaire s’est mué en instrument de dissuasion de l’URSS dès les débuts de la guerre froide. Bien plus que les modèles stratégiques élaborés par ses théoriciens, la dissuasion semble avoir fonctionné du seul fait de la possession par l’adversaire d’un arsenal et de sa volonté apparente de l’utiliser pour faire valoir ses intérêts vitaux.
Un dernier constat est que rien ne prouve que, pour la défense de ces intérêts vitaux, un autre instrument militaire puisse se substituer totalement aux armes et à la dissuasion nucléaires, singulières non seulement par leurs effets physiques mais aussi par la terreur qui les entoure. Jamais une menace cybernétique, par exemple, n’atteindra ces niveaux d’efficacité matérielle et psychologique.
Il est donc probable que les fondements de la dissuasion, fixés dans les dernières décennies du XXe siècle, n’évolueront guère. Pour autant, il ne faut pas négliger de nouveaux risques qui pourrait rendre l’effet dissuasif des armes nucléaires plus difficile à atteindre.
Un premier risque tient à l’accroissement rapide des acteurs nucléaires qui rend les calculs stratégiques plus hasardeux. De plus, cette prolifération se déploie surtout en Asie avec des acteurs qui ne dispose pas encore — voire ne disposeront jamais — des capacités de frappe en second qui sont une des conditions de la dissuasion. Si l’invulnérabilité des SNLE est donnée pour garantie sur le très long terme, ces vecteurs sont d’une complexité inaccessible aux nouveaux États dotés. Or l’incapacité de frappe en second garantie est une incitation à la « frappe en premier ».
Un autre risque, surtout lié au développement des moyens balistiques de certains États nucléaires ou pas — notamment la Corée du Nord —, est le développement par les États-Unis d’un projet de défense anti-missile de leur territoire. Or, le fait de ne plus laisser leur territoire vulnérable serait un signal négatif vis-à-vis de leurs partenaires-adversaires nucléaires, principalement la Chine.
Un dernier risque mis en évidence est l’existence des nouvelles voies d’escalade non-nucléaires pouvant en fin de compte déboucher sur une décision d’emploi, donc d’échec de la dissuasion nucléaire : un inventaire à la Prévert énumère les missiles conventionnels à grandes portée et précision, les tactiques de zone grise, de guerre hybride, le développement rapide du cyberespace et de la militarisation de l’espace extra-atmosphérique, voire même les techniques de guerre d’information/désinformation par le biais des réseaux sociaux (l’impact de l’intelligence artificielle serait moins préoccupant car il se traduit à la fois par des risques et des avantages).
8 – Les limites de la dissuasion et l’hypothèse de l’échec
Les chapitres précédents ont rappelé les conditions d’une dissuasion efficace : capacité technique et volonté d’emploi pour défendre les intérêts vitaux. S’y ajoute une communication adéquate et une bonne compréhension mutuelle de la capacité et la volonté de l’autre partie, avec un risque de mauvaise appréciation de la nature et l’acuité de ses intérêts vitaux.
Dans la mesure où la dissuasion repose traditionnellement sur la « théorie des choix rationnels », sa première limite touche donc à la rationalité des décideurs et leur capacité d’évaluer les coûts et avantages de leurs choix. Or les neurosciences montrent que, surtout en situation de stress, les humains ne sont pas toujours rationnels, pour peu que confrontés à des émotions violentes ou à d’intenses conflits de choix, ils perdent le sens des réalités.
Au-delà de la question de la rationalité des choix se pose également celle de la propension à la prise de risque dans le cadre d’un système de raisonnement cohérent quoique irrationnel stricto sensu. Les hommes ou les régimes politiques autoritaires et fortement enclins à la prise de risques sont difficiles à dissuader. Bruno Tertrais cite toute une série de ces décisions raisonnables à leurs yeux mais proprement irrationnelles, depuis la remilitarisation de la Rhénanie en 1936 jusqu’à l’invasion de l’Ukraine en 2014, puis 2022, en passant par le blocus de Berlin-Ouest ou la volonté de Fidel Castro de voir les armes nucléaires mises effectivement en œuvre pendant la crise de 1962.
Or ce qui nous paraît irrationnel est en fait tout à fait rationnel pour « l’attaquant » dès lors que l’enjeu peut-être sa légitimité ou son existence.
L’asymétrie des enjeux est donc aujourd’hui au cœur des débats sur l’efficacité de la dissuasion, quelle qu’elle soit, et a fortiori, nucléaire. La crise ukrainienne l’a montré dès ses débuts en 2014.
En effet, certaines cultures contemporaines peuvent paraître peu réceptives à la menace de dissuasion par représailles, notamment celles, qui pour des raisons idéologiques ou spirituelles, valorisent le sacrifice suprême ou placent l’ensemble de leurs actions dans une approche existentielle. De ce point de vue, certaines dérives de l’islam ou les références religieuses et morales officielles en Russie laissent dire à certains que l’on ne peut pas dormir tranquille lorsqu’une puissance nucléaire se considère engagée dans une guerre sainte, car désormais ses valeurs immatérielles l’emportent sur ses intérêts et ceux de sa population : face à l’honneur, l’efficacité de la dissuasion est fragile !
L’avenir de la dissuasion occidentale passe donc par sa capacité à se confronter à des acteurs poursuivant par une série de décisions et d’engagements très rationnels de leur point de vue des objectifs irrationnels au regard des normes établies du droit international et de la morale.
D’où l’hypothèse de l’échec et le risque d’une escalade précoce, dont les archives ouvertes après 1990 montrent qu’ils sont l’enseignement majeur de la guerre froide. Un risque que Bruno Tertrais identifie prioritairement en Asie, pour peu que l’un des acteurs voit un enjeu existentiel dans sa confrontation avec d’autres protagonistes.
Ce risque paraît d’autant plus plausible que la culture nucléaire des décideurs s’éteint à chaque génération et que son entretien est de plus en plus difficile au fur et à mesure que l’on s’éloigne de 1945 et du souvenir des bombardements sur le Japon. L’absence depuis plusieurs décennies d’essais en conditions réelles est également un facteur d’oubli collectif. Aussi, si la dissuasion semble demeurer probable, dans ce contexte de confrontation des volontés, son échec reste toujours possible.
9 – une guerre nucléaire sino-américaine ?
Telle est l’hypothèse que Bruno Tertrais choisit d’explorer dans ce chapitre de prospective, partant de la certitude que tout conflit entre les États-Unis et la Chine aurait d’emblée une dimension nucléaire, avec un risque fort d’escalade lié à une mauvaise appréciation des stratégies et des contraintes adverses. L’asymétrie des enjeux territoriaux y joue un grand rôle, ainsi que la réticence des Américains à employer à nouveau l’arme nucléaire contre des populations asiatiques.
Largement appuyés sur les travaux conduits par des équipes de chercheurs ou de stratèges américains, les scénarios d’ouverture du feu nucléaire en premier par la Chine tournent tous autour de l’échec d’une tentative de prise du contrôle de Taïwan qui viendrait saper les fondations du pouvoir du parti communiste chinois, surtout si cet échec débouchait sur une intervention américaine contre le territoire chinois continental et son arsenal nucléaire relativement imbriqué avec les moyens conventionnels.
Dans la mesure où il est avéré que l’emprise du parti communiste sur la Chine constitue un enjeu existentiel, personne ne sait comment se développerait une guerre entre les États-Unis et la Chine.
10 – L’impact politique des armes nucléaires
Dans un dernier chapitre, conclusif, Bruno Tertrais s’interroge sur l’impact politique des armes nucléaires. En s’appuyant sur l’exemple de la France, il souligne l’image d’autosuffisance, de souveraineté ou d’autonomie, y compris vis-à-vis de son plus puissant allié. Car la possession de l’arme nucléaire est également un facteur de puissance, « un égalisateur de puissance politique et militaire », pour reprendre les termes du général Gallois.
Au niveau national, développer un programme nucléaire est également un facteur du leadership politique, comme en Corée du Nord, même si pour d’autres ce but est atteint par le renoncement explicite à des capacités facilement atteignables (Allemagne, Corée du Sud…).
Pour autant, dans l’ordre international bâti au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où faut-il voir la puissance stratégique : dans le statut d’État doté ou dans celui de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ? En tout état de cause, en s’appuyant sur des États-nations, l’ordre nucléaire a sans doute contribué à consolider le système classique des relations internationales tout en mondialisant le risque majeur pour l’humanité d’un échange nucléaire. Il y a donc eu renforcement de l’autonomie de certains, mais avec une réflexion commune sur l’interdépendance de tous. En ce sens, la dissuasion peut effectivement être considérée comme un bien public mondial ayant joué un rôle dans la prospérité et le développement depuis 1945 : pas de construction européenne sans le parapluie nucléaire américain ! C’est tout le bénéfice de la « dissuasion élargie », qui neutraliserait pour une région donnée les risques de montée aux extrêmes dans une confrontation politique. Mais l’on reste bien dans la dissuasion et non dans la coercition : empêcher un acteur de faire quelque chose qu’il aimerait faire et non l’obliger à faire quelque chose qu’il ne veut pas faire. Ainsi, les armes nucléaires ont-elles empêché toute confrontation majeure entre grandes puissances, sans pour autant éviter au monde les guerres indirectes, les crises, etc… Si le statut nucléaire de l’OTAN permet à ses membres d’aider l’Ukraine, c’est ce même statut qui a permis à la Russie d’annexer la Crimée, d’intervenir dans le Donbass, puis d’envahir tout le pays.
En réflexion finale, après avoir souligné l’interdépendance entre dissuasion nucléaire et démocratie, Bruno Tertrais conclut logiquement sur l’apport bénéfique de la dissuasion dans le maintien d’une longue paix entre les grandes puissances depuis 1945, sans nier que faire reposer la paix mondiale sur la capacité de détruire l’humanité n’est pas satisfaisant sur le plan éthique. Sans doute peut-on espérer qu’elle n’est qu’une réponse momentanée à la situation contemporaine de confrontation géopolitique…
Général de corps d’armée (2S) Jean-Tristan VERNA
Pac atomica ? Théorie, pratique et limites de la dissuasion, Bruno Tertrais, Éditions Odile Jacob, 208 pages, 20,90 €.
Annexe
La dissuasion nucléaire dans la Revue Nationale Stratégique 2025
14 juillet 2025 – SGDSN
Centralité de l’arme nucléaire dans l’affirmation des puissances
Après avoir rappelé l’utilisation fréquente du « signalement nucléaire » par la Russie depuis 2022, souligné l’accroissement considérable des capacités nucléaires chinoises et alerté sur le risque de prolifération qu’induit la moindre confiance dans le « parapluie américain », le §36 de la RNS affirme : « Face à la stratégie russe, la dissuasion nucléaire à pleinement joué son rôle, en limitant l’extension du conflit en Ukraine et en préservant la liberté d’action des Occidentaux qui ont ainsi pu apporter une aide substantielle à l’Ukraine ».
Le fait nucléaire au cœur des rapports de forces
- 124 : « Les fondamentaux de la doctrine de dissuasion française restent parfaitement adaptés. L’évolution de l’environnement stratégique appelle toutefois à s’assurer de la pertinence des choix capacitaires qui sont faits pour armer les forces stratégiques ainsi que le bon dimensionnement de leur épaulement conventionnel ».
Reprenant les termes de l’adresse du Président de la République aux Français du 5 mars 2025, le §125 énonce : « Ces évolutions renforcent également la nécessité d’ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen ».
Objectif stratégique 1 : une dissuasion nucléaire robuste et crédible (clé de voûte de la politique de défense, épaulée par des armées conventionnelles robustes).
La SNR rappelle les éléments fondamentaux de la dissuasion nucléaire française tels qu’ils ont été bâtis depuis plus de soixante ans. Elle développe la notion « d’avertissement nucléaire » et consacre un paragraphe (177) à « l’épaulement des forces nucléaires et conventionnelles », en donnant aux forces conventionnelles un rôle dans le positionnement du curseur du seuil de la dissuasion nucléaire, afin de maintenir au plus bas le niveau de conflictualité. Dans cette perspective, la réalité de cet épaulement sera concrétisée par le développement de la défense aérienne et antimissile, et l’acquisition d’une capacité de frappe conventionnelle dans la profondeur.
Enfin, rappelant des déclarations déjà anciennes, la SNR insiste sur « la dimension européenne des intérêts vitaux français » et la contribution actuelle et à venir de la dissuasion française à la sécurité de l’Europe.