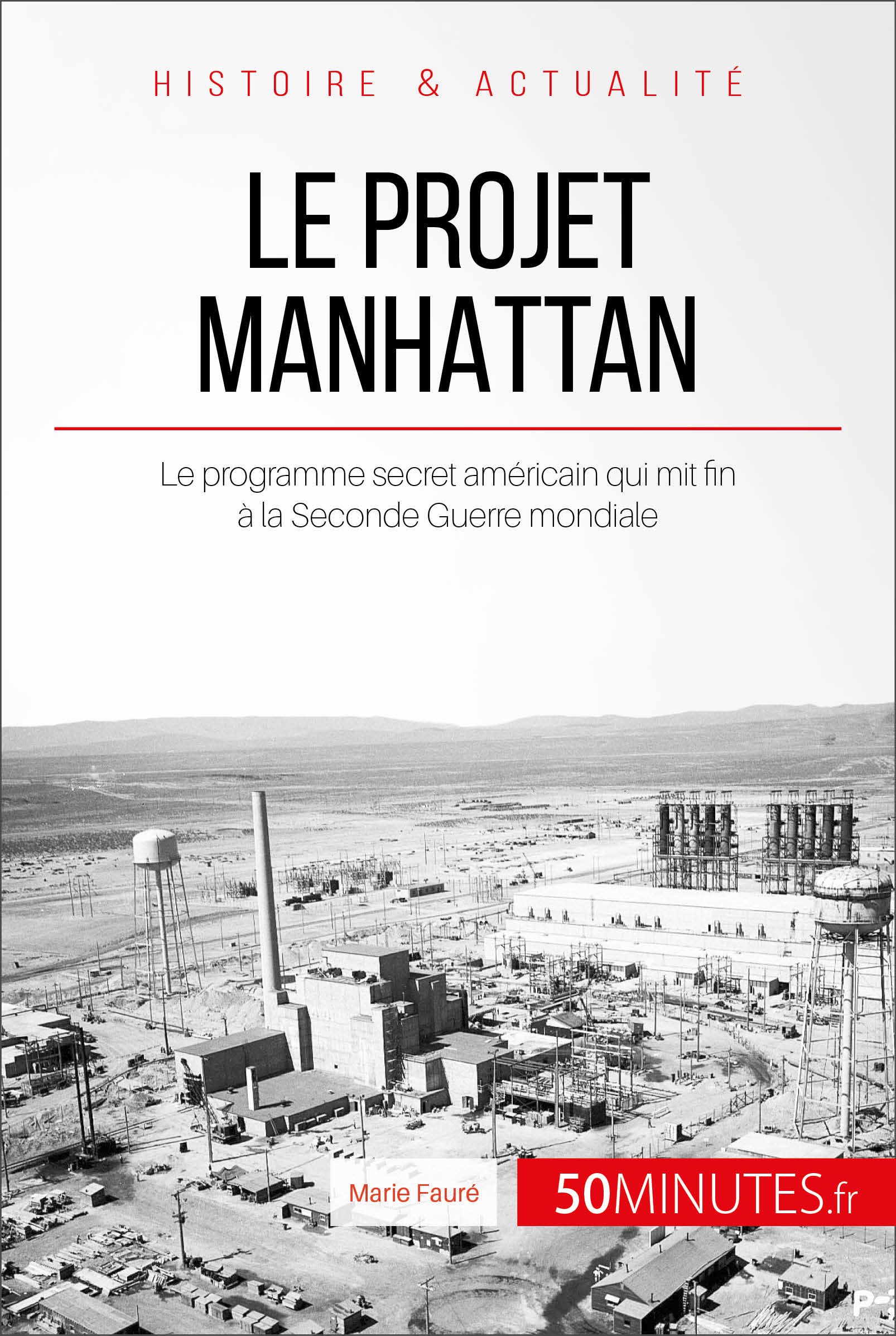11 octobre 1746 : bataille de Rocourt (près de Liège).
La bataille de Rocourt, parfois orthographié Roccoux, Raucoux ou Roucoux, oppose les armées française et autrichienne le , à Rocourt sur les hauteurs nord de Liège, dans l’actuelle Belgique, pendant la guerre de Succession d’Autriche. La victoire tactique française ne peut cependant être transformée immédiatement en victoire stratégique en raison de l’approche de l’hiver.
***
La France déclare la guerre à l’Autriche au début de l’année 1744 et est victorieuse l’année suivante à la bataille de Fontenoy au prix de pertes élevées. La France aide une invasion en Écosse, ce qui oblige les Britanniques à alléger leur corps expéditionnaire aux Pays-Bas, et l’Armée impériale autrichienne s’en trouve temporairement affaiblie.
Cherchant à exploiter au maximum cette circonstance, le maréchal Maurice de Saxe, commandant les forces françaises, décide en 1746 de reprendre l’invasion des Flandres et s’empare de Bruxelles, d’Anvers, de Namur et de Charleroi. Son armée, forte de 60 000 hommes, surpasse numériquement celle de son ennemi, Charles-Alexandre de Lorraine, qui ne peut plus lui opposer que 40 000 hommes.
L’armée française est commandée par le maréchal de Saxe et celle des alliés par Charles-Alexandre de Lorraine et John Ligonier.
Les alliés, pour empêcher l’invasion des Provinces-Unies par les Français, avaient pris position près de Liège avec les Néerlandais, sous les ordres de Charles Auguste de Waldeck, sur la gauche, les Britanniques au centre et les Autrichiens tenant la droite sur un front nord-sud d’une quinzaine de kilomètres s’étalant d’Ans (dont le centre se situe pas à l’époque non sur le plateau autour de la gare d’Ans mais à mi-chemin avec Liège, au niveau de la place Nicolaï) au village de Glons.
Le maréchal de Saxe lance son attaque principale contre les Néerlandais, au niveau du bocage entre Ans et Rocourt (la route reliant les deux localités s’appelle actuellement la rue des Français), puis Vouroux, qui sont en effectifs grandement inférieurs en nombre aux Français, et rompit leur formation au troisième assaut, les forçant à se replier derrière les lignes britanniques. Les Autrichiens ne prennent aucune part aux combats et ne font aucune tentative pour attaquer le flanc gauche français. Ligonier organise une arrière-garde pour permettre au reste de l’armée de se replier en bon ordre. Celle-ci évacue par le faubourg Sainte-Walburge, sur les hauteurs de Liège au pied de la citadelle de la ville, et passe la Meuse au niveau de Herstal.
La victoire des Français permit de confirmer leur influence sur Liège et met fin au contrôle de l’Autriche sur les Pays-Bas pour le reste de la guerre.
Étant donné la date, les deux camps se préparent alors à l’hivernage. Les Français se replient sur les villes brabançonnes, et les Alliés restent, malgré leur défaite, à charge de la principauté de Liège, qui s’accommode tant bien que mal de cette présence embarrassante. Le pays est en effet un État neutre malgré sa préférence pour le camp français. Le prince-évêque, Jean-Théodore de Bavière, frère du défunt empereur Charles VII, fait tenir les comptes de cette présence et les présente lors de la conclusion du traité d’Aix-la-Chapelle.
Sur le terrain, les traces de la bataille restent rares de nos jours puisque sur ces terres accueillent essentiellement habitat et zones commerciales en banlieue nord de Liège.
11 octobre 1802 : le parachute est breveté.
Même si l’invention du Français André-Jacques Garnerin remonte à 1792 et qu’il effectue son premier saut en octobre 1797, au-dessus du parc Monceau, le brevet n’est déposé qu’en 1802 avec une version améliorée et plus stable de l’engin.

11 octobre 1899 : début de la deuxième guerre des Boers (Afrique du Sud).
Les Boers (paysans en Hollandais) qui ont été rejetés vers le nord-est de l’Afrique du Sud par les Britanniques, se sont constitués en Etats indépendants (le Natal et l’Etat d’Orange) et luttent à la fois contre les Zoulous et l’expansionnisme des colons britanniques attirés par l’or fraîchement découvert au Transvaal. Très attachés à leur culture, ceux que l’on finira par appeler les Afrikaners (environ 25 000 combattants), mènent pendant trois ans une guérilla particulièrement éprouvante pour les armées britanniques (près de 500 000 soldats !). Les Afrikaners montent des actions commando (le terme vient de leur langue), sont camouflés alors que les troupes impériales sont de rouge vêtues, mais doivent finalement se rendre.
Lord Kitchener obtient leur reddition en 1902 après avoir quadrillé le territoire afin de priver les insurgés du soutien de la population (rassemblée dans des camps où sévissent maladies et famine).
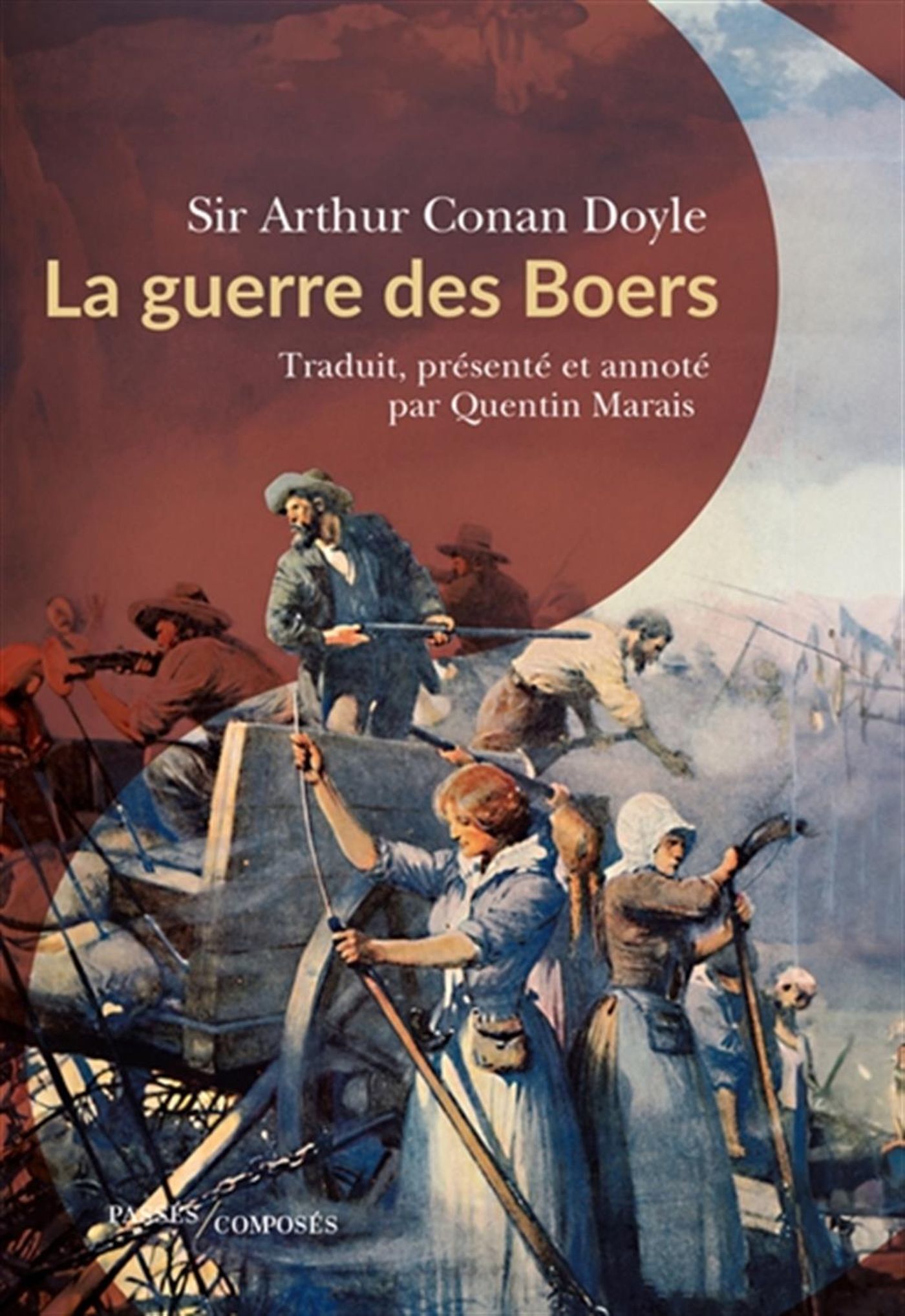
11 octobre 1939 : Roosevelt reçoit la lettre Einstein-Szilard (Washington).
Le 2 août, les physiciens hongrois Szilard, Teller et Wagner décident d’alerter les États-Unis sur la possible utilisation de la fission nucléaire par les nazis. Ils préviennent ainsi les États-Unis sur les récentes avancées scientifiques pouvant créer des bombes d’un nouveau type et extrêmement puissantes. Ils recommandent même d’accélérer le travail expérimental.
Ces physiciens demandent à Einstein de bien vouloir signer la lettre afin d’avoir plus de poids auprès du président américain. La lettre arrive tardivement à destination compte tenu du début des combats (Pologne) et est à l’origine du projet Manhattan.