1er août 939 : bataille de Trans-la-Forêt. Victoire remportée par les Bretons sur les Vikings.
La Bretagne est occupée par les Normands depuis la mort d’Alain le Grand, en 908. Venant d’Angleterre, Alain Barbetorte, fils de Mathuedoï, comte du Poher, et petit-fils d’Alain le Grand, débarque près de Dol en 936. Il remporte plusieurs victoires, comme celle de Dol, ou comme celle de Kastel-Auffret, à Plourivo, contre le chef viking Incon. Il prend Nantes en 937 et chasse les Normands de l’estuaire de la Loire, tandis que le comte Even débarrasse le Léon des pirates.
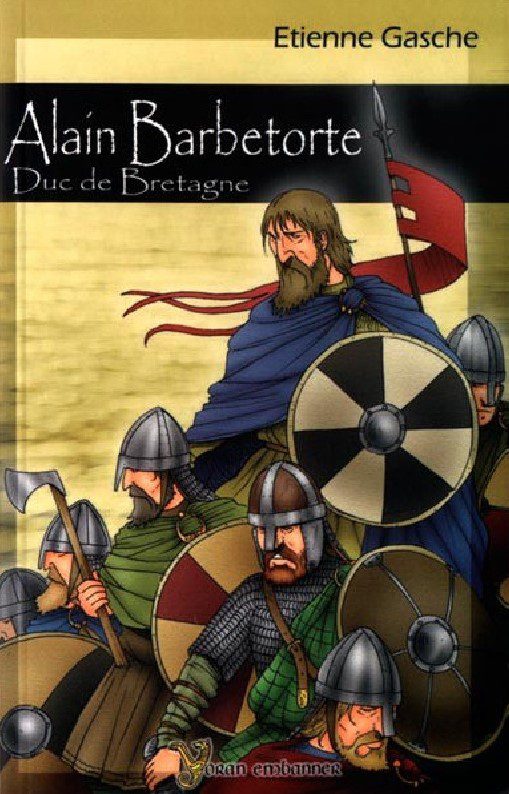 Mais des Normands, restes des armées de Seine de Guillaume Longue-Épée, retranchés dans la forêt de Villecartier, dévastent encore le pays de Dol et le Pays rennais. Juhel Bérenger, comte de Rennes, les combat vigoureusement. N’en venant pas à bout, il réclame l’appui, en 939, de son rival Alain Barbetorte, et celui d’Hugues 1er, comte du Maine.
Mais des Normands, restes des armées de Seine de Guillaume Longue-Épée, retranchés dans la forêt de Villecartier, dévastent encore le pays de Dol et le Pays rennais. Juhel Bérenger, comte de Rennes, les combat vigoureusement. N’en venant pas à bout, il réclame l’appui, en 939, de son rival Alain Barbetorte, et celui d’Hugues 1er, comte du Maine.
Les Normands sont retranchés au vieux M’na, près de Trans. Les Bretons établissent leur camp en contrebas, aux Haies. On estime l’armée de Juhel Bérenger à quelque 500 hommes, celle d’Alain Barbetorte (essentiellement de la cavalerie) à 1 000 hommes. On ignore l’effectif aux ordres d’Hugues 1er, tout comme celui de l’ennemi. Les Bretons attaquent de trois côtés à la fois. Ils écrasent les Normands, qui doivent repasser le Couesnon.
Des traces de deux camps fortifiés subsistent aux environs de l’étang de Ruffien.
Le combat aurait eu lieu le 1er août, jour qui correspond à peu près à la grande fête celte du dieu solaire, polytechnicien et chef des armées, Lug. Selon Pierre Le Baud, les Bretons auraient célébré le jour de cette bataille : « Au jour des Kalendes du mois d’août, jour que les Bretons décrétèrent être solennisé par la gent de Bretagne, par toutes les générations, parce que de là et après, commença derechef la Bretagne à être habitée par ses natifs et Bretons user des lois de leurs ayeux. »
Si cette bataille met fin à l’occupation, elle n’arrête pas les incursions normandes.
1er août 1584 : mort à 49 ans du général et amiral italien Marcantonio Colonna.
Troisième Duc de Paliano, Marcantonio Colonna commandait douze galères pontificales lors de la bataille de Lépante (1571), où l’Espagne, Venise et Rome luttèrent victorieusement contre les Ottomans.
Il fut par la suite vice-roi de Sicile pour Philippe II d’Espagne. Il affirma une volonté inédite dans la Sicile espagnole, d’agir contre les liens entre grand-banditisme et élite palermitaine. Il obtint l’extradition de Toscane de Rizzo di Saponara, bandit protégé par des barons qui mourra empoisonné sur le bateau qui l’emmenait à Palerme. Il fait arrêter et condamner à mort le chef proto-mafieux du marché de Vucciria, Girolamo Colloca, qui reçoit le soutien de la haute aristocratie et du Sénat communal.
Il mourut en 1584.
Un patrouilleur hauturier de classe Thaon di Revel, lancé en 2022, porte son nom (P434).

1er août 1664 : bataille de Saint-Gotthard contre les Ottomans.
La bataille de Saint-Gothard eut lieu près du village de Saint-Gothard (Szentgotthárd) en Hongrie, sur la rive nord de la rivière la Raab. Elle opposa l’armée coalisée composée principalement d’Impériaux et d’un fort contingent français aux troupes ottomanes lors d’une tentative de franchissement du cours d’eau.
***
 La déstabilisation du grand royaume de Pologne lors de la première guerre du Nord (1654–1660) provoque l’intervention tentante de la Transylvanie aux côtés des forces protestantes. Mais, étant tributaires de l’Empire ottoman, les Transylvaniens ne peuvent mener de campagne militaire qu’avec l’aval de la Porte. Or, le grand vizir Mehmet Köprülü réagit énergiquement comme à son habitude ; en 1658 les armées turques envahissent la Transylvanie et y placent un prince plus soucieux du respect des règles imposées par la Porte que son prédécesseur.
La déstabilisation du grand royaume de Pologne lors de la première guerre du Nord (1654–1660) provoque l’intervention tentante de la Transylvanie aux côtés des forces protestantes. Mais, étant tributaires de l’Empire ottoman, les Transylvaniens ne peuvent mener de campagne militaire qu’avec l’aval de la Porte. Or, le grand vizir Mehmet Köprülü réagit énergiquement comme à son habitude ; en 1658 les armées turques envahissent la Transylvanie et y placent un prince plus soucieux du respect des règles imposées par la Porte que son prédécesseur.
Cette intervention menace directement la Hongrie royale dont les nobles demandent la réaction autrichienne. L’indécision de l’Empire, liée à un état déplorable de ses armées et à la force de celles des Turcs, perdure jusqu’en 1661, date à laquelle l’empereur décide enfin d’agir.
Il place ses troupes sous le commandement de l’éminent stratège italien Raimondo Montecuccoli et les lance le long du Danube tout en convoquant la diète à Ratisbonne pour lever des troupes supplémentaires. La campagne militaire de 1662 est un échec qui ne fait que renforcer la présence ottomane à proximité de la frontière. Néanmoins, elle a le mérite de susciter une réaction de la diète impériale qui accepte de lever les renforts demandés, mettant à contribution les princes de l’Empire. À ce titre, un contingent français de 6 000 hommes est envoyé sur les bords du Danube.
Cette intervention, loin d’aller de soi a priori, est la conséquence des manœuvres politiques de Mazarin au lendemain de la guerre de Trente Ans.
Le contingent français fort de 6 000 hommes est placé sous le commandement du comte Jean de Coligny-Saligny (1617–1686) (un proche des Le Tellier/Louvois). Ces troupes comptent parmi les meilleures d’Europe de l’époque. Les soldats sont tous dotés d’un uniforme, une nouveauté qui commence à devenir systématique dans les armées européennes.

L’armée coalisée impériale qui mène alors campagne se décompose en trois contingents. Outre les troupes françaises (6 000 hommes de Coligny) auxquelles les régiments allemands de la Ligue du Rhin sont adjoints (7 000 hommes du comte de Hohenlohe), on trouve un fort contingent de troupes levées dans l’Empire par la diète (environ 19 000 hommes) et un troisième de troupes qu’on qualifiera de manière relativement impropre d’autrichiennes dont la contribution se monte à 21 régiments d’infanterie (36 000 fantassins) et 19 régiments de cavalerie (15 000 cavaliers). En tout, ce sont près de 80 000 hommes que cette armée internationale regroupe. C’est considérable même pour l’époque. Mais les impératifs et la largeur du front ne permettent de disposer que de 30 000 hommes comme force mobile face à la principale armée turque ; les autres étant répartis dans les garnisons ou formant une force de 12 000 hommes chargée de garder la frontière au nord du Danube.
Bien que forte d’un nombre impressionnant de soldats, cette armée souffre de plusieurs carences. D’abord, son nombre de combattants reste très inférieur à celui de son adversaire.
De plus, son ravitaillement est indigent et la primauté des troupes autrichiennes dans sa distribution entretient un climat de jalousie, accentué par des problèmes de coordination principalement liés aux personnalités des différents commandants de corps et à l’usage de plusieurs langues pour donner les ordres.
Et, comme si cela ne suffisait pas, il existe de grandes disparités de qualité entre les troupes. Les troupes autrichiennes et françaises sont, de loin, les plus aguerries, disciplinées et bien équipées. En revanche, les troupes allemandes de la Ligue du Rhin, et surtout les troupes de l’Empire, sont sous-équipées et sous-entraînées.
Conscient de ces carences, Montecuccoli opte pour un plan simple : barrer la route de Vienne aux Turcs en s’appuyant sur la Raab, une rivière sinueuse rendue impétueuse par les pluies incessantes de ce mois de .
Pour Montecuccoli, pas question de livrer bataille en pleine campagne. Les Turcs sont trop nombreux et, surtout, leurs exploits passés leur assurent un ascendant moral sur les troupes occidentales.
Face à lui, le , l’armée turque atteint la Raab et essaye de la passer. Mais les troupes impériales arrivent à les repousser. S’ensuit un mouvement parallèle vers l’ouest des deux armées de part et d’autre de la rivière. Les Turcs cherchent un passage où la franchir et les Impériaux essayent de les en empêcher.
Conformément à la tradition, cette armée ottomane est pléthorique mais très disparate. Elle se compose principalement de troupes provinciales levées sur le modèle féodal ; c’est-à-dire de cavaliers timariotes ralliés à un bey, pouvant fournir un certain nombre d’hommes. Ces troupes proviennent de tout l’Empire ottoman, même si, dans ce cas, les provinces balkaniques fournissent les plus gros contingents. Ces cavaliers sont somptueusement équipés mais l’arc reste leur principale arme (le pistolet faisant à peine des débuts timides dans cette armée). Cependant, leur mobilité et leurs prouesses équestres font d’eux de redoutables combattants.
Mais la force principale de l’armée ottomane réside dans son corps « d’esclaves de la porte » (Kapı kulu). Ce corps d’élite est composé de fantassins redoutables que sont les janissaires et de cavaliers émérites et véloces que sont les sipahis.
Les janissaires fournissent le fer de lance de l’armée qui s’organise autour de leur corps, épaulé par les sipahis. Les troupes provinciales ainsi que les auxiliaires de l’armée ottomane sont répartis sur les ailes. Néanmoins, il est d’usage courant qu’un corps conséquent de cavaliers, généralement des auxiliaires commandés par un supplétif de l’empire, soit déployé à distance du corps de bataille pour tenter des coups de main sur les arrières de l’ennemi. Ce rôle est assuré par le contingent tartare dans cette campagne.
L’armée ottomane est surtout renommée pour la qualité de ses campements où les maladies sont moins répandues que dans ceux des autres forces européennes. Leurs tentes basses et colorées, bien ordonnées ainsi qu’une intendance généralement efficace, forcent le respect des autres nations. Elle est accompagnée de corps d’ingénieurs et d’ouvriers prêts à intervenir à tout moment sur simple ordre du commandant en chef. Les lourds charrois transportant ce matériel se déplacent le long des routes laissées libres par les troupes qui empruntent des chemins parallèles tout en assurant la protection des nombreux bagages et trésors de cette innombrable armée qui peut mobiliser plus de 100 000 combattants.
Néanmoins, en cet été 1664, les pluies incessantes et les rivalités au sein du commandement ottoman sont autant de grains de sable dans cette mécanique généralement bien huilée. Le ravitaillement, notamment, n’est pas à la hauteur des exigences de l’armée. La Raab presque en crue n’offre pas de passage suffisamment aisé aux troupes ottomanes qui sont repoussées dans leurs tentatives de franchissement. Pour faciliter cette traversée, le grand vizir Fâzïl Ahmet Pacha décide de remonter vers l’amont de la rivière où il sera plus aisé de la franchir.
C’est ainsi que l’armée ottomane installe son campement dans la soirée du 28 juillet aux abords de Saint-Gotthard qui est aussitôt pillé. Une tentative pour traverser la rivière est repoussée par les troupes impériales. Les deux armées sont alors face à face et séparées par la Raab. D’un côté 100 000 Ottomans, de l’autre l’armée impériale réunit près de 25 000 combattants. Durant les journées des 29 et 30 juillet, l’activité de part et d’autre se limite à quelques tirs de canons. Les Ottomans avisent alors un gué situé dans une courbure favorable de la Raab à quelques kilomètres en amont. La matinée du jeudi 31 juillet est consacrée au déplacement du camp près de cet emplacement.
Les deux partis sont conscients de l’enjeu : si l’armée ottomane réussit à franchir la rivière, elle pourra marcher sans encombre sur Vienne grâce à la protection de ses nombreux cavaliers. A contrario, si les Impériaux arrivent à stopper l’armée turque sur la Raab, Vienne — et par extension, l’Europe chrétienne — sera sauvée. Car l’armée ottomane a déjà dû livrer plusieurs sièges au début de la campagne et son ravitaillement commence à être difficile dans cette région où le fourrage manque pour les chevaux. Le conseil de guerre qui se tient dans la tente du grand vizir au soir du 31 juillet préconise de ne rien tenter le lendemain vendredi 1er août, jour saint pour les musulmans. Il est préconisé de se contenter de construire un pont sur la Raab et d’envoyer les janissaires prendre pied sur l’autre rive sous la protection des canons, sans déclencher une bataille. Apprenant que la bataille est repoussée au samedi, la plupart des troupes provinciales et les nombreux serviteurs de l’armée se dispersent dans la campagne à la recherche de ravitaillement et de fourrage.
Dès la nuit, la construction d’un pont de fortune est lancée. Conformément à l’efficacité turque dans ce domaine, il est rapidement rendu praticable et les janissaires franchissent la rivière sur le pont pendant que les sipahis, chargés de les protéger, traversent à gué de part et d’autre de l’ouvrage, selon la tradition de l’armée ottomane. Rapidement, les janissaires s’emploient à fortifier leur tête de pont en creusant des retranchements pendant que les cavaliers fourragent à proximité. La faible réactivité des troupes de l’Empire placées en vis-à-vis du gué les incite à poursuivre leur exploration jusqu’aux vergers et abords du village de Nagyfalu (aujourd’hui Mogersdorf, district de Jennersdiorf, en Autriche).
Au petit matin, les troupes de l’Empire chargées de surveiller le secteur, mal préparées et mal entraînées, commencent à paniquer devant l’avance des cavaliers turcs. Face à l’inorganisation des Allemands, les Turcs s’en donnent à cœur joie et pillent le village et les quartiers des régiments de l’Empire. Voyant cela, plusieurs autres contingents de cavaliers turcs franchissent la rivière pour participer au pillage. Trois régiments allemands tentent de réagir et essayent de se former pour s’opposer à l’ennemi de plus en plus entreprenant. Hélas, cette infanterie lourde et peu expérimentée doit, pour se mettre en bataille, traverser un terrain accidenté couvert de bâtiments ou d’arbres. C’est donc complètement désorganisées que ces troupes arrivent devant les Turcs. Le piège se referme sur eux et rapidement les troupes de l’Empire doivent fuir le champ de bataille. Voyant comment les choses tournent, les Ottomans décident de franchir la rivière pour participer à l’hallali.
Pendant ce temps, du côté impérial, on assiste dépité aux événements en attendant les ordres. L’armée impériale est répartie sur les hauteurs de la vallée, au-delà d’une lignée d’arbres qui la dissimule partiellement aux yeux des Ottomans. Mais les points d’observations sont nombreux pour assister aux déboires des régiments allemands.
Aux alentours de midi, la situation commence à devenir dramatique et l’armée n’a toujours pas réagi. Après avoir demandé l’autorisation d’intervenir durant toute la matinée pour juguler la débandade, les officiers français sont maintenant partisans d’un repli stratégique pour éviter de perdre leurs troupes. Mais les officiers impériaux se ressaisissent et une réaction ferme de l’ensemble de l’armée est préconisée. L’armée se met alors en bataille et marche sur la ligne d’arbres qui la sépare des Turcs ; les escadrons prenant place entre les bataillons d’infanterie.

Lorsque les uniformes bien alignés apparaissent sous la ligne des arbres, les Ottomans répondent à ce qui leur apparaît comme un coup de bluff, en faisant sortir les janissaires de leurs retranchements. Arrivés à portée de tir, les Impériaux restent fermes et la bataille s’engage sur toute la ligne. Comme plus tôt dans la matinée, les troupes allemandes sont copieusement malmenées par les janissaires, trop effrayants pour ces jeunes recrues. Rapidement, une brèche apparaît entre le centre et l’aile gauche de l’armée impériale tenue par les Français. Le moment est tragique, mais, jugeant qu’il n’y a rien de mieux à faire, les troupes françaises partent à l’assaut des lignes turques pour combler la disparition des troupes allemandes. Dans le même temps, à l’opposé de la ligne, sur l’aile droite, Montecuccoli fait avancer ses Autrichiens.
Devant la fermeté des troupes adverses, les Ottomans, fatigués par une action commencée durant la nuit, affamés par le manque de ravitaillement et désorganisés par de nombreuses absences au sein de leurs unités, décident d’adopter une position défensive plus efficace : ordre est donné aux janissaires de regagner leurs retranchements. Mais voyant ce mouvement de repli de leurs troupes d’élite, les Turcs, dont la plupart n’avaient engagé le combat que dans l’intention de participer à une victoire rapide sur des troupes désorganisées, commencent à refouler vers le pont et les gués. Petit à petit, c’est toute l’armée ottomane qui reflue puis qui se précipite pour retraverser la Raab.
Voyant cela et faisant fi de l’ordre donné, la plupart des orta de janissaires ne s’arrêtent pas sur leurs retranchements mais rejoignent les fuyards. La déroute de l’armée ottomane est consommée. Bien sûr, le pont ne peut résister à une telle débandade et rompt sous la masse des fuyards qui sont alors précipités dans l’eau où la plupart se noient dans la cohue. Alors, les Turcs prisonniers de la rive gauche se partagent entre ceux qui cherchent un autre passage et ceux qui s’apprêtent à combattre jusqu’à la mort les soldats impériaux qui avancent vers eux.
La prise des retranchements est âpre et les troupes françaises s’y distinguent. Les ultimes combats sont livrés avec l’énergie du désespoir mais bien que les pertes chez les Impériaux soient importantes, la victoire ne peut leur échapper. Une fois les derniers défenseurs des retranchements éliminés, les soldats marchent sur les berges escarpées de la rivière et déchargent un feu nourri sur les fuyards turcs qui tentent de la franchir à la nage.
Enfin, lorsqu’il n’y a plus rien d’autre à faire, comme une ultime humiliation infligée à leur honneur, les soldats impériaux baissent leur culotte et montrent leur postérieur aux survivants turcs déconfits, mouillés et humiliés.
La victoire paraît totale pour les forces impériales mais son coût en limite la portée. Bien que les sources soient contradictoires comme toujours sur l’évaluation des pertes, on peut estimer à 2 à 6 000 hommes celles des forces coalisées impériales sur un effectif d’un peu plus de 20 000 combattants. Quant à celles des Turcs, elles s’élèveraient à 8 ou 10 000 hommes soit 30% des troupes engagées. Ces pertes se portent principalement sur les unités d’élite de l’armée (janissaires et sipahis) tandis que celles de la coalition impériale ont davantage frappé les troupes les moins expérimentées (régiments de l’Empire).
Mais la menace turque n’est pas écartée et son armée campe toujours devant Saint-Gothard, où les fuyards se rallient dans les heures qui suivent la bataille. L’armée coalisée, quant à elle, est minée par les maladies et le harcèlement des cavaliers tartares ; mais également par les dissensions et les nombreux reproches que s’adressent les différents commandants. Afin d’éviter un retournement de situation, l’empereur Léopold 1er s’empresse de signer la paix de Vasvár dès le , sauvant ainsi son armée victorieuse d’une décomposition programmée dans une Hongrie, ravagée par les prélèvements des troupes suscitant aussi bien le mécontentement des locaux que des troupes alliées. Comme celui des Français, qui, livrés à eux-mêmes, sont à deux doigts de voir leur corps expéditionnaire se disloquer lorsque les Tartares s’emparent de leurs chariots quelques jours après la bataille.
Cette paix, ramenant les belligérants au statu quo ante bellum, permet de rester sur la note positive de la victoire mais suscite beaucoup d’émois surtout auprès des alliés mécontents et en premier lieu des Hongrois : alors que les gazettes occidentales saluent avec emphase une victoire éclatante face à la marée turque, la Hongrie royale, ravagée par les opérations sans avoir évincé les Ottomans de ses territoires, s’éloigne de la politique impériale. Le mouvement des Malcontents est né et trouve un écho favorable auprès du corps expéditionnaire français. Louis XIV ne laissera pas échapper cette opportunité de planter une nouvelle aiguille dans le pied de Léopold. Un lien s’est ainsi créé qui influencera durablement la politique extérieure française pendant plusieurs décennies.
1er août 1759 : bataille de Minden.
La bataille de Minden, épisode décisif de la guerre de Sept Ans, s’est déroulée aux portes de la place de Minden en Rhénanie-Westphalie. Les armées britanniques et leurs alliés, le Brunswick-Lunebourg (ou Hanovre) et le Royaume de Prusse, vainquirent la France et ses alliés, dont le duché de Saxe. Cette défaite contribua à ternir sérieusement l’hégémonie des Bourbons en Europe.
***
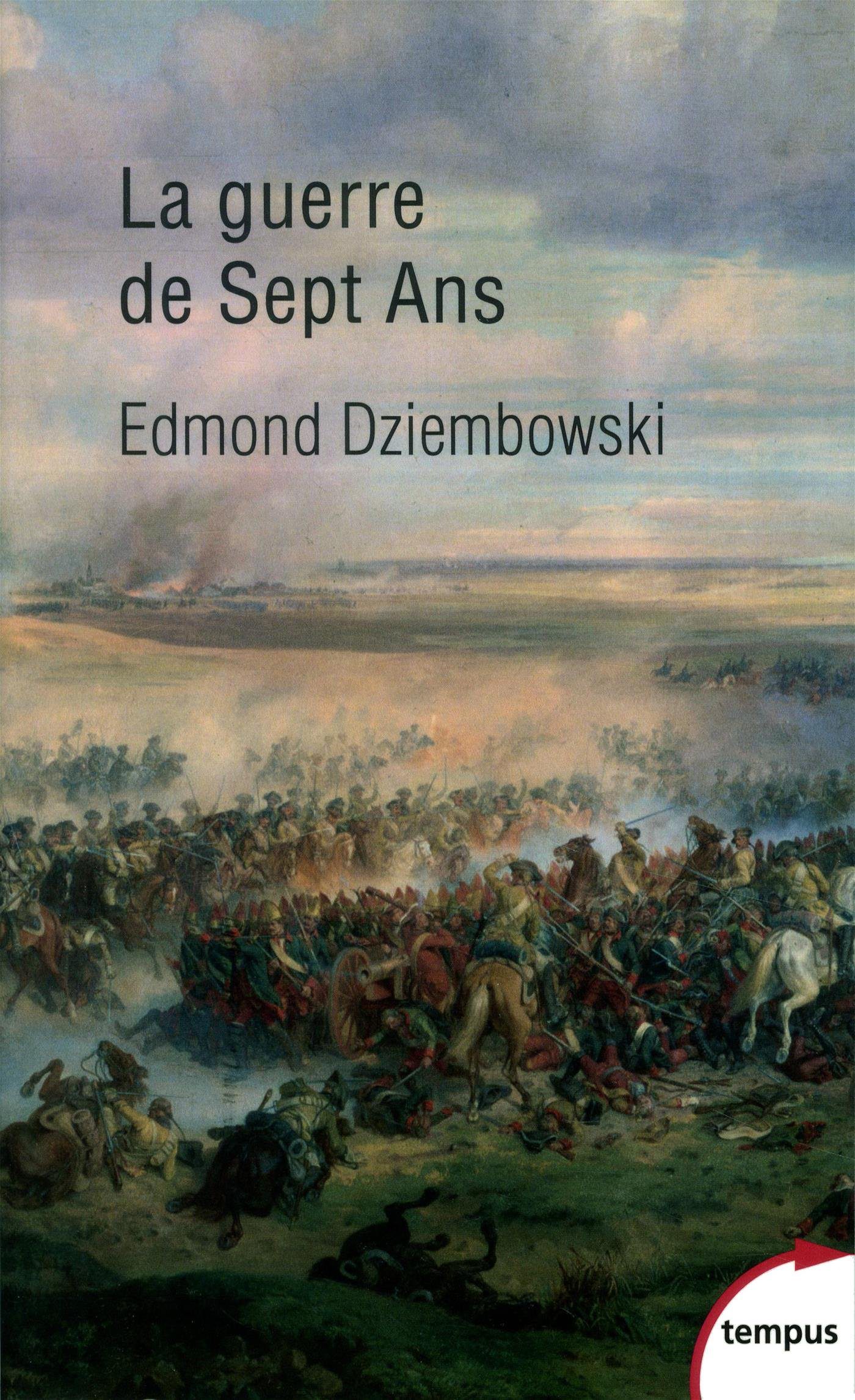 Au début de la guerre de Sept Ans, les Britanniques, alliés aux Prussiens, étaient sur la défensive contre la France, tandis que la Prusse concentrait l’essentiel de son action offensive contre l’Autriche et la Russie. À l’été 1759 les Français firent mouvement depuis Cassel et Düsseldorf vers les territoires britanniques du Hanovre. Le prince de Hanovre était alors souverain de Grande-Bretagne et d’Irlande. Voyant son domaine héréditaire menacé, il pria son allié le roi de Prusse de confier le commandement des armées alliées au duc Ferdinand de Brunswick-Lunebourg réputé pour sa valeur militaire. Après quelques hésitations, Frédéric II accepta et confia le 23 novembre 1757 la direction des armées à Ferdinand. Ce dernier remporta une première bataille et les Français, sur le point d’être rejetés au-delà du Rhin renforcèrent leurs troupes, le maréchal de Contades prenant la direction des opérations au début de 1759. Le généralissime français devait s’emparer des places-fortes de Lippstadt et Münster en Westphalie. Ferdinand lui barra la route mais fut défait à la bataille de Bergen. Les Français, amenant de nouveaux renforts, dépassèrent Korbach et Cassel. Venus du sud, ils firent traverser la Diemel à leurs régiments en plusieurs fois et atteignirent ainsi sans encombre Bielefeld et Herford. Ferdinand se replia sur Osnabrück. Le 8 juillet, le duc de Broglie réussit son coup de main sur la place de Minden. Contades le rejoignit avec le gros de l’armée et fit camper les troupes au sud-ouest de la ville, dans une plaine entourée de marécages : cette position était pratiquement inexpugnable. Le chef d’état-major anglo-prussien, Ferdinand de Brunswick, prit position au nord-ouest de Minden, pour attirer les Français hors de leurs positions et les provoquer à une bataille rangée.
Au début de la guerre de Sept Ans, les Britanniques, alliés aux Prussiens, étaient sur la défensive contre la France, tandis que la Prusse concentrait l’essentiel de son action offensive contre l’Autriche et la Russie. À l’été 1759 les Français firent mouvement depuis Cassel et Düsseldorf vers les territoires britanniques du Hanovre. Le prince de Hanovre était alors souverain de Grande-Bretagne et d’Irlande. Voyant son domaine héréditaire menacé, il pria son allié le roi de Prusse de confier le commandement des armées alliées au duc Ferdinand de Brunswick-Lunebourg réputé pour sa valeur militaire. Après quelques hésitations, Frédéric II accepta et confia le 23 novembre 1757 la direction des armées à Ferdinand. Ce dernier remporta une première bataille et les Français, sur le point d’être rejetés au-delà du Rhin renforcèrent leurs troupes, le maréchal de Contades prenant la direction des opérations au début de 1759. Le généralissime français devait s’emparer des places-fortes de Lippstadt et Münster en Westphalie. Ferdinand lui barra la route mais fut défait à la bataille de Bergen. Les Français, amenant de nouveaux renforts, dépassèrent Korbach et Cassel. Venus du sud, ils firent traverser la Diemel à leurs régiments en plusieurs fois et atteignirent ainsi sans encombre Bielefeld et Herford. Ferdinand se replia sur Osnabrück. Le 8 juillet, le duc de Broglie réussit son coup de main sur la place de Minden. Contades le rejoignit avec le gros de l’armée et fit camper les troupes au sud-ouest de la ville, dans une plaine entourée de marécages : cette position était pratiquement inexpugnable. Le chef d’état-major anglo-prussien, Ferdinand de Brunswick, prit position au nord-ouest de Minden, pour attirer les Français hors de leurs positions et les provoquer à une bataille rangée.
La Grande-Bretagne et la France s’affrontaient simultanément en Europe, en Amérique du Nord, aux Antilles et aux Indes pour la suprématie mondiale. Sur chaque théâtre d’opération les deux puissances s’appuyaient sur leurs alliés locaux. À Minden, les Britanniques bénéficiaient de leur union personnelle avec le Brunswick-Lunebourg, aussi appelé « Hanovre ». Le prince allemand George-Louis de Hanovre avait hérité en 1714 de la couronne britannique. Outre la Maison de Brunswick, il était allié au comté de Hesse-Cassel et au Royaume de Prusse, puissance émergente en Europe continentale. L’électorat de Saxe combattait aux côtés de la France alors que son duc, qui était en même temps roi de Pologne (Auguste III de Pologne), demeurait à Varsovie. Les soldats de Minden, qui étaient déjà mobilisés dans le 41e régiment d’infanterie prussien, ne prirent aucune part au combat.
Le combat s’est déroulé dans l’ancienne principauté prussienne de Minden. Le champ de bataille se trouvait dans la plaine à l’ouest de la forteresse de Minden et au nord de la dépression marécageuse de la Bastau : c’était une lande herbue, à peine ponctuée ici et là de jardins et de maisons, entrecoupée de fossés de drainage.
Aux alentours de Minden, au sud-ouest du champ de bataille, les obstacles intéressant la tactique étaient :
- à l’est, la coupure naturelle formée par le lit de la Weser. On ne pouvait franchir le fleuve que par les ponts se trouvant à l’intérieur des remparts de la ville ;
- au sud, la Bastau et ses innombrables marécages comme la « Grande Tourbière » (grosses Torfmoor) qui ne pouvaient être traversés par une armée tant soit peu importante qu’à l’aide de pontons de campagne. Au milieu de ces marécages, les grandes digues de Hille et d’Hartum étaient faciles à défendre. La Bastau ne se jetait dans la Weser qu’à l’intérieur des enceintes de la ville de Minden. Plus au sud de la Bastau les monts des Wiehengebirge fermaient presque entièrement la plaine par le sud depuis la Bastau. On pouvait par exemple traverser la chaîne des Wiehengebirge par les gorges de la Porta Westfalica ou le col de Bergkirchen, mais pour pouvoir se replier au sud par cette route, il fallait absolument contrôler les ponts franchissant la Werre à Bad Oeynhausen et Gohfeld (à Mennighüffen-Ostscheid).
- Au nord, l’Ösper constituait un nouvel obstacle, quoique plus facile à franchir que la Bastau. Un peu plus au nord encore s’étendaient les marais de Uchte, mais ils n’eurent aucun rôle sur le déroulement du combat.
Le champ de bataille était entouré des agglomérations de Hahlen, Nordhemmern, Kutenhausen, Todtenhausen, et enfin de Minden (dans le sens des aiguilles d’une montre).
La principale ligne d’opération des Français, et leur principale voie de repli était donc la vieille route du Rhin passant par Bielefeld, Herford et les gorges de la Porta Westfalica. Le haut-commandement français était parfaitement conscient qu’en cas de défaite à Minden, l’objectif immédiat des coalisés serait de leur barrer cette route : c’est pourquoi il fit renforcer le 28 juillet les troupes commises à la couverture de cet axe, au sud-est, pour en porter l’effectif final à 2 000 fantassins et cavaliers et cinq canons, placés sous les ordres du duc de Brissac, général âgé de 60 ans. Conformément aux prévisions, le général ennemi Ferdinand de Brunswick dépêcha d’importants contingents, formés de régiments hanovriens, et complétés de Brunswickois, Prussiens et Hessois, à travers les monts des Wiehengebirge vers le Sud. Un général de 23 ans, le prince Charles-Guillaume-Ferdinand de Brunswick, se trouvait ainsi à la tête de 8 000 fantassins, 2 000 cavaliers et 32 canons.
Les Français occupaient de solides positions autour des ponts franchissant l’Else dans le secteur de Bünde au nord-ouest de Herford : le 30 juillet, ils repoussèrent sans problème une première attaque des Anglo-Prussiens. Mais le duc de Brissac reçut l’ordre de se replier à l’est pour couvrir sans délai la retraite du gros de l’armée par la ligne de communication avec le Rhin. C’est ainsi qu’il laissa l’ennemi reprendre le pont stratégiquement important de Gohfeld sur la Werre, à mi-chemin entre Herford et le défilé de la Porta Westfalica, et même permit l’occupation des postes défensifs situés aux abords du village plus au sud. Renseigné de la sorte sur les mouvements ennemis, le prince-héritier de Brunswick, qui avait suivi les Français et venait par la même occasion de reprendre position sur la paroisse de Quernheim (au nord-est de Bünde), put fourbir ses plans d’attaque.
La rencontre eut lieu le 1er août 1759. À l’armée numériquement inférieure des Anglo-Prussiens commandée par Ferdinand de Brunswick étaient opposés des régiments d’élite français comme le Régiment Gendarmerie de France et le Régiment Royal-Carabiniers. Les Prussiens et leurs alliés comptaient en effet dans leurs rangs environ 40 000 hommes, les Français plus de 55 000.
L’objectif du prince Charles-Guillaume de Brunswick était d’encercler puis de défaire les Français. À cette fin, il divisa ses forces en trois bataillons. Le bataillon au centre, placé sous les ordres du comte von Kielmannsegge, devait marcher vers le pont par le nord de la Werre et, fort de l’artillerie du corps de Brunswick, bombarder les positions ennemies. L’aile droite, que le prince commandait en personne, devait franchir l’Else à Kirchlengern puis la Werre en passant par le village de Löhne, et une fois de l’autre côté bifurquer vers Gohfeld pour enfin attaquer les Français par le flanc gauche. Le troisième bataillon, commandé par le général de brigade von Bock, devait se consacrer aux ponts de Neusalzwerk (auj. Bad Oeynhausen) au nord et à l’est de Gohfeld, pour interdire aux Français le repli vers l’est.
Le 1er août vers 3 heures du matin, les bataillons anglo-prussiens s’ébranlèrent. Plus tard dans la nuit, le duc de Brissac fit passer le gros de son armée sur la rive nord de la Werre, parce que le terrain, davantage plat et dégagé, y offrait de meilleures possibilités de manœuvre à la cavalerie. Les Français vinrent ainsi prendre position entre la Werre et la localité de Börstel, à l’ouest de l’actuelle Maison Gohfeld à Mennighüffen-Ostscheid. Il en résulta que le bataillon central des Prussiens se trouva plus vite au contact de l’ennemi, sans appui d’artillerie et à un autre endroit que ce qui avait été prévu. Ainsi, tandis que l’artillerie et l’infanterie prussienne prenaient position à la confluence du ruisseau de Mühlenbach avec la Werre, la cavalerie lança une première charge, mais fut promptement repoussée par les Français. Là-dessus, il s’engagea une canonnade qui dura deux heures.
Malgré l’infériorité de son artillerie, le duc de Brissac était décidé à tenir la position aussi longtemps qu’il le pourrait, afin d’empêcher les contingents du prince-héritier de Brunswick de marcher sur Minden et d’y renforcer les contingents alliés. Ayant remarqué que l’ennemi avait déployé ses forces sur un espace très étendu, il ordonna vers 7 heures à sa cavalerie de charger le bataillon central, qui lui parut le point le plus faible du dispositif des coalisés ; et en effet cette charge rompit le premier rang ennemi. Seulement les préparatifs de cette charge n’étaient pas passés inaperçus des Hanovriens, si bien que la mobilisation en urgence de réserves d’infanterie infligea de lourdes pertes aux cavaliers français, et pour finir les repoussa.
Entre-temps l’aile droite des Hanovriens menée par le prince de Brunswick apparut au sud du pont de Gohfeld, menaçant de s’en emparer et ainsi de prendre à revers les Français. La position du duc de Brissac devenait à présent intenable : il ordonna le repli, mais la manœuvre tourna à la confusion lorsque le bataillon nord du général von Bock se lança à l’attaque. Ainsi la neutralisation prévue du corps d’armée sud des Français réussit finalement.
On ignore le chiffre exact des pertes, mais seuls 300 Français furent faits prisonniers. Les vaincus, en déroute, se réfugièrent pour certains à Bergkirchen, d’autres rallièrent Rehme, d’où ils retrouvèrent le gros de l’armée autour de Minden.
Ferdinand chercha à tromper l’adversaire, en laissant le corps Wangenheim isolé à Kutenhausen, au nord de Minden, tandis que le reste de l’armée faisait mouvement vers l’ouest. Il s’agissait d’inciter les Français à quitter leur position retranchée au milieu des marais de Hille et à attaquer un ennemi supposé inférieur numériquement.
Le combat s’ouvrit sur le flanc nord près de Todtenhausen, où les Français lancèrent leur infanterie à l’assaut. Le général de Broglie devait attaquer les ennemis au nord du sanctuaire avec toutes ses forces et les encercler. Une fois cette percée réussie, il devait obliquer vers l’ouest et envelopper les alliés anglo-prussiens par leur flanc. Or vers 5 heures du matin il tomba sur de forts contingents ennemis commandés par le général von Wangenheim, lequel défendait le secteur compris entre Kutenhausen et la Weser avec 15 bataillons et le régiment d’artillerie de campagne du comte von Schaumburg. Broglie dut interrompre sa progression et combattit jusqu’à ce que, harcelé par les charges de la cavalerie hessoise commandée par le général prussien von Holstein, il commence à battre en retraite.
À l’aile sud, Ferdinand de Brunswick ordonna d’abord à la cavalerie anglo-hanovrienne de Lord Sackville de prendre position au village de Hahlen ; mais les escadrons, qui n’étaient pas prêts, restèrent immobiles. Un épais brouillard, typique du pays, suivi d’une pluie battante gêna la progression des troupes britanniques vers leurs positions prévues, entre Hahlen et Stemmer : elles ne purent s’y trouver que vers 6 heures. Par suite d’un malentendu (la langue de l’état-major anglo-prussien était le français) les bataillons d’infanterie anglo-hanovriens les plus avancés de l’aile sud marchèrent trop tôt à l’ennemi. Ils prirent au dépourvu la cavalerie française, qui était encore en train de se préparer. Le général von Spörcken maintint l’assaut, si bien qu’il rompit le centre ennemi. Les fusiliers britanniques s’illustrèrent en conservant les rangs au milieu de tirs d’artillerie nourris, et en dispersant la cavalerie ennemie. C’est un des rares cas dans l’histoire où l’infanterie a attaqué spontanément la cavalerie. Ferdinand ordonna à plusieurs reprises à Sackville d’appuyer l’infanterie de ses 24 escadrons, mais ce dernier resta passif, ce qui lui valut de tomber plus tard en disgrâce.
La bataille perdue, les Français durent évacuer la place de Minden et décrocher sur la rive gauche de la Weser. L’accablement de l’ennemi en repli fut un demi-échec de Ferdinand de Brunswick, bien que son roi, Frédéric II, lui eût conseillé de « frapper le fer tant qu’il est chaud ». Par suite de l’affrontement du matin à Gohfeld, les Français ne pouvaient toutefois plus se replier au sud-est par la Werre : ils durent dévier leur route vers Cassel par Kleinenbremen et Hamelin, d’où ils ne purent plus lancer de nouvelle attaque jusqu’à la fin de la guerre. C’est ainsi que les Britanniques parvinrent à écarter durablement les Français des terres de leur souverain George II.
90 000 combattants prirent part à cette bataille, qui dura trois heures d’après les témoignages écrits. Selon certaines sources, il y aurait eu 10 000 soldats tués (le nombre de victimes civiles est indéterminé) ; selon d’autres les Français auraient perdu 480 officiers et 7 700 soldats, les Anglo-Prussiens 150 officiers et 2 600 soldats. Cela signifie que même après la bataille, les Français conservaient l’armée la plus nombreuse, ce qui peut justifier l’abandon d’un harcèlement de l’ennemi par les Prussiens.
Le jeune prince héritier de Brunswick, qui à Minden et Gohfeld avait fait montre de qualités de stratège, devint par la suite maréchal et général en chef prussien. Quant au duc de Cossé-Brissac sa défaite face à un ennemi inférieur en nombre ne lui nuit aucunement, puisqu’il fut élevé au rang de maréchal de France ; son compagnon d’armes, le futur ministre de la Guerre Philippe-Henri de Ségur, qui à Gohfeld commandait l’infanterie, bénéficia de la même promotion.

1er août 1812 : mort au combat du général russe Jacob Koulnev.
Jacob (Iakob) Petrovitch Koulnev, né le à Lucyn (dans la voïvodie polono-lituanienne de Livonie, aujourd’hui en Lettonie) et mort le 1er à Klyastitsy (Biélorussie), fut, avec Pierre de Bagration et Alexis Iermolov, un des chefs militaires russes les plus populaires à l’époque des guerres napoléoniennes. Fervent admirateur de Souvorov, il participa à 55 batailles. Il perdit la vie à la bataille de Klyastitsy pendant la campagne de Russie de Napoléon.
Le père de Koulnev était un officier balte de petite noblesse. Le futur général naît à Lucyn (aujourd’hui Ludza en Lettonie) et entre à l’école d’infanterie pour la noblesse .
En 1785 après un bref séjour dans le régiment d’infanterie de Tchernigov, il rejoint, comme lieutenant, le régiment de dragons de Saint-Pétersbourg et sous la commande de Souvorov, participe à la guerre russo-turque, de 1787 à 1792 et à la campagne polonaise de 1794-1795. La dix années suivantes de sa vie sont peu connues.
En 1807, il commande en tant que lieutenant-colonel le régiment de hussards de Grodno qui affronte les armées de Napoléon. Il se fait un nom à la bataille d’Heilsberg et à la bataille de Friedland, dans laquelle il parvient à se sortir d’un encerclement.
Pendant la guerre de Finlande contre la Suède, Koulnev mène l’avant-garde de Buxhoevden. Il est décoré après le siège de Jakobstad d’une épée d’or sertie de diamants et portant la mention Pour la Bravoure. Il se distingue à Lappo, Kuortane et Oravais, trois engagements pour lesquels il reçoit l’Ordre impérial et militaire de Saint-Georges et le rang de lieutenant général.
Le couronnement de la campagne a lieu lorsque Koulnev mène l’avant-garde de Bagration à travers la mer Baltique gelée vers les îles d’Åland et de là, à Grislehamn, à moins de 70 kilomètres de Stockholm, la capitale de l’ennemi qui réussit à sauver Stockholm grâce au général von Döbeln. Cette manœuvre audacieuse force les Suédois à chercher la paix à n’importe quel prix.
L’Ordre de Sainte-Anne de 1re classe lui est attribuée pour son courage. Koulnev est invité à prendre en charge l’avant-garde de l’armée du Danube qui lutte contre les Turcs dans l’actuelle Bulgarie.
Pendant la campagne de Turquie de 1810, Koulnev est l’un des généraux les plus capables de Russie. Il fait preuve de détermination à Shumla, Nikopol, Rousse, et Batin, donnant à la campagne un caractère audacieux qui avait manqué jusque-là. Un conflit qui l’oppose au commandant en chef, Nikolaï Kamenski, le force cependant à quitter l’armée.
Napoléon envahit la Russie en 1812 et Koulnev défend les routes menant à Saint-Pétersbourg. Le 3 juillet, son détachement capture un général français et 200 cavaliers. Le 18 juillet, il mène 5 000 cavaliers, qui forment l’avant-garde du corps de Wittgenstein, contre le maréchal Oudinot à la bataille de Klyastitsy, faisant 900 prisonniers à l’ennemi. Koulnev traverse la rivière Drissa et s’oppose avec un important contingent français. Les Russes sont pris à partie par des tirs d’artillerie et Koulnev reçoit un boulet de canon dans les jambes, perdant ainsi les deux membres. Il décède le jour même de ses blessures.

1er août 1914 : l’Allemagne déclare la guerre à la Russie.
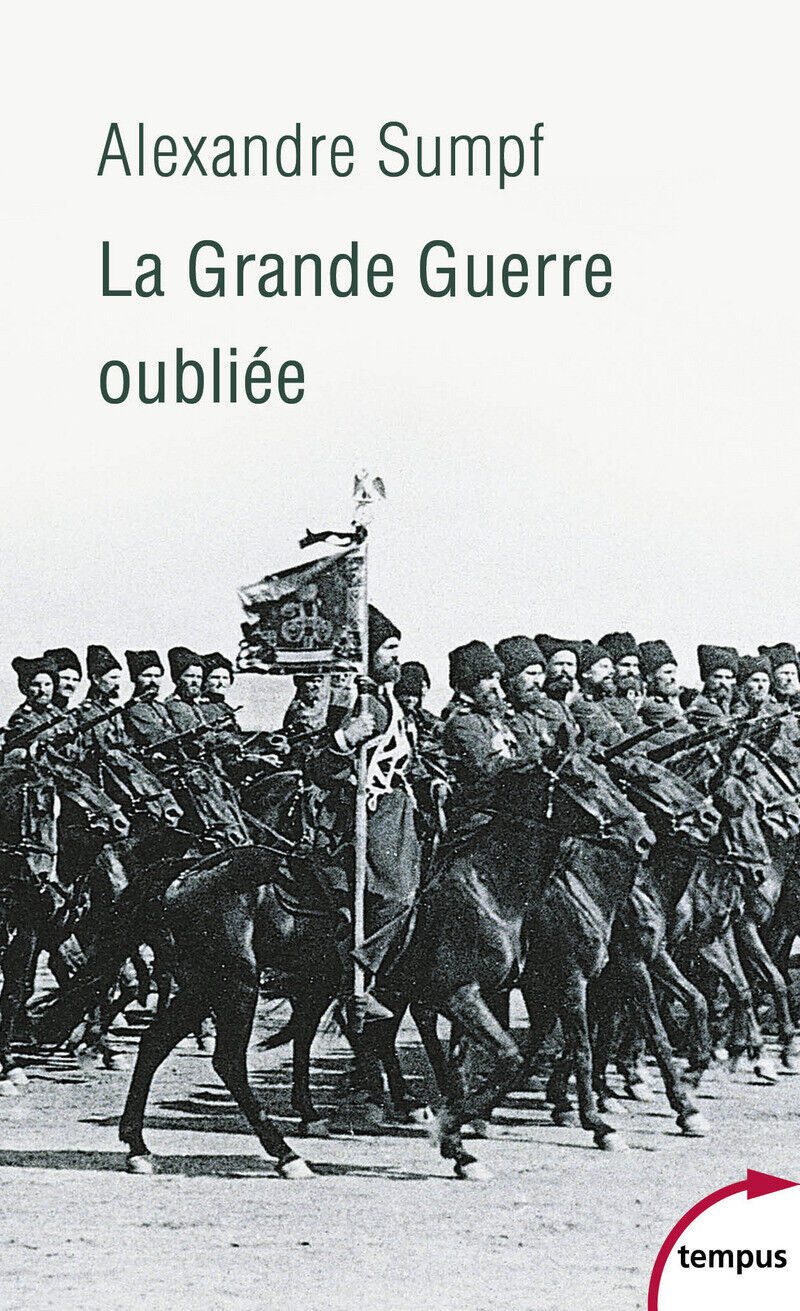 Après concertation avec l’Allemagne, le , l’Autriche-Hongrie lance un ultimatum en dix points à la Serbie dans lequel elle exige que les autorités autrichiennes puissent enquêter en Serbie. Le lendemain, à l’issue du Conseil des ministres tenu sous la présidence du tsar Nicolas II à Krasnoïe Selo, la Russie ordonne la mobilisation partielle pour les régions militaires d’Odessa, Kiev, Kazan et Moscou, ainsi que pour les flottes de la Baltique et de la mer Noire. Elle demande en outre aux autres régions de hâter les préparatifs de mobilisation générale. Les Serbes décrètent la mobilisation générale le 25 et, au soir, déclarent accepter tous les termes de l’ultimatum, hormis celui réclamant que des enquêteurs autrichiens se rendent dans le pays. À la suite de cela, l’Autriche rompt ses relations diplomatiques avec la Serbie, et ordonne, le lendemain, une mobilisation partielle contre ce pays pour le , jour où, sur le refus d’approuver son ultimatum lancé cinq jours plus tôt, elle lui déclare la guerre. L’Italie, qui n’avait pas été interpellée par l’Autriche, déclare sa neutralité. Le gouvernement français enjoint à son armée de retirer toutes ses troupes à dix kilomètres en deçà de la frontière allemande, pour faire baisser la tension et éviter tout incident de frontière qui pourrait dégénérer.
Après concertation avec l’Allemagne, le , l’Autriche-Hongrie lance un ultimatum en dix points à la Serbie dans lequel elle exige que les autorités autrichiennes puissent enquêter en Serbie. Le lendemain, à l’issue du Conseil des ministres tenu sous la présidence du tsar Nicolas II à Krasnoïe Selo, la Russie ordonne la mobilisation partielle pour les régions militaires d’Odessa, Kiev, Kazan et Moscou, ainsi que pour les flottes de la Baltique et de la mer Noire. Elle demande en outre aux autres régions de hâter les préparatifs de mobilisation générale. Les Serbes décrètent la mobilisation générale le 25 et, au soir, déclarent accepter tous les termes de l’ultimatum, hormis celui réclamant que des enquêteurs autrichiens se rendent dans le pays. À la suite de cela, l’Autriche rompt ses relations diplomatiques avec la Serbie, et ordonne, le lendemain, une mobilisation partielle contre ce pays pour le , jour où, sur le refus d’approuver son ultimatum lancé cinq jours plus tôt, elle lui déclare la guerre. L’Italie, qui n’avait pas été interpellée par l’Autriche, déclare sa neutralité. Le gouvernement français enjoint à son armée de retirer toutes ses troupes à dix kilomètres en deçà de la frontière allemande, pour faire baisser la tension et éviter tout incident de frontière qui pourrait dégénérer.
Le , la Russie déclare unilatéralement – en dehors de la concertation prévue par les accords militaires franco-russes – la mobilisation partielle contre l’Autriche-Hongrie. Le chancelier allemand Bethmann-Hollweg se laisse alors jusqu’au 31 pour une réponse appropriée. Le 30, la Russie ordonne la mobilisation générale contre l’Allemagne. En réponse, le lendemain, l’Allemagne proclame « l’état de danger de guerre ». C’est aussi la mobilisation générale en Autriche pour le . En effet, le Kaiser Guillaume II demande à son cousin le tsar Nicolas II de suspendre la mobilisation générale russe. Devant son refus, l’Allemagne adresse un ultimatum exigeant l’arrêt de sa mobilisation et l’engagement de ne pas soutenir la Serbie. Un autre est adressé à la France, lui demandant de ne pas soutenir la Russie si cette dernière venait à prendre la défense de la Serbie. En France, le pacifiste Jean Jaurès est assassiné à Paris par le nationaliste Raoul Villain le . Le 1er , à la suite de la réponse russe, l’Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie.
 En France, le gouvernement décrète la mobilisation générale le même jour, à 16 h 00. Le lendemain, l’Allemagne envahit le Luxembourg, un pays neutre, et adresse un ultimatum à la Belgique, elle aussi neutre, pour réclamer le libre passage de ses troupes. Au même moment, l’Allemagne et l’Empire ottoman signent une alliance contre la Russie. Le , la Belgique rejette l’ultimatum allemand. L’Allemagne entend prendre l’initiative militaire selon le plan Schlieffen. Elle adresse un ultimatum au gouvernement français, exigeant la neutralité de la France qui en outre devrait abandonner trois places fortes dont Verdun. Le gouvernement français répond que « la France agira conformément à ses intérêts ». L’Allemagne déclare alors la guerre à la France. Le Royaume-Uni, qui souhaitait éviter la guerre, déclare qu’il garantit la neutralité belge, et réclame le lendemain que les armées allemandes, qui viennent de pénétrer en Belgique, soient immédiatement retirées. Le gouvernement de Londres ne reçoit aucune réponse, et déclare donc la guerre à l’Allemagne le . Seule l’Italie, membre de la Triplice qui la lie à l’Allemagne et à l’Autriche, se réserve la possibilité d’intervenir plus tard suivant les circonstances. Le , l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie aux côtés de l’Allemagne. Le 11, la France déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie, suivie par le Royaume-Uni le . Comme la plupart des pays engagés possèdent des colonies, l’affrontement prend rapidement un caractère mondial : faisant partie du Commonwealth, le Canada, l’Australie, l’Inde, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud entrent automatiquement en guerre contre l’Allemagne, de même que les colonies françaises et belges.
En France, le gouvernement décrète la mobilisation générale le même jour, à 16 h 00. Le lendemain, l’Allemagne envahit le Luxembourg, un pays neutre, et adresse un ultimatum à la Belgique, elle aussi neutre, pour réclamer le libre passage de ses troupes. Au même moment, l’Allemagne et l’Empire ottoman signent une alliance contre la Russie. Le , la Belgique rejette l’ultimatum allemand. L’Allemagne entend prendre l’initiative militaire selon le plan Schlieffen. Elle adresse un ultimatum au gouvernement français, exigeant la neutralité de la France qui en outre devrait abandonner trois places fortes dont Verdun. Le gouvernement français répond que « la France agira conformément à ses intérêts ». L’Allemagne déclare alors la guerre à la France. Le Royaume-Uni, qui souhaitait éviter la guerre, déclare qu’il garantit la neutralité belge, et réclame le lendemain que les armées allemandes, qui viennent de pénétrer en Belgique, soient immédiatement retirées. Le gouvernement de Londres ne reçoit aucune réponse, et déclare donc la guerre à l’Allemagne le . Seule l’Italie, membre de la Triplice qui la lie à l’Allemagne et à l’Autriche, se réserve la possibilité d’intervenir plus tard suivant les circonstances. Le , l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie aux côtés de l’Allemagne. Le 11, la France déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie, suivie par le Royaume-Uni le . Comme la plupart des pays engagés possèdent des colonies, l’affrontement prend rapidement un caractère mondial : faisant partie du Commonwealth, le Canada, l’Australie, l’Inde, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud entrent automatiquement en guerre contre l’Allemagne, de même que les colonies françaises et belges.
Le , le Japon offre son appui aux Alliés et déclare la guerre à l’Allemagne. Le 1er , l’Empire ottoman se joint aux puissances centrales. Le sort de la guerre cependant se joue en Europe, surtout en France, qui en supporte la charge la plus lourde.
1er août 1916 : première réunion entre Louis Renault et le général Estienne pour la conception d’un nouveau char.

Louis Renault proposa 11 études de chars. Le général Estienne choisit un char léger qui sera le célèbre Renault FT.
Un premier prototype fonctionnel fut essayé par Louis Renault devant une commission militaire en mars 1917. Cette démonstration fut suivie par deux commandes fermes : la première en avril 1917 et l’autre en juin de la même année. Au moins 3 530 exemplaires furent produits, et peut-être plus de 3 700. Au tout début, en 1917, ces chars de combat étaient équipés d’une tourelle moulée, qui fut remplacée par une tourelle octogonale et rivetée appelée « tourelle Berliet ». Enfin une nouvelle tourelle arrondie et moulée (tourelle Girod) suivit en 1918. Aux États-Unis, 950 exemplaires furent construits sous licence, la plupart après la guerre.
Les lettres « FT » correspondent au code chronologique de la production Renault à l’époque. Le modèle précédent était « FS » et le suivant « FU » (ce dernier est un camion destiné au transport du Renault FT). Ce char n’a jamais porté pendant la Première Guerre mondiale ni le nom de « FT 17 » ni « FT 18 ».
Le char Renault FT fut engagé pour la première fois le 31 mai 1918 à partir de Saint-Pierre-Aigle en direction de Ploisy-Chazelle, pendant la troisième bataille de l’Aisne. Puis il fut employé en formations de plus en plus nombreuses et de plus en plus efficaces, en compagnie des chars Schneider CA1 et Saint-Chamond restants, jusqu’à l’armistice du 11 novembre 1918, date à laquelle il équipe 21 bataillons. Le char Renault FT fut le char de combat le mieux conçu de toute la guerre, à la fois efficace, économique et adapté à la production industrielle de masse. Il joua un rôle prépondérant dans les offensives de 1918 au cours desquelles il reçut le nom populaire de « char de la victoire ».
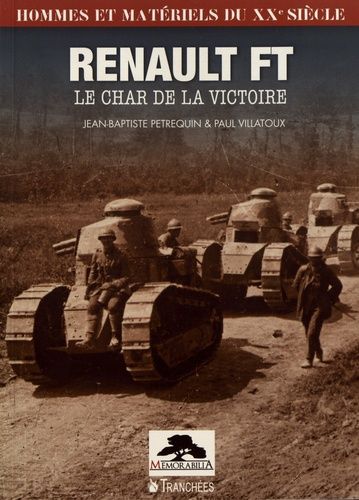 Après la guerre, il fut exporté dans de nombreux pays (Afghanistan, Finlande, Estonie, Lituanie, Pologne, Roumanie (76 en 1919), Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Suisse, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Brésil, république de Chine, empire du Japon et Iran) et construit sous licence aux États-Unis à 950 exemplaires à partir d’octobre 1918 sous le nom de 6 Ton Tank ou char léger M1917. Les chars FT furent ainsi utilisés par la plupart des pays possédant une force blindée, en tant que char principal. Ils prirent part à de nombreux conflits ultérieurs tels que la guerre civile russe, la guerre polono-soviétique, la grande révolte syrienne, la guerre civile chinoise, la guerre du Rif et la guerre civile espagnole. L’Italie produisit un char presque identique, le Fiat 3000.
Après la guerre, il fut exporté dans de nombreux pays (Afghanistan, Finlande, Estonie, Lituanie, Pologne, Roumanie (76 en 1919), Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Suisse, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Brésil, république de Chine, empire du Japon et Iran) et construit sous licence aux États-Unis à 950 exemplaires à partir d’octobre 1918 sous le nom de 6 Ton Tank ou char léger M1917. Les chars FT furent ainsi utilisés par la plupart des pays possédant une force blindée, en tant que char principal. Ils prirent part à de nombreux conflits ultérieurs tels que la guerre civile russe, la guerre polono-soviétique, la grande révolte syrienne, la guerre civile chinoise, la guerre du Rif et la guerre civile espagnole. L’Italie produisit un char presque identique, le Fiat 3000.
Les chars FT furent aussi utilisés au début de la Seconde Guerre mondiale, entre autres par la France et la Pologne, bien qu’ils fussent complètement obsolètes. Au 1er septembre 1939, il en existait encore 2 850 dans l’armée française mais plus d’un millier étaient dépourvus d’armement à la suite du prélèvement de leurs canons de 37 SA-18, récupérés pour équiper les chars légers de la génération suivante, les Renault R35, Hotchkiss H35 et FCM 36. La Wehrmacht en récupéra 1 704 à l’armistice de 1940. L’armée d’occupation les utilisa encore comme « Beutepanzer » (chars de butin) pour des opérations de répression, notamment pendant la libération de Paris en .
Le jeune lieutenant-colonel américain George Patton avait été formé en France (1917) sur le char Renault FT.





1er août 1927 : création de l’Armée populaire de libération (Chine).
L’Armée populaire de libération fut fondée sous le nom d’Armée rouge chinoise par le Parti communiste chinois le au tout début de la guerre civile qui l’opposa au Kuomintang. Après la guerre sino-japonaise, les troupes communistes furent rebaptisées Armée populaire de libération. C’est depuis le nom officiel de l’armée nationale de la république populaire de Chine. Avec plus de deux millions de soldats actifs, l’APL est depuis la disparition de l’Armée rouge (soviétique) la plus grande du monde en termes d’effectifs.
 L’APL est composée depuis le de cinq services : l’armée de terre, la marine, la force aérienne, la Force des fusées (auparavant Second corps d’artillerie), la Force de soutien stratégique (créée en 2016) supportée par la Police armée du peuple (880 000 policiers) et la milice. L’insigne de l’Armée populaire de libération se compose d’une étoile rouge portant les caractères chinois « 八一 » (« 8-1 »), en référence au 1er août.
L’APL est composée depuis le de cinq services : l’armée de terre, la marine, la force aérienne, la Force des fusées (auparavant Second corps d’artillerie), la Force de soutien stratégique (créée en 2016) supportée par la Police armée du peuple (880 000 policiers) et la milice. L’insigne de l’Armée populaire de libération se compose d’une étoile rouge portant les caractères chinois « 八一 » (« 8-1 »), en référence au 1er août.

1er août 1936 : mort à 64 ans de l’ingénieur et aviateur Louis Blériot.
1er août 1943 : opération Tidal Wave.
L’opération Tidal Wave (en français : raz-de-marée) est un bombardement stratégique de grande envergure effectué depuis Benghazi en Libye par l’USAAF, le 1er, contre le complexe pétrolier roumain de Ploiești, lequel était la principale source de carburant pour les forces allemandes, dans le cadre de la campagne de bombardements stratégiques alliés contre les ressources pétrolières de l’Axe.
Cette opération, deuxième incursion d’envergure de l’USAAF sur l’Europe, se traduisit par de lourdes pertes, malgré un certain succès dans les objectifs. Elle mit en évidence pour les Allemands certaines faiblesses dans leurs défenses et préfigure les combats d’envergure qui suivront en Roumanie l’année suivante, lorsque la 15th USAAF entamera une campagne de bombardements stratégiques qu’elle mènera à terme. Bien que taxée d’échec — à cause de ses lourdes pertes — cette mission demeure exceptionnelle sur bien des points, d’autant plus que certains mystères subsistent encore au début du XXIe siècle.
L’approvisionnement en pétrole, comme lors de la Première Guerre mondiale, est un des points faibles de l’Allemagne. La guerre à l’Ouest la prive de ses sources habituelles (États-Unis et Indes occidentales néerlandaises). La production des États-Unis représente alors 61 % de la production mondiale. Les champs pétrolifères roumains sont le seul gisement important à portée du Reich. Dès 1938, l’Allemagne va s’employer à évincer Français et Britanniques et à placer l’économie roumaine et ses ressources sous la tutelle du Reich.
À l’issue de la Première Guerre mondiale et après l’indépendance de nouvelles nations européennes, la Roumanie regroupe presque tous les territoires habités par des roumanophones, et les réformes agraire et constitutionnelle des années 1921-1933 ont atténué de démocratie parlementaire une monarchie plutôt conservatrice, qui à partir de février 1938 s’efforce de contrôler, y compris par la force, les diverses formations politiques, mais ne peut imposer son autorité ni aux communistes, ni au parti de l’extrême droite, la Garde de fer dirigée par Corneliu Codreanu, que le roi Carol II fait exécuter le . La France avait garanti les frontières roumaines le , mais après la défaite française de juin 1940, Carol II cède aux pressions allemandes, nomme un gouvernement pro-allemand et, sur les instances de l’ambassadeur allemand von Killinger, laisse l’URSS (alors liée à l’Allemagne nazie par le Pacte germano-soviétique) occuper la Bessarabie et la Bucovine du nord le . Devant le mécontentement général suscité par sa faiblesse, Carol II subit un coup d’état de la part du général fascisant Ion Antonescu qui le force à abdiquer en faveur de son fils Mihail et à quitter définitivement le pays.
En janvier 1941, la Garde de fer fomente à son tour un coup d’État contre Ion Antonescu, mais Adolf Hitler ne fait pas confiance à ces fanatiques chrétiens et nationalistes roumains, auxquels il préfère un militaire pragmatique, un « homme fort » qui espère reprendre à l’URSS les territoires cédés par Carol II, quitte à s’allier au Troisième Reich, puissance industrielle à même de rééquiper de matériel moderne l’armée roumaine, en échange de livraisons de carburant. La Garde de fer se fait massacrer entre le 21 et le tandis que les troupes allemandes débarquent, d’abord composées d’instructeurs puis, après l’entrée en guerre de la Roumanie lors de Barbarossa, de soldats, notamment des servants de flak et des aviateurs de la Luftwaffe.
Après l’attaque allemande contre l’URSS et la fin des livraisons de carburant soviétique à l’Allemagne nazie, l’approvisionnement en carburant du Reich va dépendre de la Roumanie à 98,6 %.
Le principal complexe pétrolifère se trouve dans la région de Ploiești, érigé à grands frais à l’aide d’investisseurs étrangers, notamment américains, néerlandais, français et italiens. Quarante-deux raffineries, rassemblées en huit grands complexes, furent ainsi bâties autour de la ville de Ploiești à partir de 1919.
La maréchal Ion Antonescu, dont le pouvoir est mal assuré, demande une aide militaire à Adolf Hitler dès sa prise de pouvoir car l’opinion lui est en majorité hostile (à la suite de la dureté de l’occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale, elle est restée profondément anti-allemande et favorable aux Alliés). Par ailleurs, Antonescu cherche à séduire le commandement de l’armée : l’objectif principal de sa demande d’aide militaire est de moderniser les forces roumaines. La Roumanie conserve donc une certaine indépendance par rapport au Troisième Reich et n’est initialement pas en guerre contre les Alliés occidentaux, qui ne lui déclareront la guerre qu’en , soit 8 mois après le début de la guerre contre l’URSS. Conscient que la Roumanie est le talon d’Achille de la logistique allemande, Adolf Hitler décide de renforcer au plus vite ses défenses. Le , les premiers militaires allemands arrivent en Roumanie sous le couvert d’assistance militaire. C’est la Deutsche Luftwaffe Mission in Rumänien (DLM), dirigée par le général Wilhelm Speidel et par le colonel Alfred Gerstenberg attaché de l’air à l’ambassade d’Allemagne en Roumanie.
Il fallut attendre une première série d’attaques soviétiques (3 bombardements sur Ploiești) pour que les premiers renforts allemands arrivent. Une seconde vague de renforts arriva à la suite du bombardement américain du lors du projet Halverson n° 63 (HALPRO). Les moyens de la mission du étaient destinés à l’origine à un bombardement du Japon à partir de la Chine mais après la prise de l’aérodrome de Benghazi en Libye, le général Hap Arnold ordonna le bombardement des raffineries de Ploiești, afin de frapper les sources d’hydrocarbures du Reich. Ce fut la toute première attaque américaine sur le sol européen. Entre-temps, la DLM n’ayant plus lieu d’être fut dissoute (janvier 1942) et le général Wilhelm Speidel fut réaffecté. Le général Alfred Gerstenberg fut nommé Commandant en chef de l’aviation militaire allemande en Roumanie (Kommandierender General und Befehlshaber der Deutschen Luftwaffe in Rumänien) du au . Gerstenberg renforça les défenses du site de Ploiești en hommes et en matériels et organisa des manœuvres, profitant du calme de la zone au début de la guerre.
Les défenses de Ploiești étaient constituées de :
- La Flak comptant deux lignes de défense, l’une à 3 km des raffineries, l’autre à 15 km. Un commandement unique pour la DCA du secteur pétrolier de Ploiești fut créé et dirigé par le général Julius Kuderna de la Cinquième Flak-Division. Du fait de la création d’un commandement unique, le général Julius Kuderna eut sous ses ordres la 5. Flak-Division mais aussi des unités roumaines de lutte antiaérienne. Les canons allemands à eux seuls formaient 42 batteries (5 de 20 mm et 37 mm, 32 de 88 mm et 5 de 105/128 mm). L’Axe disposait aussi de deux trains de flak. Les canons roumains comptaient 40 batteries. Une autre source mentionne le nombre de 237 canons de tous calibres[9]. Ce dispositif était complété par 58 ballons avec une charge explosive et près de 1 000 projecteurs de fumée ; l’ensemble était guidé par 16 stations radar de type « Freya » et « Würzburg ».
- L’aviation se composait du I. Gruppe de la Jagdgeschwader 4 allemande (sur Bf 109) dont 1 escadrille est roumaine ayant 2 désignations officielles, 1 allemande (IV./JG 4) et 1 roumaine (Escadrila 53 Vânătoare), du IV. Gruppe de la Nachtjagdgeschwader 6 (sur Bf 110) dont 1 escadrille est roumaine ayant 2 désignations officielles, 1 allemande (12./NJG 6) et 1 roumaine (Escadrila 51 Vânătoare de Noapte) et d’au moins 5 escadrilles roumaines (45, 52, 59, 61 et 62 Escadrila Vânătoare) équipées d’IAR-80, avion relativement moderne qui fera ses preuves lors de ce combat.
- Afin de préserver au maximum les raffineries en cas de bombardement et d’éviter la propagation du feu, des murs et 500 pompiers allemands sont placés à Ploiești.
-
Les succès de la stratégie anglo-américaine de 1942 (débarquement en Afrique du Nord et les victoires dans la Première bataille d’El Alamein et la Seconde bataille d’El Alamein) ont amené les Alliés à réfléchir sur la conduite des futures opérations. Une conférence fut organisée avec les Alliés (États-Unis, Royaume-Uni, Comité national français et Union soviétique mais celle-ci déclina l’invitation) afin de définir en commun la poursuite de la guerre. Cette conférence, plus connue sous le nom de conférence de Casablanca, se tînt au Maroc en janvier 1943 en présence de Roosevelt, de Churchill et pour le Comité national français, du général de Gaulle et du général Giraud. Les Britanniques, malgré leur réticence à ouvrir un second front, souhaitaient, si un débarquement s’avérait nécessaire, l’opérer dans les Balkans pour occuper un maximum de pays avant que Staline ne s’en empare. Les Américains, quant à eux, souhaitaient débarquer en Europe occidentale et laisser Staline « libérer » l’Europe orientale (y compris des pays alliés comme la Pologne).
Toutefois, dans la guerre aérienne, il incombait aux Britanniques et aux Américains de mener rapidement des opérations contre les pétroles de Ploiești, ne serait-ce que pour assister indirectement l’Armée rouge, durement engagée dans de sanglants combats sur son territoire.
-
Un compromis fut donc choisi : débarquer « entre les deux » en Sicile et puis en Italie continentale. L’idée d’un bombardement de grande ampleur sur le pétrole roumain naquit à cette occasion. L’intérêt d’une telle mission était de couper l’approvisionnement de carburant de l’Allemagne à sa source afin de causer de graves difficultés à l’ensemble de ses armées, que ce soit l’aviation ou la Wehrmacht encore très puissante à l’époque, malgré ses revers en URSS.
Pour cette opération, pas moins de cinq groupes de bombardement furent désignés, soit en tout près de 200 avions (bombardiers lourds Consolidated B-24 Liberator). La mission allait être effectuée par la 9th Air Force présente dans le désert libyen, renforcée à l’occasion par une partie de la 8th Air Force, basée jusqu’alors en Grande-Bretagne.
Pour « motiver » les équipages participant à cette attaque, on leur affirmera que ce seul raid suffirait pour « réduire la guerre de six mois ». Si cette affirmation était sans doute surfaite, il ne faisait aucun doute cependant que la pénurie de carburant se ferait cruellement sentir, au moins pendant un temps, dans toute l’Allemagne nazie.
Cette mission fut préparée dans le plus grand secret, les équipages multipliant les exercices sur des reproductions des objectifs improvisées dans le désert. La mission, nom de code Tidal Wave, allait être exceptionnelle, tant par sa durée, onze heures, soit la limite de l’autonomie des bombardiers, que par ses objectifs, d’importance vitale. De plus, pour éviter la détection, les appareils devraient voler en rase-mottes (pratiquement une première pour un bombardement stratégique) au-dessus d’une zone fortement défendue.
-
Ce dimanche 1er, par une chaleur écrasante, les équipages américains s’apprêtent pour leur mission. Les mécaniciens doivent préparer 178 avions, chargés chacun de 12 000 litres de carburant et de deux tonnes de bombes. Bien vite cependant, tout ne se déroule pas comme prévu : un appareil s’écrase au décollage, un autre peu après en Méditerranée et une douzaine doivent faire demi-tour prématurément à cause de divers problèmes. Lorsque les 165 avions restants arrivent sur les Balkans, ils sont interceptés par deux escadrilles de l’aviation bulgare qui ne peuvent pas les atteindre mais signalent leur présence. Les nuages sur les montagnes vont alors scinder la formation, deux groupes (376th et 93rd) passant au-dessus, les trois autres continuant à l’altitude prévue.
Lors de l’arrivée en Roumanie se produit un incident qui alimente encore la polémique aujourd’hui. En effet, la formation de tête, guidée par le 376th Bombardment Group, censée attaquer la raffinerie (construite grâce à des investissements américains), vire trop tôt, entraînant à sa suite deux autres groupes.
L’avion de tête semble s’être trompé, les autres s’en rendant compte rapidement comme le prouvent les rapports officiels des équipages, mais ils suivent malgré tout leur chef. Les responsables américains furent longtemps « ennuyés » par ce « détail » et la propagande allemande se saisit bien vite de l’affaire.
L’opération se poursuit donc dans la plus grande confusion, les appareils de trois groupes ne trouvant plus leurs objectifs assignés. Si le complexe de Ploiești est atteint par tous, les bombes tombent un peu au hasard. La défense semble se réveiller à ce moment mais souffre d’un grave problème : en ce dimanche, seules les unités de garde sont présentes, que ce soit au niveau de la flak ou de l’aviation. De plus, 250 des 750 projecteurs de fumées sont en maintenance, de même qu’une quinzaine de ballons (sur 58). Cependant, toutes incomplètes qu’elles furent, les défenses accomplirent leur mission. Les avions de chasse roumains IAR-80 de garde furent vite épaulés par des Bf 109 et même par des Bf 110 de chasse de nuit, rajoutant à la furie des combats.
À ce moment surviennent les deux groupes de bombardiers ayant survolé les nuages et qui eux n’avaient pas commis l’erreur de navigation de leurs homologues. Leur arrivée rajoute encore à la confusion et bien peu d’avions bombardent leurs cibles pré-désignées. Une fois leur mission accomplie, les appareils n’en sont pas quittes pour autant : nombre sont endommagés par la DCA ou les chasseurs ennemis.
Le vol de retour est bien long, ponctué par quelques rencontres : d’abord les avions bulgares, des Avia obsolètes, mais cette fois bien placés pour une rapide interception qui semble causer une perte parmi les avions américains. Ensuite, c’est au tour de la 610e escadrille bulgare, équipée, elle, de modernes Bf 109 G-6, et qui causera deux pertes. Enfin, alors que les B-24 pénètrent l’espace aérien de la Grèce occupée, ils sont pris à partie par l’escadrille de chasse allemande IV./JG 27, perdant quatre des leurs.
-
Le sort des avions américains est varié : certains regagnent l’Afrique (88, dont seulement 33 en bon état), d’autres la Sicile, Chypre ou Malte (23 en tout). 8 autres sont internés en Turquie (neutre). Parmi les avions perdus, 36 tombent en Roumanie, 8 s’écrasent en Bulgarie (6 étant abattus par la chasse locale) et deux sont perdus sur accident à l’aller ; soit 45 pertes en combat, 58 toutes causes confondues, c’est-à-dire 32,5 % des effectifs engagés ; ou encore 302 tués parmi les équipages et 132 prisonniers, plus 75 internés. Un très lourd bilan donc pour les Américains, comme le rappellent les cinq Medal of Honor distribuées au cours de cette mission (le plus grand nombre à ce jour) qui vit le plus gros taux de perte de l’USAAF.
Contrairement à ce qui fut dit, les défenses de Ploiești n’étaient pas si imparables. Rappelons que :
- ce dimanche, peu de personnel était à son poste ;
- le barrage de ballons n’était complet qu’aux trois-quarts, causant malgré cela 4 pertes ;
- la DCA manquait d’expérience lors de cette première bataille pour elle, causant quand même 20 pertes ;
- les chasseurs furent peu nombreux, à peine une trentaine sur la Roumanie, causant environ 10 pertes.
Le bilan aurait pu être bien plus lourd mais cette bataille fut une dure « épreuve », excessivement longue pour les équipages américains. Le caractère de cette mission fut exceptionnel.
Pour les forces de l’Axe, le bilan est lui aussi élevé : 7 avions détruits et 10 endommagés, en comptant les appareils bulgares et ceux basés en Grèce. Enfin, concernant les objectifs de la mission : deux raffineries ont été intégralement détruites, trois autres étant gravement endommagées. 78 victimes seront à déplorer en Roumanie, notamment dans l’incendie d’un pénitencier pour femmes touché par la carcasse d’un B-24 abattu. Si l’on considère les nombreuses difficultés posées par la mission, on peut bel et bien parler de succès américain même s’il fut cher payé. D’un côté comme de l’autre, cette mission apporta également de nombreuses leçons. Les Alliés allaient s’en souvenir lors de leur campagne de bombardements dans le même secteur l’année suivante tandis que les Allemands renforceront les défenses et mirent sur pieds des équipes de travailleurs chargés de reconstruire rapidement les installations détruites. De plus, de nombreux murs seront bâtis entre ces mêmes installations, pour limiter l’effet de souffle des bombes.
Les Allemands avaient la preuve que ce qu’ils redoutaient de longue date pouvait se produire et que leur approvisionnement était vulnérable. Adolf Hitler avait engagé ses forces dans les opérations Maritsa et Merkur dans le but de protéger les champs pétrolifères roumains contre toute action des Alliés.
Enfin, l’as de l’aviation roumaine Constantin « Bâzu » Cantacuzino mit en place un réseau pour prendre en charge les aviateurs américains abattus en Roumanie et les faire passer en Turquie[18]. Il bénéficia de la discrète protection du roi Michel Ier et du gouverneur militaire de Bucarest, Constantin Sănătescu, qui fournirent par ailleurs des moyens de communication et une garde à la mission clandestine inter-Alliée (mission « Autonomous » du SOE) parachutée en 1944 en Roumanie : les Roumains, réalisant leur propre vulnérabilité et anticipant leur passage aux Alliés (qui se produisit le ) cherchèrent, eux aussi, à favoriser les Alliés occidentaux avant que l’Armée rouge n’envahisse leur pays.

1er août 1943 : morte en combat aérien de l’aviatrice soviétique Lidia Litviak, la « Rose de Stalingrad« .
Lidia Litviak ( — 1er), également connue sous le nom de Lili Litviak, est l’une des deux seules femmes as soviétiques de la Seconde Guerre mondiale (et par extension de l’Histoire mondiale) et certainement la plus connue avec Iekaterina Boudanova. Elle avait, à son décès à 21 ans, accompli 168 missions et comptait 12 victoires personnelles à son actif. Elle était surnommée le Lys Blanc à cause de cette fleur peinte sur chaque flanc du fuselage et la Rose de Stalingrad parce qu’à chaque fois qu’elle abattait un avion ennemi, elle faisait peindre une rose blanche sur le nez de son chasseur.
Lidia Litviak est née à Moscou le . Son père, Vladimir Leontievitch Litviak, qui était conducteur de trains, disparait pendant la Grande Purge de 1937. Elle est attirée par l’aviation dès son plus jeune âge et entre, à quatorze ans, dans un aéro-club, où elle effectue son premier vol en solo un an plus tard. Elle intègre ensuite l’école d’aviation de Kherson et obtient un brevet d’instructeur. Après l’invasion de l’Union soviétique, elle désire rejoindre une unité de combat mais voit ses demandes refusées en raison de son manque d’expérience. Elle falsifie alors son temps de vol en l’augmentant d’une centaine d’heures, ce qui lui permet d’intégrer, au début de l’année 1942, le 586e régiment de chasse créé par Marina Raskova, une unité équipée de Yakovlev Yak-1, qui défend la région de Saratov. Elle effectue ses premières missions de combat, de janvier à août 1942.
En septembre, Litviak et plusieurs autres femmes pilotes, dont Raissa Beliaïeva, Iekaterina Boudanova et Maria Kouznetsova, sont affectées à une unité masculine, le 437e régiment de chasse, opérant dans le secteur de Stalingrad, unité équipée de chasseurs Lavotchkine La-3. Le , trois jours seulement après son arrivée, elle remporte ses deux premières victoires, abattant un Junkers Ju 88 et, surtout, un Bf 109 G-2 piloté par l’as allemand Erwin Maier, devenant ainsi la première femme pilote ayant abattu un appareil ennemi. Elle abat un autre Bf 109 le lendemain, puis de nouveau un Ju-88 le .
Les quatre femmes sont mutées en au 9e régiment de chasse de la Garde, commandé par Lev Chestakov. Elles y restent jusqu’en janvier 1943, puis elles intègrent le 296e régiment de chasse, dirigé par Nikolaï Baranov. Le , elle reçoit l’ordre du Drapeau rouge, est promue second lieutenant et sélectionnée pour pratiquer la chasse libre, ou okhotniki. Le , Lidia Litviak abat un Ju-88 et un Bf 109, mais est elle-même blessée et doit se poser en urgence dans un champ, où elle est secourue par le pilote d’un IL-2 qui se pose à proximité ; la gravité de ses blessures l’oblige néanmoins à rester hospitalisée jusqu’en mai. Lorsqu’elle rejoint son unité, celle-ci est devenue le 73e régiment de chasse de la Garde. Dès son retour, elle abat deux Bf 109 les 5 et 7 mai, mais est durement affectée par la mort de son leader, Alexeï Solomatine, lors d’un exercice le .
Litviak est blessée une nouvelle fois le , mais refuse d’être mise au repos, considérant sa blessure mineure, et demande à retourner au combat. Deux semaines plus tard, le 1er, elle est portée disparue lors d’une mission d’interception de bombardiers dans la région du Donetsk, en Ukraine. Elle a alors 21 ans.
Elle est l’as féminine la plus performante de la Seconde Guerre mondiale et reste la femme pilote dotée du plus important tableau de chasse de l’Histoire : si elle est officiellement créditée de 12 victimes, certains historiens estiment ce nombre plutôt proche de 16.
En 1969, des enfants découvrent l’épave d’un avion contenant les restes d’un pilote de petite taille dans un champ près du village de Dmitriyeva. Ayant eu vent de cette découverte en 1979, Valentina Vaschenko, un professeur qui avait déjà cherché, sans succès, ce qui était arrivé à Litviak fait exhumer le corps, dont l’analyse confirme qu’il s’agit de la pilote. Vaschenko monte alors un musée consacré à la jeune femme et aux autres femmes pilotes de l’Union soviétique, et obtient finalement de Mikhaïl Gorbatchev la nomination de Lidia Litviak au titre d’Héroïne de l’Union soviétique le
Lire sur TB : Les femmes pilotes soviétiques de la Grande Guerre patriotique.

1er août 1944 : l’insurrection de Varsovie commence contre l’occupant allemand.
L’insurrection de Varsovie est un soulèvement armé contre l’occupant allemand organisé par la résistance polonaise dans le cadre du plan militaire national « opération Tempête » (Burza en polonais), qui dure du au . Il s’accompagne de la sortie de la clandestinité des structures de la Résistance et de l’État clandestin ainsi que de l’établissement des institutions de l’État polonais sur le territoire de Varsovie libre.
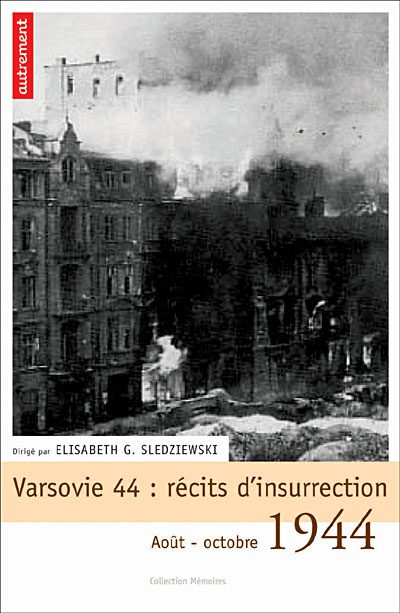 Côté militaire, le soulèvement est dirigé contre les forces allemandes, mais le but de ce plan est l’ultime essai de préserver la souveraineté de la Pologne face à l’avancée de l’Armée rouge et la position ambiguë des Alliés occidentaux vis-à-vis des intentions de l’Union soviétique.
Côté militaire, le soulèvement est dirigé contre les forces allemandes, mais le but de ce plan est l’ultime essai de préserver la souveraineté de la Pologne face à l’avancée de l’Armée rouge et la position ambiguë des Alliés occidentaux vis-à-vis des intentions de l’Union soviétique.
Plus de 50 000 combattants de l’Armia Krajowa (armée de l’intérieur) prennent part à l’insurrection, mais ils sont mal équipés (la moitié n’a pas d’armes) et peu entraînés face aux troupes allemandes. Très rapidement, les combats de rue deviennent défensifs. Les exactions allemandes sur les civils se multiplient, comme le massacre de Wola, pour terroriser la population et décourager les combattants. Les Britanniques tentent d’approvisionner les insurgés par voie aérienne, mais face aux pertes, arrêtent leurs opérations ; l’Armée rouge n’intervient presque pas, ce qui laisse le champ libre aux forces allemandes pour écraser l’insurrection. La résistance polonaise se sent abandonnée.
L’insurrection prend fin le , avec la signature d’un accord entre les parties assurant l’évacuation de tous les civils et la reddition des groupes de résistants polonais présents dans Varsovie. Une grande partie d’entre eux quitte alors la ville et une petite minorité devient les « Robinson Crusoé de Varsovie ».
Les pertes s’élevèrent à 18 000 soldats tués, 25 000 blessés et entre 160 000 et 180 000 civils tués. Du côté allemand, 17 000 soldats furent tués et 9 000 blessés. Après leur capitulation, les soldats de l’AK, désarmés, obtinrent in extremis, sur ordre de Hitler, le statut de prisonniers de guerre et furent internés dans le Reich. La population civile, traumatisée et décimée par les épidémies (il ne restait plus que 350 000 civils vivants à la fin de l’insurrection), fut brutalement évacuée et parquée dans des camps de transit aux portes de la ville (notamment à Pruszków), puis en grande partie déportée, soit vers des camps de concentration, soit vers des camps de travail, les plus faibles étant abandonnés sans ressources.

L’ampleur de la bataille de Varsovie s’explique par l’engagement des insurgés qui, jusqu’à la fin septembre, comptèrent sur la progression des armées soviétiques massées en face de Varsovie, sur la rive droite de la Vistule, et sur l’aide aérienne des Alliés occidentaux.
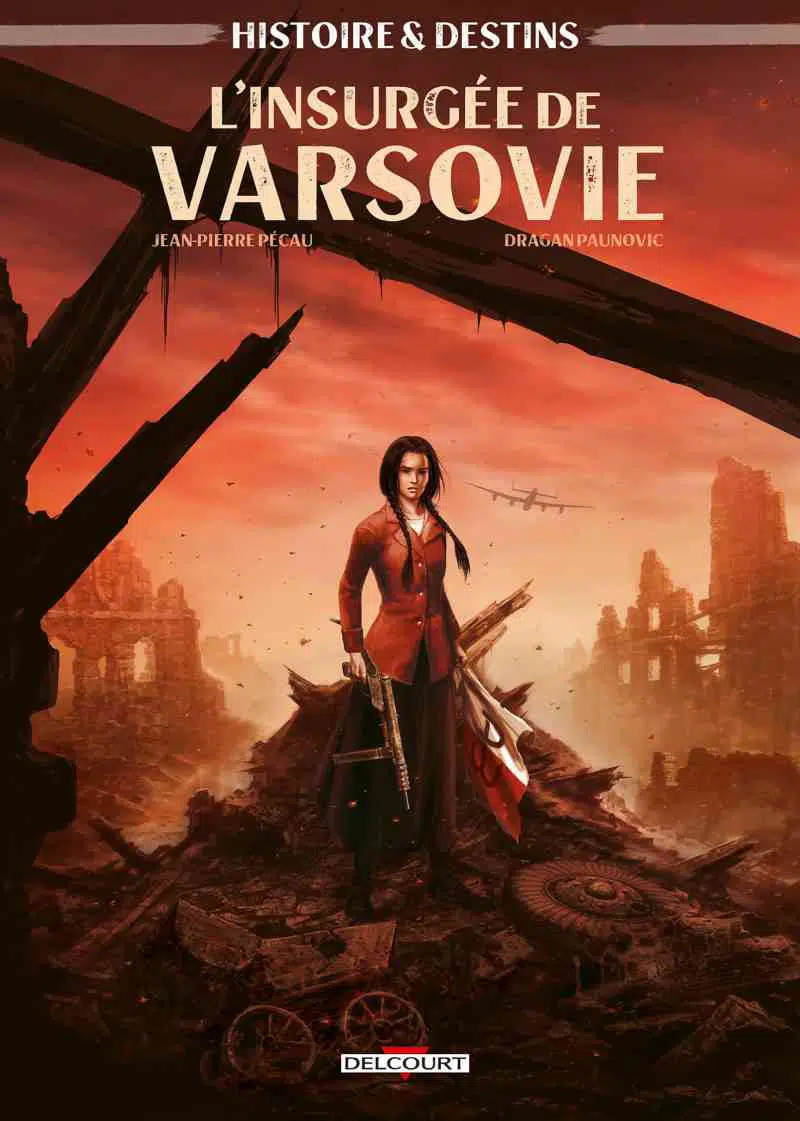 Les Soviétiques ne prennent le contrôle de la ville qu’en , bien après la fin de l’insurrection, quand ils reprennent leurs opérations sur tout le front. Les communistes sont alors tout à fait conscients que les combattants polonais poursuivraient la lutte contre une nouvelle occupation russe, suite logique de l’invasion de la Pologne le par l’Armée rouge, aux termes du pacte germano-soviétique conclu le et en coordination avec les forces allemandes. En conséquence, la résistance polonaise constitue un obstacle aux plans soviétiques visant à dominer la région. C’est pourquoi les « libérateurs » n’apportent pas de soutien actif à l’insurrection, bloquant même l’accès aux munitions aux unités polonaises de l’Armée populaire (LWP — alliée de Soviétiques) pour qu’elles n’agissent pas de leur propre initiative face à la tragédie vécue par leurs compatriotes, se déroulant devant leurs yeux sur l’autre rive de la Vistule.
Les Soviétiques ne prennent le contrôle de la ville qu’en , bien après la fin de l’insurrection, quand ils reprennent leurs opérations sur tout le front. Les communistes sont alors tout à fait conscients que les combattants polonais poursuivraient la lutte contre une nouvelle occupation russe, suite logique de l’invasion de la Pologne le par l’Armée rouge, aux termes du pacte germano-soviétique conclu le et en coordination avec les forces allemandes. En conséquence, la résistance polonaise constitue un obstacle aux plans soviétiques visant à dominer la région. C’est pourquoi les « libérateurs » n’apportent pas de soutien actif à l’insurrection, bloquant même l’accès aux munitions aux unités polonaises de l’Armée populaire (LWP — alliée de Soviétiques) pour qu’elles n’agissent pas de leur propre initiative face à la tragédie vécue par leurs compatriotes, se déroulant devant leurs yeux sur l’autre rive de la Vistule.
Durant les combats environ 25 % de la ville ont été complètement détruits et après la fin des hostilités, sur ordre personnel de Hitler, 35 % supplémentaires ont été systématiquement anéantis. Pendant le bombardement et le siège de la ville en , environ 10 % des bâtiments avaient été détruits et encore 15 % en 1943 à la suite de la liquidation du ghetto de Varsovie. Au total, à la fin de la guerre, la ville était rasée à hauteur d’environ 85 %.
1er août 1945 : disparition en mission de guerre du pilote et as japonais Naoshi Kanno.
Kanno est né le 13 octobre 1921 à Ryukou (aujourd’hui près de Pyongyang , en Corée du Nord), où son père était chef de la police. Il a grandi dans le village d’Edano, district d’Igu, préfecture de Miyagi ; ses parents étaient originaires de la même région.
Kanno fréquenta le collège Kakuda , où il était dévoué à Takuboku Ishikawa , appréciait les tanka et formait un cercle littéraire avec ses camarades. Certains tanka de Kanno furent sélectionnés pour la section littéraire du Kahoku Shimpo. En quatrième année de collège, il préparait les examens d’entrée à l’université, mais, pour des raisons financières, il décida de s’engager dans l’armée.
Kanno s’est inscrit à l’Académie navale japonaise en décembre 1938 et a obtenu son diplôme en février 1943 dans la 70e promotion. Après avoir terminé l’école de pilotage, il a été affecté au front en avril 1943, rejoignant le 343e groupe aéronaval, devenant rapidement commandant d’escadron ( chef buntai ) et en juillet 1944, il dirigeait (en tant que chef hikotai) le 306e escadron du 201e groupe aéronaval. Il a acquis une réputation de pilote de chasse rebelle mais habile. Initialement basé en Micronésie, son unité a combattu de nombreux engagements au-dessus des Philippines et de l’île de Yap. Le 27 octobre 1944, il a affirmé avoir abattu 12 avions de chasse Grumman F6F. Il a fait des demandes pour être transféré dans une unité kamikaze, mais les demandes ont été refusées, car il était considéré comme un pilote trop précieux pour être sacrifié. En décembre 1944, il est devenu le commandant d’escadron du 301e escadron du 343e groupe aérien. Son unité est retournée à Kyushu dans les îles japonaises vers la fin de la guerre.
La dernière mission de Kanno eut lieu le 1er août 1945, deux semaines avant la fin de la guerre, lorsqu’il décolla pour intercepter un groupe de bombardiers B-24 escortés par des chasseurs P-51 Mustang au large de l’île de Yakushima, au sud de Kyushu. Il fut endommagé par l’explosion du canon de son arme et disparut peu après, présumé mort. Sa dépouille ne fut jamais retrouvée et il fut ensuite inhumé au sanctuaire Yasukuni de Tokyo, au Japon. Il fut promu commandant à titre posthume.

1er août 1955 : premier vol de l’avion de reconnaissance américain Lockheed U-2.
Le Lockheed U-2 est un avion de reconnaissance qui a été utilisé de manière intensive durant la guerre froide par les États-Unis, notamment pour observer les territoires soviétiques. Il est toujours en service aujourd’hui, bien que modernisé.
La caractéristique principale de l’U-2 est sa capacité à voler à haute altitude (70 000 pieds, soit environ 21 300 mètres, deux fois plus haut que les avions de ligne) pour être hors de portée des défenses anti-aériennes. Il dispose d’un important rayon d’action, mais d’une vitesse relativement limitée.
Techniquement, l’U-2 pourrait être considéré comme un « planeur propulsé » en raison du très grand allongement de ses ailes, qu’on retrouve sur les planeurs. Si des rumeurs courent sur une structure de l’aile en bois, Denis Jenkins, dans WarbirdTech, volume 16, mentionne une structure monocoque en aluminium pour le fuselage, trois longerons pour l’aile et un treillis en aluminium. De même, Bernard Millot, dans le Docavia 29 sur les avions Lockheed, évoque une construction entièrement métallique.
Le décollage et surtout l’atterrissage de cet avion sont très délicats : en effet, le Lockheed U-2 dispose pour l’alléger de deux trains d’atterrissage en tandem (alors que les appareils disposent en général de deux trains principaux transversaux), complétés par des roulettes de stabilisation emboitées sous les ailes, appelées « balancines » ou « pogos ». Ces roulettes sont larguées au décollage, mais leur absence à l’atterrissage rend ce dernier plus difficile et impose que du personnel au sol intervienne à chaque atterrissage pour éviter le contact des ailes avec le sol lors de l’arrêt final, et remettre les balancines pour finir de ramener l’avion. Le pilote était toujours guidé du sol par un autre pilote d’U-2 à bord d’une voiture rapide roulant sur la piste près de l’avion.
Comme celui du B-47, le domaine de vol à haute altitude de l’U-2 est très étroit, l’écart entre la vitesse maximale (MMO) et la vitesse de décrochage (VS) n’étant que de 10 nœuds, soit moins de 19 km/h.
Cela est dû à ce que la vitesse du son (Mach 1) diminue avec l’altitude, vitesse qu’un avion comme l’U-2 ne peut se permettre d’approcher sous peine de graves dommages structurels, et aussi à ce que l’air à haute altitude est moins dense, ce qui diminue la portance des ailes et donc augmente la vitesse de décrochage. À 21 000 m, ces deux vitesses limites sont donc considérablement rapprochées, et les courbes de vitesse limite et de perte de portance finissent même par se recouper. Malgré l’aide du pilote automatique, cette faible différence nécessite une attention continuelle du pilote, pendant des vols pouvant durer jusqu’à neuf heures. Il fallait en général deux jours au pilote pour récupérer de l’effort.
Le rayon d’action de 3 000 kilomètres à l’origine est quasiment doublé depuis.
Kodak conçut un film spécial pour augmenter le nombre de prises de vues possible pendant un vol. Des objectifs réalisés par James Gilbert Baker, un astronome de l’observatoire de l’université Harvard qui avec Edwin H. Land a été un des conseillers en matière de reconnaissance photographique du gouvernement américain, permirent d’obtenir sur le film un pouvoir séparateur de 60 lignes au millimètre, à comparer aux 12 à 15 lignes au millimètre que donnaient les caméras à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Employé lors des premières missions avec une caméra panoramique spéciale de 200 kg, la Hycon-B construite par PerkinElmer, un seul appareil pouvait balayer une vaste zone avec une finesse alors sans précédent. La charge utile maximale des premières versions du U-2 n’excédait pas 250 kg. La caméra embarquait 3 650 mètres de film et couvrait une bande de 1 200 kilomètres de large, avec vue stéréoscopique de la bande centrale couvrant 240 kilomètres. Dans les années 1980, la focale utilisée par la caméra de l’U-2 passa à 182 cm. Au fil du temps, d’autres caméras provenant de diverses sociétés furent installées : en , on annonce que Lockheed-Martin, en collaboration avec Collins Aerospace, a terminé les essais et le déploiement d’une nouvelle version de sa caméra électro-optique SYERS-2C [Senior Year Electro-Optical Reconnaissance System] permettant de voir dans les bandes infrarouges à ondes courtes et moyennes.
Depuis les années 1980, il peut emporter un radar à synthèse d’ouverture ASARS-2 (en) développé par Hughes Aircraft. Des versions améliorées sont mises au point depuis par Raytheon, la dernière en service depuis 2019 étant le ASARS-2B.
En , le contrat Avionics Tech Refresh de l’US Air Force est signé avec les Skunk Works de Lockheed Martin pour faire évoluer l’U-2. La valeur du contrat est évaluée à 50 millions de dollars. Le programme est mené par Irene Helley, directrice du programme U-2 chez Lockheed Martin. En , les essais en vol du système de reconnaissance électro-optique sont achevés. Ce sont des caméras SYERS-2C (en) fabriquées par Collins Aerospace qui équipent la totalité de la flotte des U-2S. Le programme s’inscrit dans la mission ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) à très haute altitude de l’U-2S et comprend la mise à jour de la suite avionique et du PFD (Primary Flight Display).

1er août 1957 : création du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).
Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (North American Aerospace Defense Command, ou NORAD) est une organisation américano-canadienne dont la mission est la surveillance de l’espace aérien nord-américain, créée le et devenant effective le . Depuis , le NORAD effectue également une mission d’avertissement maritime, qui nécessite un arrangement partagé des activités conduites par les deux nations sur les approches maritimes et les voies navigables. Initialement créé sous le nom de « Commandement de la défense aérienne de l’Amérique du Nord », le NORAD change de nom en , en remplaçant le terme « aérienne » par « aérospatiale ».
***
 La perception croissante d’une menace soviétique liée aux armes nucléaires à longue portée (via l’aviation à long rayon d’action, puis les ICBM et les SLBM) a incité Américains et Canadiens à développer leur coopération en matière de défense aérienne.
La perception croissante d’une menace soviétique liée aux armes nucléaires à longue portée (via l’aviation à long rayon d’action, puis les ICBM et les SLBM) a incité Américains et Canadiens à développer leur coopération en matière de défense aérienne.
Au début des années 1950, ils décident de construire une série de stations radar à travers l’Amérique du Nord pour faire face à la menace d’une attaque soviétique depuis le pôle Nord.
La première série de radars, terminée en 1954, s’appelle la ligne Pinetree et est composée de trente-trois stations placées au sud du Canada. Cependant, les défauts techniques du système ont pour conséquence la création de nouveaux réseaux de radars.
En 1957, le McGill Fence (barrière) est terminé. Il s’agit d’un réseau de radars à effet Doppler détectant les aéronefs volant à basse altitude, placé à environ 300 miles (483 km) au nord de la ligne Pinetree, le long du 55e parallèle.
Le troisième système commun s’appelle le Distant Early Warning Line (DEW Line) et est également terminé en 1957. Il s’agit d’un réseau de 57 stations le long du 70e parallèle. Ce système prévient environ 3 heures à l’avance d’une attaque avant qu’elle n’atteigne une zone à forte concentration de population. Les attaques au-dessus de l’Atlantique ou de l’océan Pacifique auraient été détectées par les avions de guet aérien, les navires de guerre ou les radars des plateformes marines. Le commandement et le contrôle de ce système par le réseau informatique Semi-Automatic Ground Environment (SAGE) en service jusqu’en 1984 sont alors devenus un défi significatif.
L’annonce par les États-Unis et le Canada de la création d’un commandement intégré, le North American Air Defense Command, eut lieu le 1er août 1957, mettant fin aux discussions en cours depuis le début des années 1950. Les opérations débutent le 12 septembre à Ent dans le Colorado. L’accord formel a été signé par les deux gouvernements le .
Au début des années 1960, 250 000 personnes étaient impliquées dans les opérations du NORAD. L’émergence de la menace ICBM et SLBM devient réelle. En réponse, un système de surveillance spatiale et d’alerte missile est mis en place afin de détecter de tracer et d’identifier tout objet spatial dans le monde entier utilisant entre autres les satellites d’alerte précoce Midas.
L’extension des missions du NORAD à l’espace a pour conséquence l’ajout du terme « aérospatial » à son nom.
1er août 1965 : premier vol de la version F-4E du McDonnell Douglas Phantom II.
Le F-4 Phantom II est un avion militaire de troisième génération conçu par le constructeur américain McDonnell à partir de 1953. Il s’agit de l’un des avions militaires américains les plus importants du XXe siècle et l’avion de combat occidental ayant été le plus produit depuis la guerre de Corée : le 5 195e et dernier exemplaire a été livré en 1981, après plus de 20 ans de production ininterrompue. Pendant la guerre du Viêt Nam, la cadence de production du F-4 était de 72 exemplaires par mois.
C’est l’un des très rares avions à avoir été utilisé simultanément par l’US Air Force, l’US Navy et l’US Marine Corps, ainsi que par les deux patrouilles acrobatiques des Blue Angels (US Navy) et des Thunderbirds (US Air Force).
Désigné à l’origine AH-1, il fut renommé F4H par l’US Navy, et F-110 Spectre par l’US Air Force. Sa dénomination actuelle F-4 devenant officielle le , lorsque l’United States Tri-Service aircraft designation system unifia les codes de désignation pour les trois Départements (USAF/US Navy/US Army).
Les premières versions du F-4 n’embarquaient pas de canon interne, mais cette arme manquait cruellement aux pilotes à cause des performances plus que mitigées des missiles air-air de l’époque et des combats tournoyants contre les MiG au début de la guerre du Viêt Nam. Une première solution fut l’emport d’un pod ventral contenant un canon multitube Vulcan de calibre 20 mm. Mais, cela posait d’autres problèmes (augmentation de la consommation en carburant, manque de précision, etc.). Enfin, en 1965, apparut la version F-4E équipée d’un canon de 20 mm et 630 obus de 20 mm (6 s de tir) dans le nez à la place d’un capteur, qui entra en service deux ans plus tard et qui fut la version du F-4 construite en plus grand nombre. En 1972, les F-4E reçurent de nouveaux becs de bord d’attaque améliorant la manœuvrabilité en combat.

1er août 2005 : mort à 81 ans du général d’armée Jeannou Lacaze.
Jeannou Lacaze, né le à Hué en Indochine française (Annam), est un militaire et homme politique français. Engagé dans la résistance, il fait ensuite carrière dans l’armée. Il atteint le grade de général et est le chef d’État-Major des armées de 1981 à 1985. Il a également été député européen de 1989 à 1994.
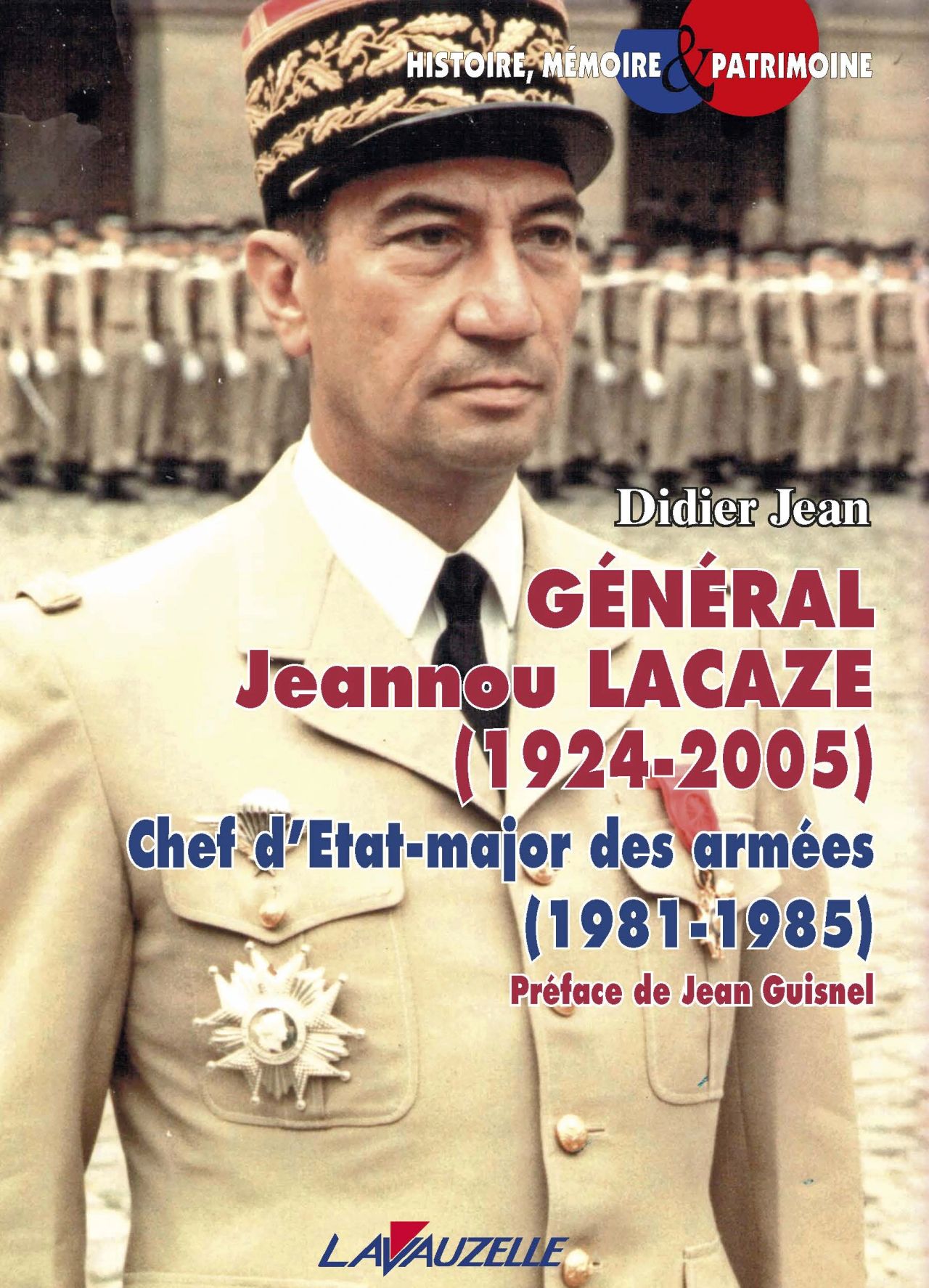 Jeannou Lacaze naît en Indochine, fils d’un sous-officier de la Gendarmerie française et d’une Annamite d’origine chinoise. Il étudie au Lycée Michel-Montaigne de Bordeaux.
Jeannou Lacaze naît en Indochine, fils d’un sous-officier de la Gendarmerie française et d’une Annamite d’origine chinoise. Il étudie au Lycée Michel-Montaigne de Bordeaux.
À l’âge de vingt ans, en 1944, il rejoint les FFI et participe à la Libération. Reçu à Saint-Cyr en 1945, il fait l’École d’application de l’infanterie à Auvours dont il sort en 1947.
Détaché à sa sortie d’école au 1er régiment étranger d’infanterie au Kef en Tunisie, il rejoint ensuite le 2e régiment étranger d’infanterie (REI) en Indochine, où il sert jusqu’en 1951. Chef de section au 3e bataillon, il est grièvement blessé alors qu’il est à la tête de sa section lors de l’assaut du village de Hô Chim le . Rapatrié sanitaire, il retourne, dès sa convalescence terminée, au 2e REI dans le 1er bataillon et part pour un nouveau séjour en Indochine.
De retour en France en 1951, il est affecté au régiment de tirailleurs marocains. Après une affectation à la section technique de l’armée de Terre, il prend le commandement de la 5e compagnie du 129e régiment d’infanterie en 1958 en Algérie.
En 1959, il est muté à la 11e demi-brigade parachutiste de choc.
Après un passage par l’École de guerre, il prend le commandement du 2e régiment étranger de parachutistes après le colonel Paul Arnaud de Foïard le . Il conduit son régiment au Tchad lors de l’intervention française de 1969. Il opère également au Togo et en Côte d’Ivoire.
Quittant la Légion étrangère, il rejoint les services de renseignement extérieurs en , où il devient directeur du renseignement, possiblement à la demande du ministère des armées Pierre Messmer. Il prend en 1977 le commandement de la 11e division parachutiste, qu’il conserve jusqu’en 1979. C’est durant son commandement que le 2e REP intervient à Kolwezi au Zaïre et que l’Armée française déclenche des actions extérieures au Liban et en Mauritanie.
Il gagne la confiance du président de la République Valéry Giscard d’Estaing qui le nomme Gouverneur militaire de Paris en 1980, et Chef d’État-Major des Armées le 1er , soit quelques mois avant l’élection de François Mitterrand. Le nouveau président le maintient à son poste jusqu’à son âge légal de départ à la retraite en 1985, alors qu’il totalise 41 années de service.
Titulaire de la Croix du combattant volontaire et de la Croix du combattant, le général d’armée Jeannou Lacaze est grand officier de la Légion d’honneur. Il est décoré de la croix de la Valeur militaire avec trois étoiles et de la Croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieurs avec une palme et deux étoiles. Il totalise 6 citations.
En 1986, il devient conseiller spécial auprès du ministre français de la Défense pour les relations militaires avec les pays africains ayant signé des accords de défense. Il devient également conseiller de plusieurs présidents africains : (Mobutu Sese Seko, Denis Sassou-Nguesso et Félix Houphouët-Boigny). Il s’est rendu plusieurs fois en Irak avant l’invasion du Koweït en 1991 pour soutenir la vente d’armements et de savoir-faire français au régime de Saddam Hussein.
En 1989, il se lance dans la politique. Il est député européen de 1989 à 1994, sous l’étiquette du CNIP avant de créer son propre parti, l’Union des indépendants (UDI). Il exerce également la présidence d’honneur de l’association Paris solidarité métro (lutte contre l’exclusion). On le surnomme « le sphinx », du fait qu’il ne parle que rarement et garde de nombreux renseignements pour lui. En 1995, il fonde Le Conseil commercial et industriel franco-irakien, pour vendre des armes à Saddam Hussein. La même année, il crée une association d’encouragement à de bonnes relations avec la Corée du Nord. Il intervient en qualité de « témoin de moralité » lors du procès du mercenaire Bob Denard en 1999.







Mettre l’absence de soutien soviétique au soulèvement de Varsovie sur le seul compte de calculs politique est un peu réducteur. Entre le 22 juillet et le 5 août 1944, l’Armée Rouge avait progressé de près de 400 km au cours de l’opération Bagration. Elle était donc fatiguée et au bout des ses possibilités logistiques. elle avait besoin de s’arrêter pour souffler et se réorganiser ; à l’image de l’armée américaine devant Metz (atteinte en septembre 1944, libérée en décembre). D’autre part, la planification soviétique prévoyait qu’après l’arrivée sur les rives de la Vistule, la priorité (et donc l’attribution des moyens de soutien et d’appui) soit donnée à d’autres opérations plus au sud. Enfin, il est faux de dire que rien n’a été fait. La 2° armée blindée soviétique s’est avancée jusqu’aux faubourgs de Varsovie, où elle a été arrêtée par les Allemands, avec destruction complète d’un de ses corps d’armée (le 3° corps blindé). L’une des causes de cet échec étant que les Polonais tenaient bien quelques quartiers de Varsovie mais avaient laissé aux Allemands la disposition des ponts sur la Vistule.