La rubrique CHRONICORUM BELLI réalisée en grande partie avec le contenu de l’encyclopédie libre en ligne WIKIPEDIA (licence CC BY-SA 4.0) avec des éléments de recherche sur le NET ajoutés par TB. Si vous souhaitez ajouter des éléments (documents PDF, références à des livres, des vidéos, des documents audio, etc.) vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante : contact[@]theatrum-belli.com. Bonne lecture.
13 septembre 533 : bataille de l’Ad Decimum.
La bataille de l’Ad Decimum oppose le l’armée vandale de Gélimer et l’armée byzantine de Bélisaire. Cette bataille et les événements de l’année qui ont suivi (parfois appelés seconde bataille de Carthage) marquent traditionnellement le commencement de la fin pour les Vandales et le début de la reconquête occidentale de l’empereur Justinien.
***

À l’instigation de l’empereur Justinien, la Sardaigne avait échappé à la domination des Vandales, et la Tripolitaine avait fait de même. Le roi vandale Gélimer différait la reconquête de la Tripolitaine à cause de son éloignement et préféra ramener l’île rebelle sous son autorité. À cet effet, il expédia un corps d’armée fort de 5 000 hommes sous le commandement de son frère Tzazon. Par ailleurs, plusieurs régiments de cavalerie vandale surveillaient les monts Aurès sur les marches du Royaume. Certaines de ces unités étaient les meilleures du royaume.
Profitant de l’absence de la flotte vandale, occupée à reconquérir la Sardaigne, Bélisaire avait débarqué en Afrique après trois mois de navigation, avec 10 000 hommes d’infanterie, soit deux légions, et 5 000 cavaliers, en partie romains et en partie mercenaires barbares hérules et huns. Les deux légions regroupaient chacune 5 000 fantassins d’élite. La flotte byzantine était montée par près de 20 000 marins. Surpris par cette nouvelle, Gélimer avait abandonné Carthage et ordonné la levée de nouvelles troupes milices urbaines.
L’Ad Decimum (en latin, la poste des Dix milles) est un simple repère sur la côte méditerranéenne à dix miles au sud de Carthage. Gélimer approche de la ville avec environ 11 000 guerriers, recrutés à la hâte, et qui ne sont même pas des troupes d’élite, face à l’armée de Bélisaire, comprenant environ 17 000 hommes, établie sur une forte position sur la route de Carthage, près de l’Ad Decimum.
Manquant de soldats de métier, Gélimer élabore un plan d’attaque qui lui permettra, avec moins de troupes, de tenir contre un adversaire supérieur en nombre. Il choisit le défilé de l’Ad Decimum, un étroit passage dans les montagnes de l’Atlas. Il divise ses forces en trois corps d’armée. Il envoie 2 000 hommes, commandés par son neveu Gibamond, pour déborder l’armée de Bélisaire, qui avance en colonnes le long de la route. Un autre corps, également de 2 000 hommes, commandé par le frère de Gélimer, Ammatas, tient le défilé près de l’Ad Decimum. Selon le plan vandale, les 7 000 hommes de Gélimer devaient se rabattre sur le flanc romain comme une masse d’arme et couper toute retraite.
Le plan tel qu’il était conçu était de qualité, s’il avait trouvé des mains expertes pour le réaliser. Mais la mission de Gibamond échoue, son corps de 2 000 hommes étant impuissant face aux troupes romano-hunniques qui le dispersent ; Gibamond est tué dans la bataille. Ammatas échoue aussi face à l’avant-garde byzantine commandée par Jean l’Arménien, et ne réussit pas à conserver le défilé. Lui aussi est tué dans la bataille. Ses hommes sont poursuivis par les Romains jusqu’aux portes de Carthage.
Ignorant la défaite simultanée d’Ammatas et de Gibamond, le corps principal de bataille commandé directement par le roi Gélimer continuait toujours son mouvement offensif pour affronter le gros des forces de Bélisaire, le long de la route principale. La cavalerie de Bélisaire, quoique plus nombreuse que la cavalerie vandale, est surpassée, les cavaliers vandales étant bien supérieurs au combat. Les cavaliers auxiliaires fédérés sont mis en déroute, après quoi un autre corps de cavalerie, formé de 800 gardes byzantins sous Uliaris, est repoussé. Il semble alors que les Vandales peuvent gagner la bataille.
Mais quand Gélimer parvient à la position d’Ammatas et découvre que son frère est mort, il est bouleversé et ne peut donner l’ordre de l’assaut. Il aurait ainsi pu détruire les restes de l’armée romaine désorientée et aurait taillé en pièces les éléments huns et romains partis vers Carthage après avoir battu Ammatas et Gibamond. Au lieu de ça, les hommes baissent leur garde pendant que Gélimer enterre son frère sur le champ de bataille.
Profitant du répit et de sa supériorité numérique, Bélisaire regroupe ses forces au sud de l’Ad Decimum et lance une contre-attaque, qui repousse les Vandales et les vainc. Gélimer ordonne à son armée d’amorcer la retraite non vers Carthage, mais vers la Numidie, où il peut compter sur le secours de ses alliés berbères. Il installe son camp dans la plaine de Bulla Regia.
Bélisaire campe près du champ de bataille, ne voulant pas s’établir à proximité de la ville de nuit. Le lendemain, il marche sur la ville, interdisant de tuer ou de réduire en esclavage les habitants de Carthage, désormais citoyens romains. Il trouve les portes de la ville ouvertes, et son armée est bien accueillie. Bélisaire se rend au palais royal et s’assoit sur le trône du roi vandale.
Il relève les fortifications de la ville et établit sa flotte dans le lac de Tunis, à huit kilomètres au sud de Carthage.
Les Vandales sont définitivement vaincus après la bataille de Tricamarum, le 15 décembre.
Source : WIKIPEDIA
13 septembre 1195 : Bataille de la Mozgawa (Pologne).
La bataille de la Mozgawa, du nom de la rivière traversant le champ de bataille, s’est déroulée le en Cujavie (Pologne).
À la suite de la mort inopinée de Casimir II le Juste le , son fils aîné Lech le Blanc lui succède à Cracovie et devient aussi duc de Mazovie et de Cujavie. Mieszko III le Vieux, ambitionnant de monter sur le trône de Cracovie, ouvre les hostilités en envahissant la Cujavie qu’il offre à son fils Boleslas.
L’armée de Petite-Pologne formée des partisans du jeune Lech le Blanc, soutenue par des troupes russes du prince Roman de Halicz, se met en marche et part à la rencontre de l’armée de Grande-Pologne du duc Mieszko III le Vieux et de ses alliés silésiens (Mieszko IV Jambes Mêlées et Iaroslav d’Opole). Les deux armées se retrouvent face-à-face sur les rives d’une petite rivière de Cujavie, la Mozgawa.
Au début de la bataille, les troupes de Lech le Blanc prennent l’avantage, mais en fin de journée, les Silésiens réussissent à retourner la situation au profit de Mieszko III sans que cela permette à celui-ci de prendre un avantage significatif, chaque camp restant finalement sur ses positions, faute de combattants.
C’est une des batailles les plus sanglantes de l’époque du démembrement féodal en Pologne (Mieszko III lui-même y a été blessé, son fils Boleslas de Cujavie y a été tué). Elle contribue à approfondir les divergences et à nourrir les rancunes entre les différents ducs polonais, accélérant ainsi le morcellement du territoire.
Source : WIKIPEDIA
13 septembre 1515 : bataille de Marignan.
La bataille de Marignan (Marignano en Italie, aujourd’hui Melegnano, ville à 16 km au sud-est de Milan) eut lieu les et et opposa le roi de France François 1er et ses alliés vénitiens aux mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan. La bataille de Marignan est l’un des épisodes des guerres d’Italie commencées par Charles VIII en 1494 afin de contrôler le duché de Milan. Première victoire du jeune roi François 1er, acquise dès la première année de son règne, elle fit environ 16 000 morts en seize heures de combat.
***
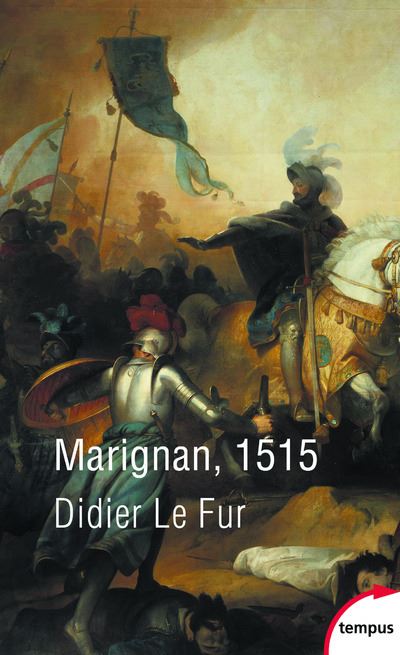 Louis XII mourut le 1er alors qu’il préparait une nouvelle campagne. Son successeur, François 1er, affirma ses prétentions sur le Milanais dès le début de son règne, en faisant valoir les droits de sa femme Claude, héritière des Orléans, et donc de Louis XII. Afin d’y parvenir, il obtint le soutien de Venise mais manqua d’obtenir celui des Suisses, exigeant toujours les indemnités promises lors de la prise de Dijon avant toute régularisation des relations. Dans une ultime tentative de conciliation, le jeune roi français se déclara disposé à honorer la dette de Dijon à condition de récupérer le Milanais. Sous l’influence de Schiner et la prédominance des cantons anti-français, la proposition fut repoussée par les Suisses.
Louis XII mourut le 1er alors qu’il préparait une nouvelle campagne. Son successeur, François 1er, affirma ses prétentions sur le Milanais dès le début de son règne, en faisant valoir les droits de sa femme Claude, héritière des Orléans, et donc de Louis XII. Afin d’y parvenir, il obtint le soutien de Venise mais manqua d’obtenir celui des Suisses, exigeant toujours les indemnités promises lors de la prise de Dijon avant toute régularisation des relations. Dans une ultime tentative de conciliation, le jeune roi français se déclara disposé à honorer la dette de Dijon à condition de récupérer le Milanais. Sous l’influence de Schiner et la prédominance des cantons anti-français, la proposition fut repoussée par les Suisses.
Devant l’échec de la diplomatie, François 1er rassembla une armée de 50 000 hommes. Pour financer ses dépenses militaires, le roi augmenta l’impôt et fit des emprunts, car il lui fallait acheter la neutralité d’Henri VIII d’Angleterre mais aussi celle de Charles de Gand, futur Charles Quint. Quatre cents kilos d’or, 150 000 écus allèrent à la garnison suisse. En l’absence du roi, sa mère, Louise de Savoie assura la régence.
L’armée de François 1er fut placée sous le haut commandement du Connétable Charles III de Bourbon, de La Trémoille, Jacques de Trivulce, Lautrec, Bayard et Robert III de La Marck de Bouillon, base stratégique arrière Anthoine Du Prat, Chancelier de France. Composée de nobles français, arquebusiers et arbalétriers gascons et navarrais, lansquenets allemands, et mercenaires des Pays-Bas (la « bande noire »), l’armée française comprenait plus de 22 000 lansquenets allemands ; 2 500 cavaliers lourdement armés des compagnies d’ordonnance qui perpétuèrent les pratiques et usages du chevalier médiéval ; vingt compagnies de Navarrais, Basques et Gascons (10 000 hommes), aux ordres du général basco-navarrais Pedro Navarro ; 8 000 fantassins français et 3 200 sapeurs ou charpentiers ; une artillerie de 69 grosses pièces (couleuvrines, serpentines) ; un important train des équipages, sous le commandement de Galiot de Genouillac, sénéchal d’Armagnac.
De mai à août, 32 000 Suisses avaient fait mouvement vers Suse, Pignerol et Saluces pour empêcher le passage des Alpes par les Français. L’infanterie des Confédérés s’articulait en trois corps : l’avant-garde constituée d’arbalétriers et d’arquebusiers (au rôle encore limité car leur arme à feu était encore peu précise et de faible portée) qui servaient à renseigner le commandement sur la position de l’ennemi ; le corps de bataille formé de piquiers disposés en carré, protégés à l’extérieur par des hallebardiers et des arquebusiers, la fonction principale des piquiers étant de repousser les charges de la cavalerie ennemie ; l’arrière-garde compte d’autres arquebusiers prêts à intervenir parmi les réserves générales et habituellement appelés à exécuter un mouvement tournant ou enveloppant. Les Suisses étaient conduits par leurs meilleurs généraux Werner Steiner de Zoug, Hugues de Hallwyl et l’avoyer de Watteville de Berne. Le commandant en chef des troupes suisses, Ulrich von Hohensax, qui les avait conduits à la victoire lors des précédentes campagnes d’Italie était retenu par la maladie.
Au printemps 1515, François 1er ordonna la concentration des troupes à Grenoble, sous la supervision de Bayard, lieutenant général du Dauphiné. En , les troupes françaises firent mouvement sur Gênes et occupèrent la ville. Alarmée par les évènements, la Diète suisse commença par envoyer 8 500 hommes vers Novare rejoindre Schiner, devenu cardinal, et fit occuper les cols des Alpes du Piémont où l’armée française était attendue.
Solidement établis à Suse, les Suisses tinrent la route habituelle du Mont-Cenis. L’armée française d’environ 63 000 personnes, y compris les chevaux et l’artillerie (60 canons de bronze) avec l’aide technique de l’officier et ingénieur militaire Pedro Navarro qui utilisait pour l’une des premières fois des explosifs pour élargir les chemins de montagne, franchit les Alpes par une route secondaire, contournant les troupes suisses au sud par le col de l’Argentière (Colle della Maddalena en italien, un sentier à peine praticable par des chevriers ; trois mille sapeurs y ouvrirent à la fin un chemin carrossable), où, du au , en cinq jours, passèrent environ 30 000 fantassins, 9 000 cavaliers, 72 gros canons et 300 pièces de petits calibres. Les Suisses se replièrent alors sur Milan. Après quelques combats d’arrière-garde en à Villafranca Piemonte, Chivasso et sur la Doire Baltée ainsi que l’envoi d’un contingent de 15 000 hommes supplémentaires, les Suisses comptaient 45 000 hommes répartis entre Varèse, Monza et Domodossola, plus la garnison de Milan. Dans la plaine du Piémont, une partie de l’armée suisse prit peur et proposa, le à Gallarate, de passer au service de la France.
Une campagne efficace de propagande française, visant à dissuader les cantons suisses de poursuivre les hostilités, entraîna le mécontentement parmi les troupes suisses et des différends parmi les chefs, permettant en même temps une poussée sur toute la partie occidentale du Milanais par les Français. Une série de pourparlers furent engagés en (pourparlers de Gallarate), lors desquels François 1er offrit encore davantage de concessions aux Suisses pour qu’ils renoncent à leurs prétentions, aboutissant même au traité de Gallarate () qui finalement ne fit que consacrer la dissension entre les Confédérés souffrant de l’absence d’un chef unique.
Les Français se mirent à négocier directement avec le pape derrière le dos des Confédérés. Le duc de Milan tardait à verser la solde et les vivres venaient à manquer. Après la signature de ce traité qui divisa encore un peu plus les Confédérés, les Bernois, Fribourgeois, Valaisans et Soleurois, peu enclins à se battre pour un commanditaire qui tardait à assumer ses obligations, rentrèrent en Suisse, ce qui représentait le départ de 10 000 Confédérés.
Devant l’échec des négociations et la division des troupes suisses, François 1er fit mouvement en direction de Milan et établit son camp près de Marignan. Les Zurichois et les Lucernois, se sentant liés par le traité de Gallarate, reçurent l’ordre de leurs gouvernements respectifs d’accepter une paix honorable. Uri, Schwyz, Unterwald et Glaris refusèrent de battre en retraite. Ceux parmi les Suisses qui étaient restés à Milan se laissèrent entraîner au combat sur l’insistance du cardinal Schiner. Quelque 20 000 Suisses (jusqu’à 30 000 selon P. de Vallière) disposant de 8 canons et 1 000 arquebusiers devaient faire face à plus de 30 000 Français équipés de la plus belle artillerie de siège de l’époque. La plaine maraichère irriguée était ensoleillée.
Craignant le départ des dernières troupes des Confédérés sans livrer bataille contre les Français, le cardinal Schiner choisit de provoquer la bataille par la ruse devant Milan. Il envoya, avec la complicité secrète de certains capitaines suisses dont Winkelried (à ne pas confondre avec Arnold Winkelried), la garde ducale et des cavaliers pontificaux provoquer la cavalerie française.
Le jeudi , aussitôt le combat engagé, les cavaliers du pape revinrent appeler les troupes suisses à l’aide. Celles-ci, avec Schiner à leur tête, se mirent immédiatement en route et sortirent de la ville de Milan pour affronter l’ennemi. Une fois hors de la ville et constatant la tromperie, La Trémoille et de Fleuranges s’étant repliés après la légère escarmouche, de Winkelried soi-disant en grand danger se reposant en toute quiétude, après un moment de confusion, on décida néanmoins de poursuivre. Les hommes se jetèrent à genoux pour prier le Seigneur suivant l’usage de leurs pères et se mirent en marche.
Le combat s’engagea. Les Confédérés durent faire face au feu de l’artillerie française ainsi qu’aux cavaliers commandés par Bourbon, Guise et Gaillards qui les attaquaient par le flanc. Le premier choc avait complètement enfoncé la première ligne de l’armée française qui se reforme soutenue par la cavalerie, elle-même confrontée aux difficultés du terrain et aux piques suisses. François 1er, en personne à la tête de la cavalerie et des lansquenets allemands, ordonna une attaque généralisée contre les Suisses. Un combat furieux s’engagea pendant lequel tomba Jacques, fils aîné de Jean IV d’Amboise, François du Bourbon, le fils du général Trivulcese se fit capturer, et le chevalier sans peur Bayard évita de justesse la mort. Ce dernier se battit avec grande bravoure mais fut finalement contraint de ramper le long des fossés pour sortir du champ de bataille. Le corps à corps sanglant entre belligérants se poursuivit jusqu’en soirée et dans l’obscurité croissante. À la disparition de la lune vers 23 heures, la nuit noire ne permettant plus de distinguer amis et ennemis, tambours et trompettes sonnèrent le ralliement après six heures de luttes ininterrompues. Après quelques instants d’hésitations, contre l’avis de Schiner, les Confédérés décidèrent de tenir leur position, légèrement en leur faveur, plutôt que de retourner sur Milan, malgré le froid et la faim. Ainsi s’acheva la première journée de la bataille. Dans l’obscurité, la confusion sur le terrain était grande. On raconta que le roi de France avait passé la nuit appuyé contre une pièce de canon à 50 toises d’un bataillon suisse (environ 90 mètres).
Au petit matin du , le combat reprit. L’artillerie française commandée par le sénéchal d’Armagnac fit des ravages, mais ne put ralentir les Suisses, tandis que l’aile gauche de l’armée commandée par le duc d’Alençon fléchit face au gros de l’ennemi, les lansquenets encore faiblissent aussi. La bataille battait son plein mais soudain à 8 heures du matin retentit : « Marco ! Marco ! ». Ce furent les Vénitiens, menés par Bartolomeo d’Alviano, qui arrivèrent sur l’aile avec 3 000 cavaliers à la tête des fantassins et estradiots (cavaliers légers des Balkans, dits « Albanais ») originaires de Grèce ou d’Albanie, voire de Croatie et de Bosnie actuelles. Ils écrasèrent le gros des Suisses tandis que les lansquenets repartaient à l’assaut avec vigueur. À 11 heures, les Suisses, qui avaient subi des pertes énormes, battirent en retraite vers Milan.
Le soir, entre 9 000 et 10 000 Suisses gisent sans vie sur le champ de bataille, près de la moitié des contingents engagés. Tandis que le camp franco-vénitien compte 5 000 à 8 000 morts.
Plusieurs auteurs évoquent l’adoubement du roi par Bayard sur le champ de bataille de Marignan le .
Quelques auteurs ont considéré cette histoire comme un mythe, qui aurait été monté par demande royale, afin notamment de faire oublier que celui qui adouba François 1er lors de son sacre (c’est-à-dire le connétable de Bourbon, artisan de la victoire de Marignan) se rangea en 1523 du côté de Charles Quint. Pire, le connétable aurait été l’organisateur de la future défaite de Pavie, et donc de l’emprisonnement de François 1er.
La légende fut donc inventée par Champier pour faire oublier les liens « filiaux » qui liaient le roi et son traitreux sujet, tandis qu’elle aurait renforcé un lien (inexistant au départ) entre le souverain et le symbole du courage et de la vaillance, qui mourra en 1524. Le roi, toutefois, a fait ses premières armes avec Bayard lors de la campagne malheureuse de Navarre (), et il a tenu à le récompenser de sa bravoure dès avec le don de la lieutenance générale du Dauphiné, charge fort prestigieuse. L’invention pourrait également être liée à la volonté du roi de France de se montrer le parfait exemple, chevaleresque entre tous, alors qu’il était prisonnier. Mais, le roi étant prisonnier à Madrid, il était incapable de monter une quelconque opération de propagande.
Le maréchal de Florange qui rédige ses mémoires en captivité et totalement coupé du monde extérieur n’aurait pas été en mesure d’ailleurs de recevoir un tel message de la cour de France. Il n’en reste pas moins que l’épisode est étrange et, s’il n’a pas été inventé par les panégyristes de Bayard, relève probablement d’un « jeu chevaleresque » comme le roi les aimait tant.
Source : WIKIPEDIA


13 septembre 1759 : bataille des plaines d’Abraham (Québec).
La bataille des Plaines d’Abraham s’est déroulée le pendant la guerre de la Conquête à Québec, en Nouvelle-France. Elle opposa les Français, défendant la ville assiégée, aux Britanniques, attaquants, et se solda par la victoire de ces derniers et la mort des deux généraux commandant la bataille, Montcalm et Wolfe. Elle marque le début de la Conquête britannique du Canada en Nouvelle-France.









